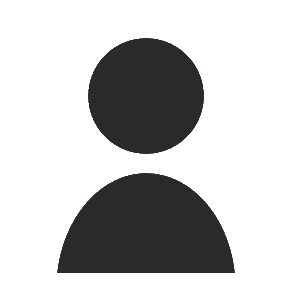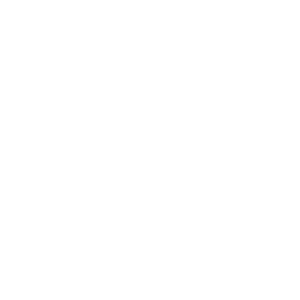This document is unfortunately not available for download at the moment.
Phonologie et sémantique
Hendrik Pos
Translated by Patrick Flack
pp. 157-180
Lors de l’année écoulée, il a été plusieurs fois question au sein de ce département de l’Académie d’une découverte linguistique qui a paru d’une fécondité inhabituelle : la théorie phonologique. Messieurs Van Ginneken, Van Wijk et Faddegon ont mentionné cette théorie en relation à leurs propres recherches linguistiques. Le triste sort a voulu que la présente assemblée ait récemment dû commémorer la mort du fondateur de cette théorie, le Prince Trubeckoj, ce qui a donné nouvelle occasion de parler de son œuvre pionnière. Il ne saurait être mon intention première de vouloir contribuer ici aux multiples applications de la phonologie en y ajoutant une de plus. Cela conviendrait trop peu à quelqu’un qui a troqué la linguistique pour la philosophie et dont les recherches linguistiques étaient déjà précédemment guidées par des questionnements philosophiques. Une telle personne doit se contenter d’accepter avec respect la démonstration de la théorie que font les linguistes. Il lui revient toutefois d’en éclairer un autre aspect, qui saute moins aux yeux des chercheurs préoccupés de questions empiriques : la structure méthodologique générale de la théorie ainsi que ses présupposés quant à la réalité et à notre manière de connaître celle-ci. Voilà l’optique dans laquelle je me permets de vous entretenir de quelques considérations dont le but premier est de clarifier le sens philosophique de la phonologie et le but second est de démontrer sa valeur pour la sémantique.
La phonologie a eu à se légitimer dès ses débuts face à une science des sons du langage plus ancienne, la phonétique. La passionnante rivalité qui existe entre les deux théories découle du fait qu’elles étudient toute deux le même objet, les sons de la parole humaine, mais à partir de présupposés entièrement différents. Alors que la phonétique commençait à rendre compte de ses présupposés, la phonologie est apparue avec la prétention d’offrir une interprétation encore plus féconde de ces mêmes phénomènes. La phonétique étudiait les sons du langage au moyen d’une méthode objectivo-empirique. Elle s’efforçait de répertorier les sons de façon aussi vaste que possible et d’établir leurs régularités par voie inductive. Cette répertorisation devait être la plus précise, la plus exhaustive et la plus objective possible. Être le plus précis possible impliquait pour la phonétique que l’oreille humaine ne pouvait être utilisée comme l’organe de collecte des sons à étudier, car elle était généralement trop grossière pour différencier les nuances les plus fines. Être le plus exhaustif possible impliquait que la répertorisation ne saurait se satisfaire de l’expérience limitée des sons faite par une personne qui, même sans être linguiste, serait attentive à sa propre langue. L’exhaustivité requérait elle une masse de donnée la plus grande possible. Bien qu’il soit douteux qu’une telle exhaustivité soit atteignable quand on réfléchit de plus près à ce terme, on s’en approchait quand même en accumulant le plus grand nombre de données possible. Pour terminer, la recherche phonétique se souciait d’être objective, ce qui veut dire que le chercheur demeurait plein de méfiance envers toute interprétation subjective des sons faite par un locuteur réfléchissant sur le langage. L’inventaire phonétique prenait pour tâche d’écarter ces interprétations certes naturelles mais subjectives : seulement ainsi pouvait-il être question d’une détermination purement objective. La triple ambition de la phonétique l’amenait donc à se distancier totalement de toute représentation possédée par un locuteur au sujet du matériau sonore qu’il utilise.
Une exigence rigoureuse de détermination objective ne peut en science être considérée autrement que comme étant valide et sa poursuite doit donc être vue comme une vertu. Bien qu’il mène dans certains cas à de véritables aperçus, l’exercice de cette vertu conduit toutefois dans d’autre cas à un objectivisme qui n’atteint plus la chose, car dans sa quête d’objectivité il s’entrave lui-même la route avec les moyens et les principes qu’il avait initialement adoptés. Un tel objectivisme – qui s’accroche rigidement à des présupposés rendus insuffisants par le fait qu’ils ne font pas droit à la structure de la chose à étudier – est évidemment lui-même subjectif et se révèle comme tel lorsqu’apparaissent des hypothèses qui s’avèrent fertiles mais doivent être dénoncées comme étant subjectives parce qu’elles réfutent des présupposés considérés comme intouchables. Une telle révélation semble bien avoir eu lieu dans le cas de la phonologie.
Les présupposés de l’ancienne phonétique étaient très simples, ce qui en soi constitue aussi une vertu logique. La question, toutefois, est de savoir si ces présupposés n’étaient peut-être pas tellement simples, qu’ils pouvaient certes satisfaire notre prédilection subjective pour la simplicité logique, mais pas nous fournir un concept adéquat de la chose à laquelle ils étaient censés s’appliquer. Cela semble bien avoir été le cas de l’ancienne phonétique : elle avait les vices de ses vertus. En effet, la phonétique s’est construit un objet qui concordait avec la simplicité de ses principes et qui semblait correspondre à l’objet de l’expérience simplement placé dans une lumière plus claire et plus précise. En vérité, cet objet construit était une abstraction. L’abstraction de cet objet découlait du fait que la phonétique ne considérait les sons du langage comme rien d’autre que des bruits, admettant certes qu’ils soient produits par les organes humains de la parole au service de l’expression des pensées et des sentiments, mais non que le but de leur production ou la nature du producteur jouent un rôle dans leur étude ultérieure. Une fois l’objet ainsi détaché de ses racines, son étude ne peut plus subsister autrement que dans l’espoir qu’une certaine régularité et que certaines moyennes se dessinent au sein de la multiplicité des données répertoriées. Comme l’explication de cette régularité ne saurait être recherchée dans la cohésion structurelle du phénomène, il faut alors saisir celle-ci à partir d’une propriété générale qui se manifeste dans des phénomènes similaires donnés en grand nombre, autrement dit, à partir de certaines normes et probabilités qui découlent d’une propriété très générale des grands nombres. Cela ne veut pas dire que la phonétique a consciemment et en toute conséquence isolé son objet de manière si radicale. Le chercheur scientifique ne se tient pas en général aux conséquences ultimes des principes qu’il entendait suivre initialement. Il garde un sain contact avec la chose elle-même, ce qui lui permet de maintenir son cap là même où sa théorie nécessiterait autre chose. Mais si heureuse soit une telle inconséquence, il est tout de même préférable de bien en prendre conscience et de rendre superflu cette intuition chanceuse en définissant la théorie de telle manière à ce qu’il ne subsiste plus de contradictions entre elle et la pratique scientifique.
En traitant les sons du langage, sans considérer leur nature spécifique, comme des bruits, l’ancienne phonétique privait son objet de sa qualité propre, ce qui revenait pour elle en tant que science à couper ses liens avec la psychologie. Elle a ainsi été contrainte de développer une image du langage en conséquence de cette limitation. Le raisonnement de cette méthode était le suivant : les personnes qui parlent une langue utilisent régulièrement des sons qui se distinguent individuellement de cas en cas ne serait-ce de façon si minime que les locuteurs ne perçoivent pas ces différences ou, du moins dans la pratique, qu’ils les négligent. La perception « objective » nous apprend qu’il y a toujours des différences, car tout son prononcé est individuel. Les phénomènes obéissent à la loi de l’individuation, par la force de laquelle un phénomène qui est donné ici et maintenant peut certes coïncider avec un autre phénomène qui apparaît là-bas et tantôt, mais n’y est toutefois pas égal, encore moins identique. L’observation objective doit venir s’ajouter pour que certaines constantes qui apparaissent dans le flux des sons et qui sont interprétées comme telles par le locuteur puissent être déclarées comme étant une illusion subjective et comme des bruits qui ne sont « en réalité » que comparables l’un à l’autre. L’illusion de similarité réclame une explication qui reviendrait à dire que l’oreille n’est pas assez fine pour entendre des différences que l’on peut néanmoins enregistrer avec des instruments. Alors que la perception objective des sons fait voir une variété illimitée de différences trop petites pour l’oreille, la méthode objective prétend pouvoir connaître la vraie qualité des sons là où, en revanche, le critique subjectif qu’est le locuteur reste biaisé : ce dernier néglige des différences parce qu’il n’en a pas besoin lorsqu’il fait un usage pratique du langage. Il a une impression de similarité quant à des sons qui sont objectivement différents parce qu’il n’écoute pas avec assez de précision et que ses données ne sont pas assez exhaustives. La méthode de la répertorisation objective devait remédier à tous ces défauts de la connaissance subjective et naturelle du langage : elle est effectivement la première à avoir découvert l’infinie variété et les nuances sans fin des sons. Mais après cette découverte une deuxième tâche s’est dressée devant elle : expliquer pourquoi les sons se présentent à la conscience subjective comme des unités semblables et limitées en nombre, d’une façon très différente donc de ce qu’ils sont « en réalité ». L’explication pragmatique susmentionnée est la plus évidente. L’unité que le locuteur qui ignore tout de la linguistique croit percevoir dans les sons est une fonction de la vie pratique. Elle n’est rien en réalité, mais elle se laisse expliquer psychologiquement. Pour la conscience fugace de l’utilisateur du langage, dont l’attention est tournée vers ce qu’il veut dire, les phénomènes se présentent de cette façon simplifiée. Il doit donc nécessairement y avoir un clivage entre le mode de l’apparition subjective et la réalité objective. On voit ici à quoi mène une logique qui conçoit les phénomènes sonores en un sens objectiviste : le monde des sons, détaché de la conscience qui les porte et autonomisé en un groupe de phénomènes perceptibles dans l’espace et le temps, est imaginé comme une collection d’unités disparates qui varient à l’infini, qui se condensent en des moyennes et exhibent à travers ces variations toutes les transitions et coïncidences possibles, mais pas de similarité ou d’identité.
Le mérite de la phonologie est d’avoir rompu cette image du langage et d’avoir étudié ses sons non comme des bruits définis d’après une structure répertoriée objectivement, mais dans leur spécificité, comme des faits de langage se rapportant à la conscience du locuteur. Bien loin de se défaire le plus possible de la conception subjective du locuteur et de demander seulement en second lieu comment se manifeste cette conception des sons, la phonologie a compris que la clé d’une théorie scientifique des sons se trouve justement dans la conscience que le locuteur a des sons dont il fait usage. En prenant pour point de départ une conscience qu’elle définit non pas comme percevant objectivement des sons, mais comme produisant et interprétant ceux-ci téléologiquement, la phonologie a réussi à surmonter l’ancien objectivisme de la phonétique et elle a du même coup rétabli la conscience du locuteur dans ses droits comme source de connaissance des sons. Pour la phonologie, la conscience n’est plus seulement un phénomène périphérique, qui saisit les sons comme quelque chose de vrai pour ensuite les interpréter dans un schéma : elle est elle-même la productrice des sons du langage, elle est la modalité spécifique de cette production qui permet aussi d’élucider la nature des sons eux-mêmes. Tout dépend donc de la manière dont on détermine comment les sons sont produits. L’étude de cette production ne peut se satisfaire de parler d’un automatisme qui produit les sons à l’aveugle sur la base d’une habitude acquise une fois. Les présupposés de la psychologie de l’association sont certes eux aussi attrayant de par leur simplicité, mais ils sont factuellement trop simplistes : parce qu’ils considèrent les sons psychologiquement, ils mènent au concept de répertorisation qui caractérise aussi l’observation purement externe et objectiviste. La phonologie doit donc faire recours à des hypothèses plus profondes. Elle ne peut s’empêcher de parler d’intentions qui sont dirigées par des types ou des modèles présents à l’esprit du locuteur quand il prononce des sons déterminés. Ce point de vue est psychologique et ne peut être justifié qu’introspectivement. Son importance est qu’il met de l’ordre dans la multiplicité confuse des sons, qui ne sont plus classés de façon inductive, mais d’après l’ordre qui se manifeste de manière immanente dans les types ou modèles de sons. Cet ordre est le fondement des sons toujours déjà nuancés et perceptibles de l’extérieur. Que chaque son produit soit différent de tous les autres est un fait empirique. Alors que l’activité de répertorisation ne découvre pas d’autre unité dans les sons que ce qui se présente comme moyenne, sans que l’apparition de moyennes se laisse elle-même expliquer, la phonologie suit le chemin opposé : pour elle, les moyennes ne sont pas secondaires et ne résultent pas d’agrégations accidentelles, elles sont premières. Pour être plus précis, les types et modèles de sons découverts par la méthode introspective permet d’expliquer ce que la théorie inductive associe aux moyennes. La visée de ces types constitue la première cause de la production des sons. Cette visée n’est pas entièrement suffisante pour expliquer les différences qui apparaissent dans l’expérience, mais elle est toutefois nécessaire pour comprendre les correspondances qui apparaissent dans cette diversité. En effet, ces correspondances prennent leur source chez le locuteur lui-même. La réalisation efficace de modèles fixes de sons rend psychologiquement certain ce qui n’est statistiquement que constatable.
On ne gagne pour l’instant pas grand chose en passant des sons répertoriés de façon externe au fondement psychologique de leur façon ordonnée d’apparaître, si on n’explique ce faisant que la régularité de l’emploi des sons chez un unique individu. On réduit certes une multiplicité illimitée à une multiplicité de systèmes individuels, qui chacun pour soi exhibe un certain ordre de par le nombre limité d’unités sonores typiques que l’utilisateur a à l’esprit. Mais les systèmes individuels s’opposent l’un à l’autre dans une multiplicité confuse et forment ensemble une diversité certes plus restreinte mais encore illimitée. Il subsisterait donc de l’atomisme initial de la démarche de répertorisation un autre atomisme, celui des systèmes individuels, lesquels requièrent une démarche de répertorisation identique à celle qui était initialement appliquée indifféremment à tous les phénomènes.
La phonologie atteint sa complète puissance en surmontant également l’atomisme des systèmes de sons individuels. En effet, elle postule que chaque locuteur ne s’oriente pas seulement par rapport à l’horizon d’un modèle de sons, mais qu’il partage ce système avec ces interlocuteurs : c’est le même système qui est visé par le locuteur et par celui qui essaye de le comprendre. Si chaque individu possédait son propre système de sons pour parler, ce dernier n’aurait qu’une importance très mince pour la compréhension mutuelle, car cette importance est liée précisément à l’identité des systèmes phonétiques de tous les interlocuteurs. Un système d’unités sonores typiques régule donc autant le comportement linguistique de l’individu que celui de l’ensemble des interlocuteurs. Il s’agit du même son qu’un individu veut exprimer, bien qu’il le fasse nécessairement de sa manière propre, et qu’un autre individu comprend, bien que lui aussi ait sa propre manière de dire la même chose et qu’il interprète rationnellement la manière propre de parler de son interlocuteur. Le fait qu’il perçoive cette façon particulière de parler mais la comprend malgré tout comme s’il parlait lui-même prouve que leur compréhension mutuelle est dominée par un type idéal unique des sons réalisés de façons toujours nuancées par les locuteurs. Il n’est pas non plus le cas que la compréhension entre les locuteurs se forme parce que, chacun possédant lui-même un système de sons, on découvre que l’autre connaît et maîtrise ce système de sons. En effet, ce système de sons n’est pas initialement la propriété d’un individu qui serait ensuite reprise par autrui : il est l’expression d’une union qui existe plus profondément que la réalité des individus pris isolément. C’est à l’intérieur de cette union, et en tant que forme expressive de celle-ci, que les intentions phonétiques du locuteur et du récepteur se rencontrent. Cette union est un fait originaire irréductible qui ne se laisse pas expliquer par la coïncidence accidentelle d’un certain nombre de facteurs, mais inversement, qui précède la désagrégation de ces facteurs et rend compréhensible la possibilité même d’une telle désagrégation.
Au vu de l’originarité de l’union qui sous-tend la compréhension mutuelle, on se rend compte de la naïveté de l’image de la réalité sur laquelle s’appuyaient non seulement l’ancienne phonétique mais aussi, parallèlement, la psychologie atomiste. Autant notre pensée rationnelle a pu être convaincue par l’image de sons isolés déterminés un à un en tant que phénomènes perceptifs dans le temps et l’espace, autant nous rendons-nous désormais compte que cette simplicité est trop chère payée, car elle nous prive de la possibilité d’une compréhension plus profonde de l’objet. Il en va de même lorsque, à un plus haut niveau, le monde sonore est assimilé à un système individuel, mais de manière à ce que l’individu soit pensé comme une unité existant en elle-même. Ces unités, les individus humains, ont aussi la propriété de pouvoir être facilement déterminés par notre représentation atomisante, sans pour autant qu’il soit certain qu’ils puissent servir de principe pour expliquer les associations dans lesquelles ils sont censés apparaître. Ce principe semblait suffisant du fait que les relations entre hommes étaient conçues comme purement spatio-temporelles : celles-ci devaient donc pouvoir être comprises à travers l’accumulation et l’interaction des unités. Mais ces relations n’ont pas lieu dans l’espace : l’espace ne joue pas le moindre rôle démontrable dans la compréhension mutuelle. Pour cette raison, toute représentation spatiale qui cherche à placer le fondement de la compréhension dans les individus pris en eux-mêmes doit être remplacée par une conception de la réalité qui les interprète collectivement. Une telle réalité est peut-être plus difficile à se représenter que des unités imaginées séparément dans l’espace, mais cela n’en fait pas nécessairement une construction artificielle. Elle est un fait réel certes très particulier mais qui existe vraiment et qui, une fois reconnu, nous contraint aussi à reconnaître, à côté des aspects individuels de la conscience, l’existence du général comme une réalité qui constitue le revers inséparable de l’individuel. Si l’on admet ce fait, il ne peut y avoir d’individualité donnée séparément de façon originaire : l’originaire est constitué plutôt par le flux de la conscience individuelle hors du général puis son reflux dans ce général. Il n’y a alors d’individuel, c’est-à-dire de conscience isolée, que ce qui s’est séparé volontairement du général ou a involontairement perdu le contact avec celui-ci. La réalité du général apparaît de façon surprenante dans la théorie phonologique, et il me semble que se trouve là son importance pour l’étude générale de la réalité, étude qui est bien sûr l’affaire de la philosophie.
Maintenant que l’existence du général a été à nouveau reconnue grâce à la théorie phonologique, il apparaît distinctement que l’ancienne phonétique et la psychologie était construite sur des présupposés qui ne reconnaissaient aucune réalité au général. Une conception isolante des choses n’admet le général que comme accumulation d’entités discrètes ou comme généralité logique, abstraite. L’évolution de la phonétique elle-même a conduit à dépasser le nominalisme : le général constitue pour la phonologie le fondement même des actes de parole et non pas seulement un résumé produit par la répertorisation et les calculs du chercheur. Il est d’ordre premier, il existe avant la particularisation par laquelle les actes de parole le détruisent. Le général prouve sa réalité en tant que principe d’ordre dans la multiplicité infinie des sons exprimés et en tant que fondement de la compréhension entre locuteurs. Comme il ne peut être question de compréhension sans le général, il faut donc comprendre qu’une conscience générale est réellement présente chez deux sujets ou plus qui cherchent à se comprendre réciproquement.
En tant que possession commune des interlocuteurs, le système des sons visés et compris est une réalité subjective mais non pas individuelle, il est le medium d’une compréhension qui elle-même n’est pas limitée à la réalité individuelle. Une théorie qui se placerait à l’extérieur de ce fait originaire de la compréhension ou qui, considérant ce fait comme secondaire, chercherait à l’éclairer à partir de facteurs plus originaires encore pourra argumenter que la compréhension mutuelle au moyen du système des sons du langage doit commencer une fois et que l’on rencontre effectivement un tel commencement lorsque les jeunes enfants acquièrent et apprennent le système qui les environne. Selon cette conception, on devrait pouvoir faire abstraction de tout aspect a priori de la compréhension, pour la faire reposer sur un principe empirique beaucoup plus simple : l’acquisition ou l’imitation. Lorsque l’on réfléchit sur l’évolution de la langue chez le jeune être humain, on peut initialement avoir l’impression que la compréhension résulte d’événements psychologiques simples : elle n’est alors pas le fondement de l’utilisation du langage, mais son résultat. Pour étayer ce raisonnement, on peut faire remarquer que les sons ne se produisent pas d’eux-mêmes chez le jeune être humain, mais qu’ils sont acquis d’après l’exemple de locuteurs déjà existants. Le danger d’une interprétation qui est séduisante par sa simplicité mais qui demeure en fait trop superficielle menace ici aussi. Pour l’observateur externe, l’adoption des sons de la langue par l’enfant donne l’impression d’être dominée par l’imitation et la formation d’habitudes. Mais ce qui n’est pas différencié pour l’observateur externe l’est parfois bel et bien dans l’analyse introspective. Cette dernière nous apprend que l’apprentissage du langage ne trouve pas un fondement suffisant dans la simple répétition. Il y a une différence interne d’intention lorsque l’individu qui apprend ne fait qu’imiter son maître en essayant de parler comme lui, ou lorsqu’il répète parce qu’il considère que celui-ci fournit l’exemple d’un usage correct. Dans un cas, on se limite à reproduire une individualité déterminée, dans l’autre le maître n’est pour l’élève qu’un intermédiaire vers le langage lui-même. On ne peut déceler cette différence de l’extérieur, dans la mesure où l’élève qui comprend qu’il n’imite pas son maître dans le seul but de l’imiter mais bien pour maîtriser comme lui le langage ressemble d’autant plus à son maître dans sa façon de parler qu’il se donne de la peine, non pas pour répéter ce que le maître dit, mais pour parler aussi bien que lui. L’observation externe peut constater l’influence immédiate du maître sur l’élève. Mais l’élève qui a répété ce qu’a dit son maître avec l’intention de maîtriser comme lui un système de sons linguistiques se sentira bien mal compris et déçu si on lui fait comprendre qu’il ne semble que répéter ce que dit son maître. Cette différence est subtile, elle est même incompréhensible pour l’observateur externe, mais elle doit être faite s’il l’on ne veut pas perdre de vue la signification plus large de la découverte de la phonologie. En effet, tout point de vue qui – interprétant de façon erronée la réalité interne du système des sons du langage – suppose que l’apparition de ces sons dans une certaine régularité est suffisante pour comprendre le langage, interprétera la nature intérieure des actes de parole dans une mesure toute aussi fausse et pensera dès lors que ces actes sont déterminées de façon suffisante par l’imitation et la formation d’habitude. Une telle conception, qui ne pénètre pas entièrement la réalité intérieure, correspond bien aux faits que les locuteurs ne possèdent pas a priori une compréhension qui fonde leur parole, que parler constitue la tentative d’atteindre cette compréhension et que cette tentative réussit dans une moindre mesure que ne se l’imaginent les locuteurs concernés. Dans cette conception, on n’accepte pas qu’il y ait une réalité commune au sein de laquelle les individus communiquent. La représentation s’en tient à la différenciation d’unités mentales bien démarquées et séparées dans l’espace, qui existent chacune pour soi et qui essayent d’entrer en contact l’une avec l’autre dans l’espace. Par son objectivisme, une telle conception empêche que la véritable réalité de la compréhension mutuelle devienne objet d’étude.
Posons-nous maintenant la question de la signification que cette nouvelle perspective peut avoir pour un autre domaine de la linguistique, la sémantique. Le passage de l’étude des sons à l’étude des significations exige d’être mieux fondé, car le danger d’une analogie erronée semble tout à fait possible. L’étude des sons, qui constituent la partie la plus externe du langage, n’a pas forcément un lien direct avec l’étude des significations, qui n’existent en effet que dans les intentions des locuteurs et la compréhension des auditeurs. La différence entre l’étude des sons et l’étude des significations présentée à l’instant découle encore de l’interprétation objectiviste qui fait des sons de simples bruits. Or, c’est justement la phonologie qui a établi un lien entre l’étude des sons et la sémantique, de sorte que l’on peut appeler le premier si ce n’est une sous-section, du moins une antichambre de l’étude des sons. Une tentative de relier ces domaines du langage avait déjà échouée dans le Cratyle, parce que Platon n’y différenciait pas suffisamment les notions de son et de mot. La tentative de Platon de comprendre la signification du mot à partir de la formation de significations qui viennent s’ajouter à des sons déjà formés n’a pas abouti : il interprète de façon erronée l’unité du mot et le type particulier d’ordre qui est exprimé par cette unité. On ne peut démontrer que les sons individuels possèdent une signification fixe dans le même sens que les mots : le son isolé n’est en effet pas un mot, de même qu’un mot isolé n’est pas une phrase. La linguistique contemporaine considère la tentative d’attacher une signification fixe à chaque son avec encore plus d’ironie que Platon ne le laissait déjà entrevoir dans son Cratyle. Mais cela ne veut pas dire pour autant que tout lien entre son et signification soit maintenant coupé. Il est clair que les sons ne nous prescrivent pas la signification du mot : dans ce cas, on ne pourrait plus alors nommer les choses selon notre libre choix. Les mots que l’on produirait en combinant des sons devraient être le résultat de significations déjà existantes. Nous sommes libres de nommer les choses et le langage accomplit son œuvre avec un arbitraire apparent justement parce qu’il n’y a pas de significations fixes qui valent pour les sons. Mais malgré cet arbitraire qui nous permet de nommer les choses par les noms qui nous plaisent, nous sommes quand même liés d’une autre manière aux sons. Les mots que l’on pense librement, nous les formons à partir d’unités sonores qui, elles, on ne pense pas librement : ce sont les phonèmes que le langage nous prescrit. Platon avait déjà isolé les phonèmes dans le Cratyle, mais il n’était pas clair pour lui qu’une valeur sémantique n’équivaut pas encore à la signification d’un mot. La phonologie a découvert la valeur sémantique propre des sons linguistiques. Elle se positionne ainsi entre la conception intenable de Platon qui traite sons et mots comme des choses semblables et la conception tout aussi intenable du pur objectivisme, qui ne voit dans les sons rien de plus que du bruit. Cette propriété des sons de n’être qu’un bruit est rejetée par la phonologie en même temps qu’elle désavoue la conception de la signification telle que Platon l’avait à l’œil lors de son étude des sons. En contraste à l’objectivisme, qui identifie son et bruit, la phonologie postule que dans la compréhension mutuelle entre locuteurs, les unités sonores ne sont pas entendues ou perçues, mais comprises. La perception correspond à l’optique du spectateur naturel, qui ce faisant prépare la voie à l’observateur scientifique. Dans cette optique, il s’agit de déterminer chaque correspondance et chaque nuance. Cette optique n’est toutefois pas celle d’une parole liée à une tâche. L’observateur est assimilé à l’auditeur, qui est d’un côté trop actif car il remarque trop de choses, et qui est trop peu actif de l’autre car il ne partage pas l’intention de compréhension mutuelle qui caractérise le locuteur. De plus, ce n’est pas à l’appareil auditif du partenaire de conversation que s’adresse le locuteur. L’appareil auditif est indifférent à la compréhension : en lui-même, il n’entend que des bruits. Seule l’écoute orientée vers la compréhension perçoit les sons du langage. Plus approximativement, on pourrait dire que la perception est assistée dans l’écoute, par exemple par la fonction de la compréhension. Cela signifierait que ce que l’on entend en tant que tel resterait un élément à comprendre dans une relation entre écoute et compréhension. Mais cette relation ne remplace pas la compréhension. En effet, celle-ci est une écoute dirigée vers un but qui convertit immédiatement ce qui est entendu : ce qui est entendu n’était pas donné ainsi avant la compréhension, pas plus qu’il ne demeure reconnaissable comme élément distinct au sein de celle-ci. L’écoute dirigée vers la compréhension ne se soumet pas d’abord à une impression mais cherche immédiatement à reconnaître des sons selon les schémas que lui fournit le système des phonèmes.
La compréhension des sons du langage est donc fonctionnellement différente de l’écoute de bruits. La différentiation de la compréhension se manifeste aussi dans le cas des mots. Porté par une intention qui le rend reconnaissable, le son du langage est compris tel qu’il est visé et il appartient dès lors déjà à la sphère sémantique. La différence avec les mots est toutefois présente, cela de façon autant fonctionnelle qu’objective. Les quelques dizaines de phonèmes qui constituent une langue ne se situent pas à côté du domaine sémantique, mais en son sein. En tant que plus petites unités de la compréhension, leur nombre est limité, mais il est aussi suffisant pour construire un monde d’unités supérieures qui suivent leurs propres lois. Les pierres angulaires de ces unités partagent cependant avec elles la propriété d’être des moyens de la compréhension mutuelle. Malgré ce qu’ils ont en commun, il est aisé de souligner ce qui les différencie : les phonèmes possèdent leur signification en eux-mêmes, ils ne sont pas des bruits qui font penser à autre chose et avec lesquels ont peut viser quelque chose, ils sont au contraire des unités d’intention et d’apparition, si habituelles et reconnaissables que la différence entre locuteur et auditeur en est oubliée. Le phonème d’une langue étrangère ne se présente comme un bruit que là où il n’y a pas de communauté entre locuteur et auditeur, auquel cas on entend alors un phonème de sa propre langue auquel le phonème étranger ne correspond pas.
Les mots aussi possèdent cette propriété connective dans leur opération immédiate entre les locuteurs. Mais dans leur cas, on peut en tout temps distinguer entre une formation phonétique et une unité de signification, une différence qui n’existe pas dans le phonème. C’est bien pour cela que le phonème fonde la compréhension des locuteurs plus profondément que le mot.
Il y a peu d’espoir d’obtenir une explication causale de la propriété du langage qui fait que la formation jamais terminée de mots et leurs associations se maintiennent en équilibre sur la base restreinte de quarante phonèmes. Une telle explication devrait postuler que les phonèmes sont créés un à un. Mais l’étroite connexion de réciprocité dans laquelle ils se situent mutuellement s’y oppose. Le raisonnement causal tente de penser séparément les moments d’une séquence dans laquelle une chose a du existé avant l’autre et la totalité a été la dernière à être créé. L’unité fermée du système des sons s’oppose à ce point de vue. Il est tout aussi difficile de s’imaginer que les phénomènes aient été produits par un locuteur qui les aurait imposés aux autres : les phonèmes se présupposent réciproquement et ils présupposent collectivement la compréhension mutuelle. Celle-ci a dû exister avant que les sons puissent apparaître en tant qu’organes de la compréhension mutuelle. Le fait qui s’oppose le plus à toute interprétation causale est toutefois que les phonèmes ne sont jamais donnés isolément, mais seulement dans les mots, qui eux sont toujours formés à partir de phonèmes. Ici justement, on ne peut pas parler d’une antériorité ou d’une postériorité des pierres angulaires ou de la structure. Il n’y a pas de stade auquel le langage ne possèderait que des phonèmes, pas plus qu’un stade auquel il y aurait des mots qui ne seraient pas formés à partir de phonèmes : il y a une réciprocité de la partie et du tout qui ne se laisse pas interpréter selon un ordre temporel.
Là où une analyse causale n’a que peu de prise sur les phénomènes, il y a de la place pour une analyse téléologique. La limite de la compréhension causale par séquence ne correspond en effet pas à la limite de nos intuitions : il existe encore la simultanéité de la structure. Il ne s’agit ici que de trouver le modèle de compréhension le mieux adapté aux phénomènes. Dans ce cas-ci, le modèle doit être le point de vue de la téléologie et de l’organisme. La création du langage n’est pas un processus conscient qui prend sa source dans les individus. L’expérience individuelle nous apprend que nous parlons, c’est-à-dire que nous maîtrisons une langue que nous n’avons pas créée et que nous trouvons déjà donnée. Ce fait ne permet pas de conclure qu’une friction ou une accumulation aveugle de forces ont créé le langage. Il existe d’autres possibilités que la nécessité purement mécanique et l’initiative consciente de l’être humain. Dans la nature organique, le concept d’une régularité téléologique inconsciente est tout à fait acceptable, elle est même nécessaire. Si l’on comprend par là non seulement l’arrangement des parties d’un organisme, mais aussi la coïncidence de l’organisme avec la nature environnante et avec ses congénères, il n’y pas de raison que ce même point de vue ne nous guide pas lors de nos considérations sur la construction du langage. Si celui-ci est un organe de compréhension mutuelle et non pas un système de signes créé par consentement arbitraire, alors nous pouvons le considérer comme l’organe efficace d’une relation fonctionnant tout aussi efficacement entre les hommes et englobant les individus séparés. Nous savons moins comment un tel organe efficace est apparu que comment il est organisé : il en va ainsi pour tous les organismes. L’organisation efficace du langage consiste ainsi en une construction de phonèmes qui appartiennent toujours déjà à la sphère sémantique, mais qui ne sont pas encore des significations. Leur efficacité nous apparaît clairement si on essaye de s’imaginer qu’il pourrait en être autrement. Il suffit de comparer les systèmes de sons naturels aux unités sonores artificielles à partir desquelles les auteurs de langues artificielles se basent pour représenter des catégories sémantiques déterminées. Ceux-ci sont confrontés à la difficulté que de telles unités ne peuvent pas être déterminées avec une unanimité générale et que, par-dessus le marché, on ne peut déterminer comment reconstruire les concepts connus à partir de ces unités. Les utilisateurs d’une langue qui se baseraient sur une soi-disant signification conceptuelle des phonèmes devraient mener une analyse réflexive continuelle au sujet de la composition des concepts. Cette réflexion les freinerait considérablement dans leur emploi du langage ; de plus, il resterait encore à montrer que ces concepts se laissent vraiment reconstruire à partir de principes fixes. D’un point de vue analytique, ce n’est donc pas un désavantage que de ne pouvoir réduire les significations utilisées dans le langage à des unités fixes, afin ensuite de toutes les comprendre comme une composition. Que cette possibilité fasse défaut serait plus sérieux si elle était la condition d’une compréhension rationnelle des locuteurs. Que cela ne soit pas le cas démontre que la compréhension mutuelle n’a pas besoin du détour d’une conscience analytique-synthétique de toutes les significations utilisées.
L’efficacité de l’organe du langage semble donc résulter d’une construction en deux strates : les sons, qui ne sont plus des bruits mais des unités qui se répètent pour la compréhension, et leurs combinaisons, qui possèdent d’autres qualités que celles des éléments. Les deux strates vont cependant de pair et la transition du phonème, qui se signifie lui-même, au mot, qui ne se signifie pas lui-même mais bien autre chose, n’est pas si grande si l’on considère, d’une part, que les mots sont toujours composés de phonèmes, et surtout d’autre part, que les significations qui sont créées par la concaténation de mots dans des combinaisons ou phrases complètes sont aussi remarquablement différentes des significations des mots combinés. L’idée bien connue qu’un tout possède des propriétés qui sont étrangères aux parties est confirmé autant dans la transition des plus petites unités aux mots que dans la transition de ceux-ci à des groupes de mots et à des unités plus grandes encore.
Si la transition des phonèmes aux significations est nivelée de sorte que les premiers semblent appartenir à la sphère sémantique, on satisfait alors un besoin de compréhension qui restait inassouvi tant que la linguistique se représentait les sons et les mots comme étant séparés par un abîme. C’est la phonologie qui a réalisé ce nivellement. La phonétique qui la précédait menait au mal opposé à celui qui oppressait le Cratyle de Platon : elle avait trop séparé les deux domaines l’un de l’autre, alors que Platon pensait pouvoir les unir.
On peut donc désormais à nouveau demander jusqu’à quel point il est possible d’admettre l’analogie entre les sons du langage et les significations des mots. De fait, elle paraît acceptable. Mais la théorie des sons est en avance sur celle des significations : en général, la sémantique se trouve encore au stade de l’ancienne phonétique. En effet, elle n’a pas encore accepté ou n’accepte plus l’attitude introspective qui a promu l’étude des sons depuis une activité de répertorisation chaotique et interminable jusqu’à une science bien ordonnée. L’étude des significations est encore par trop dominée par le point de vue externe et objectiviste qui est utilisé avec tant de difficultés par l’ancienne phonétique. On voit même des philosophes de la sémantique adopter le point de vue selon lequel les significations des mots doivent être considérées séparément de leur emploi dans le même mot, et que tout emploi est individuel et différent, de sorte que non seulement il n’y a pas de continuité pour le même locuteur, mais a fortiori il n’y a pas d’accord entre l’ensemble des locuteurs. Pour un tel objectivisme, l’accord que les locuteurs pensent pourtant pouvoir constater ne représente fréquemment qu’une illusion dont ils ne se rendent pas compte par eux-mêmes mais qui est remarquée par l’observateur objectif, à qui il revient alors aussi de l’expliquer. Il en est alors comme avec les sons : l’utilisateur postule selon son opinion subjective que de nombreux sons utilisés sont en fait les mêmes, mais l’observateur découvre leur diversité. Dans le domaine des significations, les coïncidences ne sauraient donc être que des illusions. Une fois l’insuffisance de l’emploi habituel du langage démasquée, l’observateur objectif veut développer un système de concepts bien définis, afin d’échapper à cette illusion. Ce qui a conduit à démasquer des coïncidences illusoires était une méthode basée purement sur la perception externe, laquelle cherche à déterminer une à une les significations visées par les locuteurs individuels, sans faire par là usage de l’introspection.
Diverses interprétations contemporaines des significations des mots partent de principes nominalistes qui ne prêtent au général aucune réalité équivalente à celle du particulier. Qu’ici non plus on ne tire toutes les conséquences de cette théorie est à mettre au compte de l’heureux instinct qui retient le chercheur. En effet, le chercheur travaille inconsciemment avec le général, il accepte dans sa conduite ce qu’il rejette consciemment en théorie. Face à cette inconséquence, nous demandons s’il n’en va pas avec les significations des mots comme avec les phonèmes, c’est-à-dire que la réalité du général est ici aussi valable. D’un point de vue objectiviste, il faut répondre négativement à cette question. Dans une approche introspective du monde de la signification, en revanche, on y répondra par l’affirmative. De même que, pour l’objectivisme, des moyennes se profilent dans le flux sonore sans pour autant qu’on puisse fournir une raison à cela, on pourra constater par une observation externe une certaine régularité dans le comportement sémantique du locuteur. Comme on ne peut parler ici de significations dans un sens introspectif, il en résulte qu’on doit alors rechercher cette règle dans les comportements qui accompagnent l’utilisation des mots et, de plus, que ces comportements doivent être définis comme les significations fixées scientifiquement de ces mots. La théorie behavioriste postule ainsi que l’observation du comportement exprime de façon plus objective le sens des mots que ne le fait la conscience du locuteur. Mais, abstraction faite de la question de savoir s’il est possible d’associer toutes les utilisations d’un mot avec les comportements réguliers qui leur correspondent, il semble que le langage dans lequel ces observations sont couchées puis modelées théoretiquement introduit à son tour des significations qui ne valent provisoirement que de manière subjective pour leur utilisateur et qui pour cette raison justement devraient être soumises elles aussi au procédé d’objectivation. Selon cette observation, la théorie qui devait servir à fixer les significations utilisées par autrui devient elle-même douteuse : elle introduit des présupposés dont elle anticipe la validité alors qu’ils ne devraient être admis qu’après vérification. Des présupposés similaires se manifesteront tant que les chercheurs élaboreront des théories : ils doivent en effet utiliser des mots auxquels ils attribuent intuitivement une signification alors pourtant que la détermination objective de cette signification attend une observation extérieure par autrui, et ainsi de suite à l’infini.
Une autre difficulté à laquelle est confronté un traitement objectiviste des significations tient au fait qu’il présuppose que de très petites différences se manifestent entre l’intention du locuteur et l’auditeur mais ne sont pas remarquées dans la compréhension mutuelle. Dans la mesure où elles augmentent dans une direction déterminée, ces différences devraient au final induire des changements de signification notables. La mesure quantitative qui est présupposée ici était peut-être adaptée, en un certain sens, aux sons, mais elle ne se laisse que difficilement appliquer aux significations. En effet, la structure des significations fait que l’on ne peut pas parler d’un plus ou moins, d’une quasi-relation entre significations, mais uniquement d’apparentement et de différence. En plus de cela, il faut ajouter que l’on ne peut pas se représenter grand chose quant à des présumées moyennes de signification. La moyenne exprime de façon peu adéquate la généralité d’une signification, à peu près comme une moyenne de sons enregistrés ne correspond pas à un phonème. Une sémantique qui part d’une observation inductive des significations doit ainsi prendre refuge dans la notion de moyenne ; de cette manière elle ne découvre pas plus de significations générales qu’une phonétique travaillant par répertorisation ne découvre de phonèmes. Il n’y a pas non plus de transitions arbitraires ou arbitraires en nombre entre les phonèmes, car cela rendrait illimité le nombre de phonèmes et aucune structure de compréhension mutuelle ne se laisserait alors construire sur la base d’un nombre infini de phonèmes. La structure sémantique des phonèmes apporte une différenciation qualitative qui exclut les transitions graduelles et les formes intermédiaires. Cette même logique qualitative est aussi adaptée aux significations de mots. L’introspection vient la soutenir de la même manière que dans le cas des phonèmes. En effet, l’introspection ne découvre pas le phonème en tant qu’objet de la conscience individuelle d’un locuteur déterminé, mais comme un objet général et identique vers lequel se dirigent les différents locuteurs collectivement. Dans la perspective objectiviste, les objets se morcellent en autant de choses qu’il y a de locuteurs, sur la base de la distinction de ces sujets dans l’espace. Cette représentation réduit la réalité des significations, tout comme elle le fait avec celle du phonème. En effet, dans la mesure où les sujets individuels a et b atteignent une compréhension mutuelle au moyen de significations, ils ont conscience de l’identité des significations que chacun d’entre eux utilise. Cette conscience ne fait place au doute que lorsque des raisons particulières se présentent. La généralité reconnue des deux parts constitue le revers de la compréhension mutuelle elle-même. Moins cette généralité est remise en question par les sujets a et b, moins la compréhension entre eux sera contestée. Pour les locuteurs et les auditeurs, elle ne représente pas une croyance ou une impression que l’analyse objective redéfinit comme une illusion, mais bien une réalité qui ne s’estompe pas, quand bien même une définition plus poussée des significations employées semble requise par une apparente différence d’intention. En effet, cette définition s’accomplit sur la base de l’unité plus profonde encore qui existe entre d’autres significations par rapport auxquelles les sujets s’orientent collectivement. Ainsi, la généralité des significations est un fait premier : on ne déduit pas qu’elle existe, elle est présente avant toute compréhension. On ne déduit l’être-individuel de significations déterminées, autrement dit la non-généralité des significations, que dans des cas déterminés.
La généralité donnée de façon première existe à deux égards : d’une part pour l’utilisateur lui-même qui n’utilise pas les significations au cas par cas mais selon une règle qui dépasse les cas isolés de l’usage, et d’autre part, comme organe collectif de la compréhension mutuelle pour qui, de nouveau, le sens de l’usage n’est pas fixé au cas par cas. Si cette double généralité – qui est implicite dans tout usage du langage et qui dépasse autant les usages momentanés des mots que la sphère individuelle de leur emploi – n’était saisissable que comme intention subjective, alors il serait correct d’affirmer que l’on peut déduire de l’observation que la généralité n’existe pas « en réalité » car, en effet, il apparaît que l’utilisateur ne s’en tient pas à la signification générale et que ses interlocuteurs ne la saisissent pas comme lui. Cette assertion est cohérente avec l’expérience, qui nous apprend que l’on n’en reste jamais à l’intention de généralité car celle-ci doit également être réalisée. Le subjectif et la réalité coïncident ici, excepté dans certains cas d’incompréhension et de doute qui se présentent dans la réalité effective de la compréhension. La généralité des phonèmes et des mots n’est ainsi pas limitées à l’intention et à l’interprétation des sujets qui les utilisent, mais elle constitue le revers inséparable de la compréhension elle-même. De cette dernière, on ne peut vraiment pas dire qu’elle ne soit qu’une interprétation subjective des locuteurs et ne possède donc pas de réalité : elle est justement la réalité qui englobe de façon première les sujets et au sein de laquelle peuvent apparaître le doute, l’incompréhension et les différences d’opinion.
Toute orientation nominaliste qui exige pour la détermination définitive des significations une connaissance de tous les cas de leur emploi impose à la sémantique une tâche aussi impossible à réaliser que celle à laquelle était confrontée la vieille phonétique. Une telle recherche transforme son propre objectif en une illusion. Elle espère arriver à un résultat qui doit être consciemment présupposé et elle méconnait la réalité de la conscience du général dans l’individuel ainsi que le retour permanent de la conscience individuelle à sa source collective qui s’accomplit autant dans l’usage du langage que dans d’autres formes de compréhension mutuelle. Une étude des significations se doit d’être une étude des significations générales, de même que l’étude des sons du langage s’est imposée comme une théorie des phonèmes généraux. La généralité à produire ici n’est pas la généralité obtenue par la somme de moyennes, il s’agit plutôt du réel comme forme dans laquelle s’accomplit la communication. L’orientation vers le réel fait qu’un auditeur peut entendre par-delà les sons réalisés individuellement par son interlocuteur, de même qu’un étranger est compris malgré les différences de prononciation et d’emploi des mots.
Cette même généralité joue un rôle dans les formes de cohabitations dans lesquelles le langage n’est qu’un organe subordonné. La logique méconnait la réalité du général si elle caractérise la compréhension humaine ou la culture comme le domaine de ce qui est unique et ne se répète pas. Il est aussi vrai de la nature qu’elle est unique et qu’en elle aucune constellation de faits ne revient jamais. Alors que cependant, la généralité de la nature reste une régularité supposée qui doit sans cesse être soumise à vérification ; la généralité de la compréhension humaine est justement une réalité immédiate : elle n’est pas construite logiquement à partir d’observations, mais elle est donnée concrètement. Voilà l’importance de la redécouverte du général pour les sciences humaines, dont la phonologie est un paradigme. Elle a libéré la logique de ces sciences du joug de la méthode des sciences naturelles qui exerce une observation aussi externe que possible de leurs objets pour ensuite classifier ses observations par généralisation. Le chercheur en sciences humaines fait également des observations, mais il descend en lui-même pour avoir accès à son objet d’étude. Là, il rencontre d’abord la réalité non-spatiale de sa propre conscience, puis, plus profondément, une union dans une réalité collective avec d’autres consciences qui trouvent leur expression dans des formes générales de comportement. Cette réalité a des strates plus profondes que le langage. La généralité des phonèmes et des significations des mots n’est pas une abstraction logique mais une forme de compréhension mutuelle entre des locuteurs dont la singularité est dépassée : les consciences ne sont pas des objets idéaux concentrés sur eux-mêmes, ils s’entremêlent. Et pourtant la réalité du général n’annule pas celle du singulier, de l’individuel. On ferait en affirmant cela la même erreur qui est reprochée au nominalisme dans la direction opposée. La discussion sur le général comme forme logique de hiérarchisation des objets de la nature pourra probablement être clarifiée, maintenant qu’il est évident comment cette forme est apparue, par transfert hors d’une généralité qui trouve son origine en tant que réalité dans l’expérience humaine. La question qui domine la relation entre sciences de la nature et de la culture n’est donc pas comment la généralité de la connaissance des objets naturels a été transférée vers les sciences humaines, mais au contraire, comment la généralité de la compréhension mutuelle que nous connaissons au travers de l’expérience humaine peut légitimement nous conduire à un schéma logique des sciences naturelles.
(1938) "Phonologie en betekenisleer", Mededeelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 113, pp.577-600.