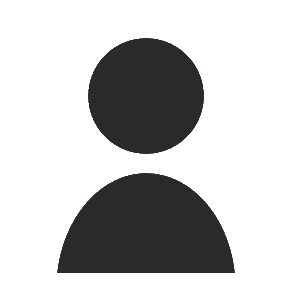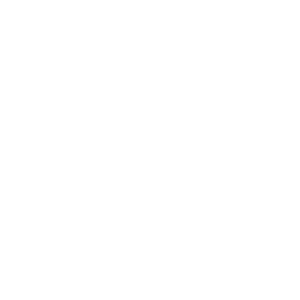This document is unfortunately not available for download at the moment.
Le verbe et son rôle dans l’expression de la pensée
Hendrik Pos
pp. 143-156
Quand on considère l’ensemble des mots de nos langues civilisées, on voit naturellement des groupes se dessiner qui, chacun, réunissent certains mots d’après des propriétés morphologiques et sémantiques. Ainsi on trouve les catégories du substantif, de l’adjectif, du verbe et de la particule. Ces catégories ne signifient pas seulement des groupements qu’une grammaire historique et peut être surannée nous a transmis, ce sont des distinctions qui s’imposent à l’esprit du linguiste, et, qui plus est, qui vivent et sont senties dans la conscience des plus simples sujets parlants.
La linguistique actuelle est d’accord à reconnaître que ces catégories ne coïncident pas avec celles de la pensée. Le symbolisme de la logique contemporaine est là pour prouver combien loin les symboles de la langue traditionnelle sont d’être l’expression adéquate de la pensée. La logique linguistique d’autrefois n’a pas vu, il est vrai, l’autonomie des symboles logiques, leur indépendance du langage, qui n’est souvent que le véhicule primitif de la pensée collective. Mais ce serait une erreur pas moins grave que ne fut celle du parallélisme inconsciemment accepté que de vouloir nier tout rapport entre les cadres de la pensée et ceux de la langue. Qu’on n’oublie pas que la pensée qui abandonne le symbolisme naturel que lui offre la langue n’est que la pensée aiguisée du logicien, qui se débarrasse de sa dépouille au moment où elle se dépasse en précision, moment auquel elle abandonne également son caractère multiple de moyen d’expression de la volonté, du sentiment et de la pensée pour tendre uniquement vers l’expression de la pensée logique.
Donc, il y a rapport entre les catégories de mots et celles de la pensée, de cette pensée, bien entendu, qui est nichée dans la vie quotidienne, qui mène la conscience naturelle, celle qui s’exprime dans le langage que la collectivité lui fournit sans s’inquiéter.
Il n’est pas possible de déduire les catégories linguistiques. Cependant elles ne sont pas contingentes, ni dans leur structure individuelle, ni dans leur cohésion intime. Qu’une langue soit pauvre en adjectifs, comme l’hébreu, ce n’est pas dire que la catégorie de l’adjectif manque, seulement elle est peu développée. Pourtant l’emploi de cette langue impose l’expression de rapports adjectivaux, pour lesquels les adjectifs manquent. Que fait la langue dans un cas pareil ? Elle fait des substituts qui valent fort bien. Elle formulera : roi de justice, pour roi juste, pas autrement que le français exprime à valeur à peu près égale : personne âgée = personne d’un certain âge. Ici c’est le substantif abstrait qui vient au secours où l’adjectif manque. Quand on s’imagine ce procédé de substitution poussé très loin, on voit l’adjectif comme catégorie être absorbé par le substantif se combinant avec un autre substantif. On voit l’adjectif disparaître, et en même temps on s’imagine assister à l’évolution qui a pu donner naissance à la distinction du substantif et de l’adjectif et partant à la constitution même de l’adjectif-catégorie.
D’autre part, et inversement, certains adjectifs prennent très facilement le rôle du substantif qui manque, surtout du substantif abstrait. Supposons une langue privée de mots abstraits comme rougeur, justice, vieillesse : est-ce que ces abstraits ne se remplacent pas convenablement par : le rouge, la couleur rouge, l’acte juste, l’état âgé ? Inutile d’objecter, que le rouge, la couleur rouge, et la rougeur sont des nuances synonymiques, qui ne signifient pas exactement la même chose. Ces nuances sont devenues possibles grâce à l’abondance de dérivation qu’offre une langue bien développée. Si elles servent à distinguer seulement, cette fonction se limitera aux cas où de telles subtilités sont exigées par le contexte ou la situation.
Les prépositions semblent bien constituer une classe à part. Mais quand on les supprime en s’interdisant leur emploi, la pensée linguistique ne saurait rester dans l’embarras et comme privée d’un organe indispensable à son fonctionnement. La relation avec, par exemple, se laisse exprimer à l’aide du substantif-adjectif : compagnon, la préposition de est la plupart du temps superflue, le contexte indiquant tout seul les rapports sémantiques que de semble marquer ; sur a des équivalents dans des participes comme dépassant, pressant, etc., bref, même cette catégorie si indépendante et irremplaçable en apparence, montre des affinités qui en effacent l’isolement quand on la voit de plus près. Et si l’on considère les prépositions comme un groupe subordonné des particules on remarquera qu’il en est de même avec les autres particules, les conjonctions par exemple se remplaçant par des formes verbales comme : supposez, il sera.
Donc il y aurait empiètement de toutes les catégories linguistiques les unes dans les autres. Cela ne signifie pas cependant qu’à l’état où sont nos langues tous les mots d’une catégorie se remplaceraient par des termes des autres, ni même que tous ceux qui se remplacent se remplacent également bien. Chaque catégorie a sa région périphérique de mots par laquelle elle se confond avec les autres, et son noyau qui en constitue la substance propre. Par conséquent, aucune catégorie ne se laisserait entièrement représenter par le moyen des autres, aussi ce n’est qu’approximativement qu’on s’imagine l’origine d’une catégorie linguistique en se basant sur l’état historiquement donné des langues.
La catégorie du verbe est la plus puissante parmi toutes. Si les autres groupes de mots rappellent des planètes solitaires, le verbe est tout un système, un soleil avec des satellites à lui-même. Au dedans de son domaine toutes les autres catégories sont représentées : le substantif par l’infinitif, l’adjectif et le substantif par le participe, qui fournit même des particules par des formes comme : durant, pendant, vu que. Le verbe, en effet, est un microcosme dont l’articulation interne reflète le système entier duquel il constitue lui-même une monade. En plus, il est un outil plus différencié que tous les autres en ce que, par la seule variation des désinences, il est capable d’exprimer les personnes, les temps, les modes, l’actif et le passif. La plus caractéristique de ses propriétés est la capacité d’exprimer le temps. Mais le temps que marque proprement le verbe n’est pas celui qui se divise en présent, passé et futur. Ce temps-là est marqué, il est vrai, par le verbe également, mais cette fonction est prise, le cas échéant, aussi bien par l’adverbe. On n’a pas besoin de la forme verbale du temps pour dire ce que la circonscription par puis, alors, maintenant, bientôt, présente à l’esprit.
Le temps qui est marqué par les désinences et par les alternances vocaliques n’est pas le seul facteur temporel constituant le verbe. Ce temps-là pourrait ne pas être exprimé et cependant le verbe garderait son caractère distinctif, le thème verbal à lui seul exprimant un acte, un mouvement, un devenir, bref, quelque chose d’inextricablement lié au temps. Un groupe de quelques consonnes, une simple voyelle parfois suffisent pour évoquer dans la conscience linguistique un phénomène dont l’intuition se compose de toute une série d’événements et dont les termes premier et dernier sont souvent de nature diverse, pendant que les phases intermédiaires constituent une répétition – peu définie – d’images assez homogènes. En analysant les facteurs composant le plus simple événement temporel et en les comparant à leur expression linguistique on est frappé par la différence entre la simplicité du signe et la complexion du signifié. Aussi on se demande par quelle évolution la pensée linguistique a pu aboutir à un artifice de ce genre. Ainsi conçu, le verbe serait le terme d’une évolution ; d’autres catégories sont supposées avoir existé avant lui, sur lesquelles il aurait pu se greffer pour prendre ensuite un développement indépendant. Pareille supposition donne le primat au nom – soit substantif, soit adjectif – et il s’agirait donc de rendre acceptable la genèse du verbe par une construction qui prend pour point de départ l’existence du nom.
Pareille hypothèse ne saurait se borner à l’explication de faits linguistiques. Forcément elle étendrait ses déductions jusqu’aux intuitions mêmes des choses et des mouvements. En essayant de comprendre le verbe par le substantif, elle devra construire l’intuition du mouvement à l’aide de celle des choses ou peut-être de celle des choses et de leurs aspects momentanés représentés linguistiquement par l’adjectif. Est-ce que cette construction est possible ? Nous voilà au cœur même du problème de la possibilité du mouvement.
On sait que ce problème n’est pas nouveau. Pris de son côté symbolique il remonte jusqu’à Platon, qui a établi le verbe et le nom comme deux coordonnées fondamentales, entre lesquelles ce penseur ne se soucie aucunement de choisir une antériorité. Le dix-huitième siècle ayant donné une précision nouvelle aux anciens problèmes spéculatifs en les confrontant avec l’expérience et le savoir empirique, Herder dans son Traité sur l’origine du langage l’a posé de nouveau et lui a donné une solution nette en prononçant le primat du verbe. Dans l’édition Taschenausgabe der philosophischen Bibliothek, fasc. 13, Herder’s Sprachphilosophie, Meiner, Leipzig, on lit aux pages 11 et sv. : « Aussi, le premier vocabulaire se composait des sons de toutes choses. Chaque être sonore fit résonner son nom ; l’âme humaine l’empreignait de sa marque en prenant le son comme propriété. C’est ainsi que ces interjections sonores devinrent les premiers noms. Aussi les thèmes radicaux des langues orientales sont pleins de verbes. L’idée de la chose flottait encore entre l’agissant et l’acte. Le ton devait signifier la chose ainsi que la chose offrait le ton. C’est ainsi que des verbes provinrent les noms et non pas les verbes des noms. L’enfant ne nomme pas le mouton en tant que mouton, mais en tant qu’être bêlant. En faisant ainsi l’interjection-verbe... quand la nature entière produit des tons, à l’homme primitif et sensuel rien de plus naturel que de tout voir vivre, parler, agir. Les premières dénominations des choses ne furent donc que les sons reproduisant les actes que l’esprit primitif sentait dans chaque chose. »
Cette hypothèse de Herder est fort captivante, mais elle rencontre de sérieuses objections. Pour ce qui est de l’origine des noms, qui seraient provenus de verbes, quand on serre la question de plus près et l’on met ensemble les noms qui sont manifestement d’origine verbale, on voit qu’on n’épuise pas le répertoire nominal. Il reste des noms dont l’étymologie s’oppose à toute réduction au verbe. Or, il est possible de supposer que dans ces noms-là le caractère originaire ait été effacé. La difficulté de les réduire à des verbes ne tiendrait qu’à notre ignorance. Mais si on suppose celle-ci écartée, un autre embarras, plus grave, apparaît : le verbe lui-même, qui aurait devancé le nom, comment était-il possible ? Est-ce que, pour surgir dans la langue, il ne lui a pas fallu d’un matériel, qui ne pouvait être un verbe ? Et de quel autre matériel le verbe aurait-il emprunté sa forme linguistique si ce n’est du matériel des noms ? Il est vrai que le langage a pu commencer par la désignation de ce qui pragmatiquement était le plus nécessaire, des actes, et qu’originairement parmi les actes ont été exprimés les plus instantanés, le besoin, la commande, l’impératif. Mais l’acte, pour prendre forme linguistique, devait se distinguer de l’autre acte. Et comment cette distinction s’établirait-elle, si ce n’est par le moyen de facteurs qui ne constituent pas la nature commune de chaque acte, mais qui en représentent les traits particuliers ? Comment en effet, par ces traits, les actes se distingueraient-ils, si ce n’est par les objets sur lesquels ils se dirigent ?
Nous voici donc dans un cercle vicieux : les noms, pour devenir possibles comme catégorie linguistique, supposent les mouvements ; ces derniers ne peuvent être symbolisés par les verbes sans que des éléments de caractère non-mobile y prêtent leur aide. Le fixe est le support du mobile, le mobile, qui devait servir pour expliquer l’origine du fixe, a en ce dernier même sa condition d’existence. Le mouvement ne sera jamais sans un facteur stable qui permette de le discerner comme tel, il sera toujours mouvement de quelque chose, et la chose qui se meut d’une part et le mouvement d’autre part resteront des entités séparées.
À cette connexion intime du fixe et du mobile vient se joindre un fait linguistique qui paraît en fortifier l’évidence. Il existe dans nos langues, à côté des verbes, certains substantifs exprimant le même concept, mais sous forme nominale. Parfois ces substantifs sont des dérivés, et dans ces cas le primat du verbe est évident : p.ex. production, produit exprimant la même chose que produire, mais en termes substantivés. Cependant il y a d’autres cas où historiquement et morphologiquement c’est le substantif qui est plus ancien p.ex. lat. verber, dérivé verberare. Ici une distinction s’impose : le substantif peut être antérieur au verbe, mais c’est seulement en se verbalisant qu’il prend un sens mobile. Quand p.ex. pugnus,signifiant le poing, donne le dérivé pugnare, le sens verbal n’est pas tiré du substantif-base, il s’introduit avec la forme verbale même. Également, quand l’ancien substantif verber = branche, verge, donne le dérivé verberare = battre, l’élément verbal est introduit par la forme verbale même. Mais quand le dérivé pugnare a donné lieu postérieurement à un substantif pugna, on dirait que la conscience linguistique a éprouvé le besoin de donner à pugnare un substantif qui pourrait être considéré comme la base de la formation de ce verbe. Dans ce cas-là, le sens du substantif, antérieur au verbe en apparence, est également verbal. Pugnus et pugnare se distinguent comme l’instrument et l’action ; pugnare et pugna indiquent la même action sous deux catégories différentes.
Donc, le substantif à sens verbal et le verbe se confondent dans l’histoire de la langue. Ils constituent des doublures, dont la raison d’être échappe à la considération historique d’un procédé de formation qui a fait naître l’un ou l’autre et où tantôt le verbe tantôt le substantif a été le premier, priorité qui est souvent effacée par la conscience linguistique.
Pour la conscience synchronique et immédiate la différence entre le verbe et le nom est tellement sensible qu’on n’a même pas besoin d’opposer un verbe de thème verbal à un nom de thème nominal pour l’illustrer. La différence nettement sentie entre chasse et chasser, amour et aimer, et même entre des termes qui extérieurement sont identiques, mais qui représentent tantôt un verbe, tantôt un nom, s’explique non pas comme reflet des différences entre des contenus supposés être indépendants de la langue – et qui sont à la rigueur tous identiques ou bien des éléments indissolublement enchaînés du même objet – mais par les fonctions différentes de ces mots et les rapports différents qu’ils ont envers d’autres mots du système d’une langue. Prenons un cas d’identité extérieure comme lat. amor = amour, et amor = je suis aimé. Or, nous prétendons que la possibilité de discriminer entre deux sens de ce terme tient uniquement à l’appartenance de chaque sens a un système, soit verbal, soit nominal. Cette appartenance n’est pas un schéma théorique où la science grammaticale rangerait les faits linguistiques, c’est une réalité particulière qui détermine l’emploi momentané de chacun de ces termes. On dirait que chaque emploi d’un élément du système verbal ou nominal n’est que le point du filet que le sujet parlant touche dans son activité momentanée, mais qui met en vibration l’ensemble de tous les éléments, image par laquelle on entend que, quand un sujet parlant choisit une certaine forme nominale ou verbale pour l’appliquer, tout le reste du système auquel cette forme appartient y participe. Il fait part de cet emploi premièrement en tant que distinct de la forme en question, comme reste momentanément exclu de l’emploi, mais aussi en tant que complément qui donne son sens distinct à la forme choisie. C’est ainsi que dans la seule forme verbale amor le système verbal entier du latin est représenté. C’est exclusivement la première personne, mais celle qui fait partie du groupe de distinctions personnelles, représentées par différentes désinences. Également pour la forme passive, pour le présent, l’indicatif. Bref, chaque détermination de la forme amor constitue une relation de cette forme qui la rattache au système formel du verbe, chaque forme, ainsi conçue, n’est que l’envers de toutes les autres, du système entier. Aussi, autant plus de facteurs sémantiques une forme verbale contient, d’après autant plus de points de vue l’orientation qui l’a destinée à l’emploi a dû se faire, autant plus d’autres formes coordonnées et comme concurrentes ont dû être entrevues et écartées.
Le nom est en principe dans le même cas que le verbe, seulement sonsystème est moins riche. Cependant, pour en rester à la langue latine, dans chaque cas de son emploi, il est au singulier ou au pluriel, il a un genre distinct, il est placé dans un cas, soit marqué extérieurement par la désinence, soit indiqué, comme dans nos langues, par l’ordre des mots.
Le système nominal exprime les mêmes rapports que le verbe quand il marque le nombre, singulier, duel, pluriel. Le genre nominal n’a pas de correspondants dans le verbe, sauf dans le participe, qui est un trait d’union entre le verbe et le nom, verbe par son thème et l’expression du temps, adjectif ou substantif par sa capacité d’être employé comme tel. Reste le système des cas, qui est le plus caractéristique pour le nom. En effet, le verbe n’a rien de directement analogue. Cependant, le système casuel ne manque pas de tout rapport avec les fonctions verbales. À regarder de plus près, on observe que la majorité des emplois casuels ne sert pas à rattacher des noms à des noms. Quand les cas expriment l’origine, la provenance, la possession, l’intérêt, la direction, ce sont implicitement des mouvements et des actions qu’ils désignent. Quand l’objet del’action verbale prend comme régime un cas déterminé, par là même ce cas se rattache explicitement à un verbe. Ces mêmes affinités sont de nature à éclairer la diversité entre le substantif, qui se manifeste par les cas, et le verbe, avec son apparat de propriétés formelles. Le substantif, là où son expressivité est au plus vivant, plonge dans une raideur tout ce qui ne se meut que grâce à l’expression verbale. Le génitif a beau exprimer l’origine, la provenance, pourtant l’expression pater filii n’équivaut pas à son correspondant verbal pater filium habet. Cette différence fait saisir au vif ce qui distingue le nom du verbe. Tout ce qui est présenté à l’aide d’une forme verbale, comporte un aspect de vivacité labile, un caractère de hic et nunc, qui soude la pensée à une réalité immédiate. En revanche, les mêmes contenus, présentés sous une forme nominale, prennent un aspect de possibilité abstraite qui a besoin d’être complétée de déterminations spéciales – comme p.ex. ce, le, un – si l’on veut évoquer la pensée du réel. Constatons donc que le nom est plus éloigné de la réalité vécue que le verbe et que, des deux catégories qui le constituent, le substantif estplus abstrait que l’adjectif, capable de marquer des états transitoires.
Le nom est plus abstrait en ce sens qu’il est incapable d’exprimer par lui-même et sans se remplacer par un autre nom les modifications incessantes qui constituent le caractère perpétuel de la réalité. Le substantif ne disposant d’aucun moyen pour marquer la limitation des choses dans le temps, il confère à ces dernières par sa forme même un aspect de durée qui ne leur convient pas en réalité. Cet aspect durable qui fait par la langue présenter des choses comme si elles étaient seules et indépendantes, c’est cet aspect qui les fait concevoir comme des idées platoniciennes. Le durable, qui ne change pas, étant l’abstraction, chaque chose présentée par le nom, sera présentée abstraitement, et sans les déterminations qu’il faudrait pour en égaliser le caractère concret.
Le rapport qui a été établi entre la richesse formelle d’une catégorie linguistique et son aptitude à désigner le concret met dans un autre jour la diversité du verbe et du nom, lorsqu’on considère la plus grande richesse du système verbal non pas comme l’effet mais comme la cause de la signification du verbe. Ce n’est pas parce que la racine d’un verbe signifie un mouvement que ce verbe a besoin de désinences pour exprimer ce mouvement dans sa variété concrète : tel verbe devient le symbole principal du mouvement et de la modification justement parce que son système de formes le prédispose à exprimer ce qu’il y a de plus concret dans la réalité. Or, rien de plus concret que le mouvement dans son unité multiple. Si le substantif avait autant de groupes de désinences qui permettraient de distinguer formellement entre une chose, au présent, au passé, au futur, dans le mode du réel, du possible, du désirable, ce substantif-là remplacerait le verbe dans toutes ses fonctions, il en deviendrait le pur équivalent, il aboutirait à être un verbe lui-même. Et quand, d’autre par, un verbe arrive à dépouiller son apparat formel, il devient de plus en plus semblable à un substantif et il finit par l’être. L’infinitif des langues classiques et modernes en fournit l’illustration. Si étymologiquement il est d’origine nominale il a été senti comme faisant part du système verbal et ce n’est qu’après avoir fonctionné dans le corps verbal qu’il s’en est écarté, pour devenir de nouveau un nom.
Nos réflexions signalent donc l’affinité du verbe et du nom, qui est la cause de leur ample interpénétration. Leur diversité se réduit à celle de la prédominance du point de vue mobile ou constant. Dans le verbe, c’est la mobilité qui est à la première place. Le symbole ne peut que figer cette mobilité, mais en lui laissant une part aussi grande que possible. Tel symbole est le verbe. Il arrive à ménager la mobilité au degré maximal par la richesse de ses formes, dont chacune exprime un aspect, qui facilement se change en un autre et pourtant en reste distinct ; je vois> tu vois> il voit> il vit> il verra, l’objet vu, etc. Ce qu’il y a de stable dans cette série, c’est la valeur même du symbole : voir, qui reste identique à lui-même. Le substantif met la stabilité au premier plan ; « la vue » n’a ni personne, ni temps, ni mode. Par sa nature grammaticale, c’est l’instrument de l’abstraction. La diversité se réduirait ainsi à une prédominance relative du mobile et du fixe, où l’élément opposé ne fait jamais entièrement défaut. Et cette prédominance trouverait son explication dans la richesse ou le manque de formes.
On remarquera, à juste titre, que cette conception omet de regarder des thèmes verbaux et nominaux. Avouons que notre hypothèse est applicable là seulement où une langue manifeste des systèmes morphologiques plus ou moins élaborés. Aussi l’objection nous fait revenir au problème de la racine, nominale ou verbale, posée par Herder.
La racine est l’extrême opposé de la catégorie dans sa multiplicité formelle. Les quelques éléments phonétiques qui composent la racine ne contribuent en rien à éclaircir la signification condensée dans celle-ci. Aussi la racine ne montre pas plus de rapport avec sa signification que le mot dérivé d’elle. Si la plupart des racines sont d’un caractère verbal, elles le sont dans un sens très général et qui rappelle l’infinitif du verbe. Cela s’explique par le manque de sens concret forcément propre à un terme si peu différencié. La racine n’exprime donc pas le sens verbal avec une telle netteté que la morphologie du verbe. Dans elle, la multiplicité manque, qui donne aux formes verbales leur sens concret. Ce qui caractérise la racine, ce n’est pas la mobilité du système élaboré, c’est le mouvement même. La racine, étant une suite de sons articulés, est produite dans un mouvement qui symbolise le mouvement même qui est la signification de la racine. Mais ce mouvement-là est inhérent à chaque racine et ne prononce rien sur le sens spécialement verbal de la racine en général.
Le problème de la nature de la racine se confond avec celui du langage même. La racine verbale a ceci de particulier que c’est un mouvement qui désigne le mouvement même. C’est comme l’onomatopée, où le son désigne le son, mais à un degré supérieur de complication. Dans la racine nominale, l’esprit saisit un élément constant de la réalité derrière lequel l’aspect de mouvement disparaît. Mais le mouvement symbolisé a déjà ceci de fixe, qu’il est ce mouvement-ci et non pas un autre. Tandis que le durable symbolisé a ceci de « mouvant » qu’il vise ce qui se maintient dans le courant universel des choses. Le fixe et le mobile, dans le fond, sont si près l’un de l’autre qu’ils ne se manquent jamais. Aussi le seul problème de la linguistique historique peut être la question, qui des deux a été exprimé le premier. Quand on regarde la vivacité du verbe comme signe de sa primitivité, on sera incliné à trouver juste l’idée de Herder, mais dans un sens « pré-catégorial » : l’expression linguistique a partagé le mouvement du réel avant de fixer ce dernier. L’expression a été de même nature que l’exprimé avant de suivre un développement autonome. La différenciation des catégories du verbe et du nom a été précédée d’une évolution du symbolisme même, qui s’est dressé raide devant le réel après en avoir suivi la manifestation mobile. C’est particulièrement la science qui tend à nominaliser les contenus. Mais ce procédé de nominalisation même est nourri par un mouvement, celui de la pensée. La pensée tend à faire disparaître le mouvement vécu et à le remplacer par des constantes. Elle y réussit en absorbant le mouvement en elle-même. Dans les formules abstraites tout mouvement est éliminé. Mais il l’est seulement, parce que la pensée se concentre à arriver à cette élimination ; ce faisant elle crée la distance la plus grande entre elle-même, et la réalité immédiate. Quand la réflexion philosophique se rend compte de cet éloignement entre la pensée et le réel, elle réintroduit, pour caractériser la pensée en action, tous les verbes que celle-ci a soustraits à l’expression de la connaissance du réel. La mobilité reprend ses droits au plan de la pensée philosophique.
(1935) "Le verbe et son rôle dans l’expression de la pensée", Recherches philosophiques 4, pp.337-347.