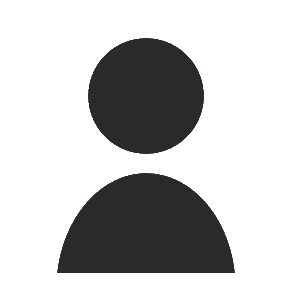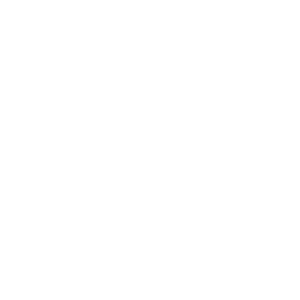This document is unfortunately not available for download at the moment.
Le langage et la pensée
Hendrik Pos
Translated by Patrick Flack
pp. 227-232
La question du rapport entre le langage et la pensée ne constitue certes pas un problème central de la philosophie, digne d’être mis sur le même plan que les problèmes de l’être et de la connaissance, de la matière et de l’esprit ou de la connaissance et de l’action. Elle a toutefois été posée autant dans les philosophies antiques et scholastiques que modernes. Platon y a consacré son Cratyle. Au lieu d’envisager l’acte de nommer comme étant humain et arbitraire – un point de vue qui part du constat que tout nouveau-né reçoit un nom qui ne se base sur aucune connaissance préalable de son être – Platon avance la thèse que les mots sont constitués par un législateur divin à partir de sons possédant tous une signification symbolique. Confronté à la tâche d’illustrer cette thèse au moyen de mots déterminés dans le dialogue, Socrate hésite : la démonstration ne veut pas aboutir. Mais Platon ne laisse pas cet échec influer sur sa conviction que les mots sont institués par une instance savante supra-humaine. Le but apparent de sa tentative de procurer un fondement ontologique aux mots comme porteur des Idées était surtout de réfuter le relativisme des Héraclitéens. Platon n’est dès lors pas revenu à la charge sur ce sujet d’un intérêt trop limité pour lui, son ontologie disposant d’arguments plus puissants contre le relativisme que ceux fournis par une étymologie naïve. Quant à son incapacité à démontrer que les mots recèlent une connaissance de l’être, elle n’impliquait pas la réfutation de sa thèse d’une connaissance de l’être par les Idées.
Les grammairiens spéculatifs du Moyen Âge tels que Thomas d’Herford (Pseudo-Duns Scot) partagent le point de départ ontologique de Platon. Mais ils s’appuient par ailleurs sur une science grammaticale qui existait encore à peine aux temps de Platon, ainsi que sur la théorie des catégories développée par Aristote. Leur projet est désormais de faire dériver les classes de mots de la grammaire traditionnelle (du Latin) à partir des catégories de la connaissance, catégories qui à leur tour représentent des rapports de l’être. Ce qui est « à démontrer », c’est en fait l’imbrication des formes d’une langue empiriquement donnée avec les formes d’un champ mental de significations qui se distingue du langage, tout en le fondant. Le champ des significations se distingue à son tour des rapports au sein de l’être même, qui sont eux considérés comme fondant l’activité donneuse de sens. Cette démonstration est spécieuse, dans la mesure où les catégories de la signification sont dérivées du langage avant d’être fondées sur l’Être. Si ces catégories étaient obtenues en concentrant la pensée directement sur l’Être de manière à la libérer de l’influence du langage, alors l’accord entre l’un et l’autre serait d’un plus grand intérêt. Mais tel qu’il est, cet accord revient tout au plus à justifier les formes fondamentales d’une langue déterminée en tirant les arguments pour cette justification du donné factuel de la langue elle-même. En procédant de la sorte, il est possible d’établir une sphère de signification et une articulation de l’Être compatibles avec la structure de n’importe quelle langue donnée empiriquement, en tirant tout simplement les principes fondamentaux de cette définition du donné factuel de cette langue. L’hypothèse que le langage « reflète » la pensée et que celle-ci « reflète » les articulations de l’être ne peut être maintenue qui si on n’entre pas dans le détail. Elle est seulement vraie dans une généralité maintenue hors du concret. Elle sert d’intuition initiale mais aussi finale, tant que l’uniformité qui est postulée entre le langage et la pensée n’est pas explorée dans le détail. Si toutefois on se prend à comparer point par point le langage, la pensée et l’Être, alors cette hypothèse ne se trouve pas renforcée mais modifiée. Une telle comparaison rend en effet manifeste que la pure distinction entre langage, pensée et être, qui de par leur uniformité présumée revêtait au départ un caractère abstrait, est bel et bien réelle et concrète dans le détail. Bien qu’il renvoie toujours à quelque chose d’autre, le langage conserve ses propres formes face aux rapports de la signification, et celles-ci ne correspondent pas aux rapports de l’être.
Les penseurs d’inclination ontologique ou spéculative ne considèrent ces différences concrètes que comme des accidents de peu d’importance et ne laissent généralement pas ces divergences manifestes influencer leur conception d’un accord réel entre langage, pensée et être – telle qu’elle est formulée par exemple par Hegel, qui fait de la langue une manifestation de la raison. Les penseurs critiques, par contraste, ont saisi ce rapport comme une relation dont les relata peuvent coïncider ou non, sans que leurs liens ne se perdent. La philosophie stoïcienne, comme en bien d’autres points, a jeté ici les bases d’une méthode analytique qui ne se satisfait pas de points de vue généraux et s’efforce de faire passer la philosophie du langage au stade d’une science du langage. Ce n’est pas un hasard que le renouveau de la connaissance qui a eu lieu aux XVIème et XVIIème siècles a été mené par des penseurs qui ont mis l’accent sur la différence entre langage et pensée. Bacon, dans son Novum Organon, recense le langage parmi les quatre sources possibles d’erreur humaine. Descartes mentionne des types de raisonnements qui sont plus adaptés à transmettre à d’autres des connaissances déjà acquises qu’à produire de nouvelles idées. Spinoza souligne l’impureté du langage adapté à l’usage quotidien : ce langage se réfère par exemple avec des noms positifs à des choses qui sont limitées et utilise le mot négatif « illimité » pour dénoter les seules choses véritablement positives. Kant a lui mentionné l’illusion produite dans le langage par une expression telle que « force négative », qui se réfère pourtant à quelque chose de positif réagissant à quelque chose de positif également. Une étude historique exhaustive des idées de ces penseurs sur le rôle du langage en relation à la connaissance n’a pas encore été menée à bien. Il est néanmoins clair que dans ce domaine très divers se dessinent deux grandes tendances. D’une part, il existe une interprétation métaphysique – défendue autant par les penseurs spéculatifs que des penseurs plus créatifs dans le sens de Heidegger – qui attribue au langage une profondeur qui recèle la vérité. D’autre part, il y a une approche critique qui insiste sur la tension entre les qualités conservatrices et stables du langage et le processus progressif de la connaissance. Le langage est considéré ici d’une manière critique et est adapté aux besoins d’une science qui de fait dépasse l’espace délimité par le langage. Une telle réinterprétation ne postule pas que le langage est incapable par principe de capter la connaissance, mais souligne seulement l’insuffisance de ce qui est chaque fois atteint par la connaissance elle-même et, de ce fait, également par le langage. Cette réinterprétation se différencie également du romantisme négatif qui s’est profilé avant tout au cours du siècle passé comme un adversaire de l’ontologisme de l’antiquité. Alors que ce dernier enseignait qu’il y a toujours une adéquation réelle entre être, connaissance et langage, c’est l’impuissance du langage qui est soulignée par les romantiques et notamment Schiller, dont les mots fournissent la clé du rapport entre langage et pensée dans toutes ses formes : « Spricht die Seele, so spricht ach, die Seele nicht mehr ».1 La conscience parlante malheureuse qui est confrontée dans ce cas à l’impuissance irrémédiable du langage se distingue de la manière la plus radicale qui soit de l’optimisme métaphysique de l’antiquité, ne serait-ce aussi parce que cette impuissance ravit au langage la qualité particulière qui, pour un penseur tel que Bergson, est censée le définir. Il est vrai aussi, cependant, que ces deux perspectives diamétralement opposées sont plus apparentées entre elles qu’avec le point de vue critique : elles postulent toutes deux une structure définitive et réelle, que celle-ci soit par ailleurs indestructible ou impuissante. À leur base se trouvent une décision métaphysique, alors que dans le point de vue critique les choix sont recalés au profit d’un travail unissant certitude et autocritique. La philosophie moderne a permis à la position critique de supplanter la vision ontologique de l’Antiquité. Cette position est plus près de la fonction réelle du langage, elle garantit sa valeur autonome face à la connaissance objective. L’approche introspective s’est aussi distancée du point de vue ontologique en tentant de saisir le langage et la pensée dans leur réalité immédiate, comme les événements intérieurs d’une conscience individuelle. La perception de soi et la perception d’autrui se complètent dans le constat que la pensée rencontre de fait une barrière dans la parole mais que celle-ci rend par ailleurs possible la socialisation avec autrui. Le rapport entre pensée et langage semble évident en ce qui concerne sa hiérarchie : la pensée est un fondement et le langage un moyen. Cela dit, toute thèse cherchant à attribuer une priorité soit à la pensée soit au langage renferme des difficultés particulières. La pensée ne peut se faire parole que quand elle dispose d’une langue, qui est un fait social préexistant pour chaque nouveau-né. D’un côté, nous avons donc un rapport qui pose le langage comme un fait social antérieur toujours déjà donné et permettant à l’être humain grandissant d’apprendre à parler ; la parole de ce dernier est empruntée et se conforme à la langue. D’un autre côté, il n’est pas possible qu’il en ait « toujours » été ainsi : la langue qui nous permet de parler est elle-même un produit de la parole. C’est un fait avéré que la parole balbutiante rencontre la langue par l’entremise de ceux qui la parle. Ce que l’introspection tient pour immédiat ou absolument indépendant se révèle ainsi comme étant médiatisé et dès lors dépendant : l’homme qui parle ne crée pas la langue lui-même, il ne fait « que » l’apprendre. Mais alors même qu’il ne fait « que » parler d’après le modèle que lui fournit la langue, le locuteur la transforme aussi en quelque chose d’autre : la priorité de la langue ne peut donc pas être considérée comme absolue. Et pourtant cette vérité ne rend pas pour autant fausse son contraire. La priorité de la langue par rapport à la parole est en effet un fait très général. Le second fait n’annule donc pas le premier : si cela était le cas, on n’aurait pu établir pour vrai les deux faits que l’on vient justement d’établir. Mais on établit aussi plus que juste le premier de ces faits lorsqu’on y ajoute le second. Cela est rendu évident quand on montre dans quelle perspective le premier est vrai, et dans quelle perspective l’est le second. Ainsi en va-t-il aussi du rapport entre langage et pensée. Alors que les thèses concernant la priorité de l’un ou de l’autre s’annulent et ne disent rien, elles sont toutes deux vraies si on démontre dans quelle mesure et dans quelle perspective elles sont valides. Mais elles demeurent vides de sens si on ne descend pas dans le concret.