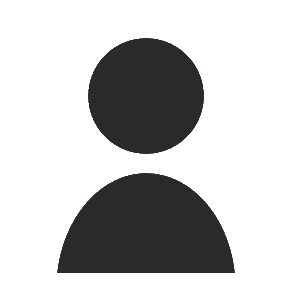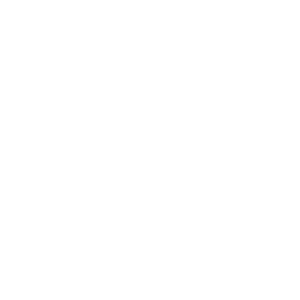This document is unfortunately not available for download at the moment.
Alter: Revue de phénoménologie
Anthropologies philosophiques
Vol. 23
Étienne Bimbenet, Laurent Perreau (ed)
L’anthropologie philosophique fait depuis une dizaine d’années l’objet d’un véritable renouveau. On assiste en effet à un retour en grâce, en Allemagne comme en France ou en Italie, de la fameuse « anthropologie philosophique allemande » de l’entre-deux-guerres. Max Scheler, Arnold Gehlen, Helmuth Plessner, Paul Alsberg, autant de noms prestigieux et pourtant passablement oubliés, dont les hypothèses aventureuses (la « néoténie », la « positionnalité excentrique », « l’être lacunaire ») sont à nouveau commentées, prises au sérieux, discutées.Or il faut se souvenir qu’un tel mouvement a joué un rôle crucial, positivement ou négativement, dans l’histoire de la phénoménologie. Husserl, Heidegger, plus tard Patocka, Merleau-Ponty ou Blumenberg, eurent à prendre position, soit en assumant une certaine « phobie de l’anthropologie », constitutive de la phénoménologie historique, soit pour la surmonter et tenter alors une anthropologie « d’un point de vue phénoménologique ». Ce numéro de la revue Alter entend rouvrir ce dossier pour en explorer les différents aspects et en évaluer, à l’âge de la psychologie évolutionniste ou des spéculations sur le post-humain, toute la portée philosophique.
Dastur Françoise
Piette Albert
Sommer Christian
Schumm Marion
Fagniez Guillaume
Marino Mario
Terzi Roberto
Emmanuel De Saint Aubert
Jean Grégori
Bimbenet Étienne
Cabestan Philippe
Lorelle Paula
Depraz Natalie
Landgrebe Ludwig