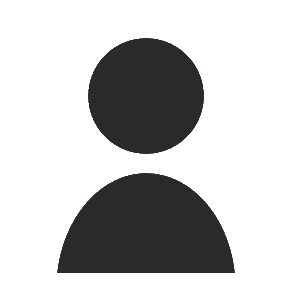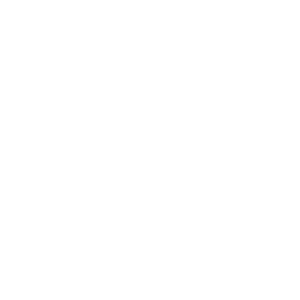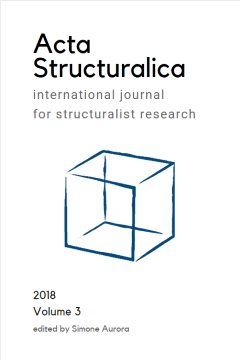This document is unfortunately not available for download at the moment.
L'enjeu rationaliste de l'unité de la langue
Pensées de la différence chez Saussure, Merleau-Ponty et Derrida
Jeanne-Marie Roux
pp. 77-103
L’écriture est une pierre dans le jardin de la linguistique, ou du moins dans celui de la représentation que l’on se fait traditionnellement de la linguistique saussurienne. En quel sens et dans quelle mesure la signification dépend-elle du moyen matériel, du médium par lequel elle est exprimée ? En quel sens et dans quelle mesure celui-ci influence-t-il ou conditionne-t-il ce qui est exprimé ? Jacques Derrida a conféré à la question de l’écriture un rôle essentiel dans l’évaluation de la philosophie contemporaine et, plus généralement, de toutes les conceptions (philosophiques ou non) qui portent sur le langage. Dénonçant le « phonocentrisme » comme l’un des péchés capitaux de la pensée occidentale, Derrida fait de la dévaluation traditionnelle de l’écriture qui s’y observe le symptôme de sa domination par un idéal du « logos absolu » (Derrida 1967, 25). Comme il l’exprime dans la fameuse critique qu’il adresse à Saussure, la thèse de Derrida est que la préférence accordée à la parole sur l’écriture indique une dévaluation de « l’extériorité » (Ibid., 24) et de la « différence » en faveur de l’intériorité, de la subjectivité, de la « présence à soi-même » (Ibid., 29) du sens. Dramatisant la différence entre langue parlée et écriture, Saussure aurait en fait minimisé la part de la différence (en général) dans le champ de la pensée et du langage. Derrida suggère ainsi que la manière dont chaque penseur traite du format de l’expression est révélatrice des conceptions de la signification, de la pensée et de la vérité qu’il emploie.
Or, si nous adoptons provisoirement ce critère de l’écriture et que nous l’employons de cette manière-ci, nous pouvons dire que les philosophies du langage développées par Merleau-Ponty et Derrida sont antithétiques pour l’essentiel, c’est-à-dire en ce qui concerne précisément ce statut accordé à l’écriture par rapport à la constitution du sens. Alors que Derrida donne l’importance que l’on sait à la « grammatologie », Merleau-Ponty fonde l’ensemble de sa philosophie du langage sur le concept de « parole », ce qui pourrait montrer, non seulement qu’il ne conteste pas la marginalisation de l’écriture réalisée par Saussure, mais qu’il s’en empare et l’explicite – au sens où, rappelons-le, le concept central de Saussure n’est pas tant « la parole », privilégiée par Merleau-Ponty, que « la langue », moins évidemment phonologique d’emblée. Si l’on adopte ce critère de l’écriture, on peut donc penser que Merleau-Ponty, du point de vue de Derrida, est tout autant coupable de « phonocentrisme » que ceux qu’il critique plus explicitement.
Pourtant, notre thèse est que cette différence sur le sujet de l’écriture, aussi importante puisse-t-elle paraître au premier abord, recouvre un accord (à nos yeux, plus) fondamental sur la question du caractère social et systémique de la langue ou, plus précisément, une mécompréhension commune de celui-ci. En effet, le traitement opéré de la question de l’écriture est le symptôme ou (selon le degré de conscientisation de la pensée considérée) la conséquence de la conception qui est faite de la différence des signes. Or, la pensée qu’en propose Saussure n’est réductible ni à la conception derridienne ni à la conception merleau-pontienne, et ce précisément du fait du caractère social de la langue, dont ni Derrida ni Merleau-Ponty ne parviennent selon nous à rendre compte. Significativement, cet accord transparaît dans le traitement tardif que Merleau-Ponty propose du concept d’écriture. Selon nous, la conséquence en est qu’en manquant ce qui fait à nos yeux le cœur de la conception saussurienne de la langue, Merleau-Ponty comme Derrida ne traitent pas adéquatement la question de l’écriture mais, plus fondamentalement, ils en arrivent à une forme commune de scepticisme. En somme, l’écriture serait bien porteuse des enjeux épistémologiques et métaphysiques pointés par Derrida ; les conclusions à porter à son égard seraient différentes.
La lecture de Saussure par Derrida a profondément influencé la réception de la linguistique saussurienne dans la pensée contemporaine, et occasionné maints commentaires, réponses, critiques, tant dans le champ philosophique que dans celui de la linguistique, où la critique derridienne, aussi nuancée et modérée doive-t-elle être, est venue incontestablement appuyer sur un point épistémologique douloureux..
Derrida présente lui-même synthétiquement sa critique de Saussure dans un entretien mené par Julia Kristeva en 1968. Il y indique tout d’abord les apports positifs de la sémiologie saussurienne, avant de présenter quatre points de critique essentiels, qui sont, dit-il, autant d’« effets sur le discours de Saussure » (Derrida 1968, 137) des « présuppositions » de la « métaphysique occidentale ».
Il s’agit 1/ du « maintien de la distinction rigoureuse – essentielle et juridique – entre le signans et le signatum […] laissant ouverte en droit la possibilité de penser un concept signifié en lui-même, dans sa présence simple à la pensée » (Ibid., 137); 2/ du fait que Saussure ait dû « pour des raisons essentielles et essentiellement métaphysiques, privilégier la parole, tout ce qui lie le signe à la phonè » (Ibid., 138); 3/ de l’usage du « concept de signe (signifiant/signe) » (Ibid., 139), qui « porte en lui-même la nécessité de privilégier la substance phonique et d’ériger la linguistique en “patron” de la sémiologie » (Ibid.); 4/ du fait, enfin, que cet usage implique de « réduire l’extériorité du signifiant » (Ibid.), et donc de définir le signe comme « une entité psychique à deux faces » (Ibid.).CLG.
En somme, ce que reproche Derrida à Saussure est d’avoir pensé la signification linguistique, le « signifié », dans une forme d’indépendance par rapport au signifiant, d’avoir ainsi pensé une unicité, une permanence du « signifié », et d’avoir été incité à cela par la dualité du concept de signe, qui l’a conduit à privilégier le type de signifiant le plus susceptible de jouer, en toute transparence et fidélité, le simple rôle de transmetteur de signifiant, et donc le signifiant phonique. Le fait que, pour Saussure, l’écriture ne joue qu’une « fonction étroite et dérivée » (Derrida 1967, 46), qu’elle ne soit considérée que comme « outil imparfait de surcroît et technique dangereuse – on dirait presque maléfique » (Ibid., 51) –, son « phonocentrisme » en somme, serait donc le symptôme de son « logocentrisme » principiel, c’est-à-dire de sa recherche d’un logos absolu, pleinement présent à lui-même.
De nombreux linguistes, on l’a dit, se sont attachés à évaluer la pertinence de cette critique et n’ont pas manqué de faire valoir « les contradictions qui affectent la référence à l’écriture dans le C. L. G. » (Anis 1988, 39). Le problème se pose en ces termes. D’une part, l’objet de la linguistique est, pour Saussure, la « langue », en tant que celle-ci forme un « tout en soi » (CLG, 25). L’un des enjeux essentiels, pour garantir la scientificité et la rigueur de la linguistique, est donc de délimiter correctement cet objet, ce « tout en soi », de distinguer adéquatement ce qui lui est interne et ce qui lui est extérieur. Or, pour réaliser cette tâche dans le contexte intellectuel et scientifique qui était le sien, Saussure devait aller « à l’encontre du privilège grammatical (des grammairiens grecs à Port-Royal) et de la tradition philologique que systématise une certaine linguistique historique du XIXe siècle » (Chiss et Puech 1980, 353), qui étaient tels que, selon les mots de Saussure notés par Riedlinger, « on s’est demandé si la linguistique n’[était] pas une science philologique » (Saussure 1968, 76)., 40), à laquelle on avait tendance à la réduire. Comme Jean-Louis Chiss et Christian Puech l’écrivent, « la question de l’écriture délimite dans une certaine mesure de l’intérieur ce que la linguistique structurale a voulu reconnaître comme étant son objet “propre” » (Chiss et Puech 1983, 6).
La difficulté vient du fait que, comme l’a montré Pierre-Yves Testenoire, l’écriture n’est pas seulement « critiquée comme une médiation trompeuse de la langue, elle est aussi sollicitée comme un analogon pertinent pour réfléchir aux caractéristiques de l’objet linguistique » (Testenoire 2016, 37). Saussure le reconnaît à maintes reprises : quelque souhait que l’on ait de construire une linguistique indépendante de toute philologie, force est de reconnaître que la langue que l’on écrit et la langue que l’on parle ne sont pas sans lien, de sorte qu’il semble raisonnable de se demander s’il est bien justifié de considérer qu’elles forment « deux systèmes de signes distincts » (CLG, 45). La langue que l’on parle et celle que l’on écrit sont-elles deux langues différentes, l’une est-elle une déformation de l’autre ou forment-elles une seule et même langue, qui connaîtrait différents types d’instanciation ?
Ce problème est loin d’être une pure querelle de frontière disciplinaire, puisqu’elle met en jeu, tout bonnement, la question classique de la relation de la pensée et de la langue : est en effet engagé le problème de la détermination du sens par la langue, et donc tant celui de l’expression du sens que celui de la compréhension du (des) langue(s). Elle a de ce fait de lourdes implications pédagogiques, puisqu’il en va par exemple de la meilleure méthode à employer pour enseigner l’écriture aux enfants sourds-muets
C’est l’un des grands intérêts de la critique derridienne de Saussure que de poser ce problème en lui conférant une importance que l’on ne peut dénier, et en identifiant les éléments de doctrine qui, dans la pensée de Saussure, doivent permettre d’affronter cette question. Cette question de l’écriture interroge en effet le sens que l’on doit conférer à la fameuse thèse de « l’arbitraire du signe », qui, écrit Derrida dans La grammatologie, « devrait interdire de distinguer radicalement signe linguistique et signe graphique » (Derrida 1967, 65).
Effectivement, si l’on revient à la lettre du cours édité en 1916 (qui est la source de Derrida), il y apparaît que le signifiant « est immotivé, c’est-à-dire arbitraire par rapport au signifié, avec lequel il n’a aucune attache naturelle dans la réalité » (CLG, 101). Mais alors – demande Derrida – s’il n’y a aucune attache naturelle entre le signifiant et le signifié, pourquoi privilégier un type de signifiant sur un autre ? En l’occurrence, pourquoi privilégier le signe phonique sur le signe graphique ? L’arbitraire du signe aurait dû libérer toutes les expressions linguistiques possibles du « phonocentrisme » occidental.
Si, dans les textes du Cours de linguistique générale où il en est question, Saussure se concentre sur « la langue » au détriment de « l’écriture », on le met généralement au compte du fait que, nous l’avons dit, il a pour principal souci de prévenir les linguistes contre les méfaits d’une attention excessive accordée aux écrits, au détriment de la vie propre de « la langue ». Il est par exemple indiqué dans le sixième chapitre que celle-ci n’est pas toujours adéquatement représentée par les écrits, comme le montre le fait que certaines prononciations peuvent se maintenir dans le temps alors même que rien, dans le signe écrit, ne vient les marquer ou les conforter. À la suite de Derrida, il semble pourtant pertinent d’opposer à cet argument la question suivante : que la langue orale et la langue écrite puissent diverger, cela est clair, mais pourquoi décréter que la « vraie » langue est a priori orale, alors même que le signifiant « n’a aucune attache naturelle dans la réalité » (Ibid.) avec le signifié ? Pourquoi le signifiant ne pourrait-il pas être à aussi bon droit graphique que phonique ? Pourquoi telle ou telle caractéristique matérielle du signe – en l’occurrence sa visibilité – l’exclurait-elle de « la langue » ? C’est la charge tirée de Saussure que Derrida retient contre Saussure lui-même. La faiblesse de cette attaque est, selon nous, qu’elle ne comprend de l’arbitraire saussurien qu’une seule de ses dimensions, et échoue pour cette raison à poser la question dans les termes adéquats.
En effet, tous les auteurs s’y accordent, la thèse de l’arbitraire signifie bien que, selon Saussure, il n’y a pas d’« attache naturelle » entre le signifiant et le signifié – mais elle n’implique nullement pour autant qu’il n’y a entre eux aucun lien de nécessité d’aucune sorte. Elle n’implique nullement que toutes les différences entre tous les signifiants, et donc entre tous les signes, aient les mêmes implications, possèdent la même valeur. Or, Derrida propose de substituer au « phonocentrisme » de la métaphysique occidentale, non un « graphocentrisme », mais une « grammatologie », concentrée sur l’idée qu’entre les signes, prime toujours la différence – ou plutôt la différance, ce mouvement incessamment producteur des différences, qui fait que celles-ci jamais ne se stabilisent (Derrida 1972, 12-13). Mais alors, en soutenant que toute signification est toujours espacée par rapport à elle-même, que le sens n’est jamais présent, Derrida semble mettre toutes les différences entre tous les signes sur le même pied. Or, une juste compréhension de l’arbitraire du signe saussurien doit justement permettre, semble-t-il, de les ordonner. Car cet arbitraire n’est pas un chaos, c’est l’arbitraire d’un système, qui n’exclut ni la motivation ni la nécessité. Sur ce point, Derrida aurait manqué une dimension importante de la pensée saussurienne.
Une donnée historique doit être prise en compte ici. Car Simon Bouquet nous en avertit :
si l’on place en regard des notes d’étudiants les 16 passages dans lesquels leCours de linguistique généraleparle d’arbitraire, on s’aperçoit que, dans aucun des cas, le passage ne correspond à une formulation originale de Saussure (Bouquet 1997, 283).Pour consulter ces passages, voir Engler (1962) et (1964).
En effet, ce que l’on a longtemps identifié comme étant « la thèse de Saussure », et qui fait notamment l’objet de la critique derridienne est largement le produit de la (re)constitution du Cours de linguistique générale par Charles Bailly et Albert Séchehaye. La situation en est singulièrement compliquée car – c’est notre thèse –, si Derrida a vu dans la thèse de l’arbitraire ce qui, à bon droit, devait permettre d’interroger, sinon de contester, le rôle que Saussure faisait jouer à l’écriture dans sa linguistique, son interprétation ne lui a pas permis de voir ce qui, véritablement, devait emporter la décision en ce domaine. Or, sur ce point, il nous semble qu’il est singulièrement proche de Merleau-Ponty, autre lecteur de Saussure, autre relecteur de son arbitraire, qui comme lui va faire jouer au concept de différence un rôle crucial dans sa philosophie du langage. Par l’analyse de la lecture merleau-pontienne de Saussure, nous entendons à présent rendre compte de ce qui constitue à nos yeux la lecture correcte de l’arbitraire saussurien et, par là-même et indissociablement, de ses concept de langue et de différence du signe. C’est une interprétation forte de la socialité et de l’unité de la langue que nous entendons ainsi défendre contre Merleau-Ponty et Derrida.
Nombre de commentateurs l’ont déjà souligné : la lecture merleau-pontienne du célèbre linguiste suisse est caractérisée par sa liberté,Cours de linguistique générale par Charles Bailly et Albert Séchehaye.
Il est clair à première vue que la philosophie du langage merleau-pontienne accomplit une distorsion forte de la linguistique saussurienne, en particulier si l’on considère l’objet qu’une étude du langage doit privilégier. En effet, Merleau-Ponty affirme que
la linguistique de Saussure légitime, dans l'étude de la langue, outre la perspective de l'explication causale, qui rattache chaque fait à un fait antérieur et étale donc la langue devant le linguiste comme un objet de nature, la perspective du sujet parlant qui vit sa langue (et éventuellement la modifie). Sous le premier rapport, la langue est une mosaïque de faits sans « intérieur ». Sous le second, au contraire, elle est une totalité (Merleau-Ponty 1966, 107).
Là contre, on peut invoquer le fait – et cela a été fait de nombreuses fois – que Saussure consacre délibérément « la langue » et non « la parole » comme objet de la linguistique qu’il entend constituer, ou du moins re-fonder. Une telle distinction lui aurait été nécessaire pour faire de la linguistique une authentique science, ayant pour objet, non des phénomènes contingents, mais des faits ordonnés en « un tout en soi » (CLG, 25).
Pourtant, et là est le point sur lequel se concentrent ceux qui défendent la justesse de l’interprétation merleau-pontienne, de nombreux travaux montrent aujourd’hui que, pour Saussure lui-même, la distinction de la parole et de la langue ne signifie pas que la parole devrait être exclue de la linguistique et, plus fondamentalement, que le point de vue de la langue et celui de la parole sont chez Saussure moins opposés que complémentaires
La réception duCoursde Merleau-Ponty est unique du fait de sa tolérance élevée à l’égard de la complexité, si ce n’est le caractère paradoxal, d’une linguistique générale où les différents niveaux du langage comme système et comme parole se révèlent intimement entrelacés et noués dans des relations d’implications mutuelles plutôt qu’étagés hiérarchiquement et opposés (Stawarska 2015, 181,nous traduisons).
Effectivement, si l’on remet la naissance de la linguistique saussurienne dans son contexte, il est clair que, à l’encontre de la tradition philologique de son temps, Saussure avait à cœur de rendre sa spécificité à la « vie normale et régulière » des signes (CLG, 105).Cours de 1916CLG, 37).
Pourtant, indépendamment du grand intérêt intrinsèque de ces interprétations, il nous semble que des éléments importants des doctrines de Merleau-Ponty et de Saussure doivent conduire à minimiser ce rapprochement. Il s’agit ici de la place et du statut du social dans toute compréhension du langage. Car si Saussure privilégie en première instance « la langue » sur « la parole » comme fondement de la linguistique scientifique nouvelle, la raison en est que, selon lui, la langue est « un produit social » (CLG/E(1), 31 ou 173), c’est-à-dire un fait qui s’impose à tous les individus d’« une masse parlante » (Ibid., 333-334), qui « apparaît comme la loi que l’on subit » (Ibid., 159) : en tant que telle, elle ne peut précisément pas se comprendre depuis la perspective du sujet parlant, et c’est bien pour cela que, selon nous, Saussure distingue bien deux niveaux d’analyse du langage, sans réduire l’un à l’autre.
Précisons un point : il ne s’agit évidemment pas de dire ici que la perspective du sujet parlant et celle du système social qu’est la langue sont exclusives et contradictoires, mais de souligner le fait qu’elles sont différentes et non évidemment réductibles l’une à l’autre. Or, nous pensons qu’en considérant prioritairement le langage depuis la perspective du sujet parlant comme il le fait (et sans doute y a-t-il d’autres manières de le faire), Merleau-Ponty tend à négliger des faits relatifs à la langue comme phénomène proprement social et irréductible, non pas tant aux sujets pris dans leur ensemble, qu’à chaque individu considéré isolément. Ce faisant, on pourrait tout aussi bien dire, du reste, qu’il appauvrit aussi bien « la langue » que « la parole », puisque, dans cette perspective, c’est une dimension du fonctionnement effectif du langage qui est négligée.
Tâchons à présent d’exhiber ce qui, selon nous, fait défaut dans l’appropriation merleau-pontienne de la linguistique saussurienne. Le problème se cristallise sur le sujet de l’arbitraire du signe – thèse essentielle, nous l’avons dit, pour la compréhension de l’institution singulière qu’est la langue selon Saussure. Certes, la lecture de l’édition du Cours de 1916 peut laisser penser que Merleau-Ponty corrige ce qu’il peut y avoir d’erroné ou de contradictoire dans le principe de l’arbitraire tel qu’il y est mentionné, en se rapprochant par exemple de la célèbre interprétation proposée par Benveniste en 1939Cours, notes 137-141, pp. 442-445. Nous avons nous-même défendu cette interprétation (provisoire, donc) dans Roux (2016b).
Si l’on reprend la formulation du Cours de linguistique générale de 1916, la thèse de l’arbitraire du signe implique que
l’idée de « sœur » n’est liée par aucunrapport intérieuravec la suite de soins s-ö-r qui lui sert de signifiant ; il pourrait aussi bien être représenté par n’importe quelle autre : à preuve les différences entre les langues et l’existence même de langues différentes : le signifié « bœuf » a pour signifiant b-ö-f d’un côté de la frontière, et o-k-s (Ochs) de l’autre (CLG,100,nous soulignons).
Au contraire, est-il précisé, « tout moyen d’expression reçu dans une société repose en principe sur une habitude collective ou, ce qui revient au même, sur la convention » (Ibid., 100-101). Or, Merleau-Ponty critique clairement cette conception : le signifiant n’est certainement pas arbitraire par rapport au signifié, dans la mesure où le sens des mots n’existe pas indépendamment d’eux, qu’il est induit par les mots eux-mêmes, et donc qu’il y a bel et bien une relation essentielle entre ce sens et les mots qui le portent, et donc le signifié et le signifiant. Concevoir des « signes conventionnels », ce serait régresser vers une conception idéaliste pour laquelle le sens d’un mot ne serait pas consubstantiellement le sens qu’il est parce qu’il est le sens de ce mot, et non d’un autre. Comme il l’écrit dans la Phénoménologie de la perception (mais bien d’autres citations seraient possibles) :
Il n’y a donc pas à la rigueur de signes conventionnels, simple notation d’une pensée pure et claire pour elle-même, il n’y a que des paroles dans lesquelles se contracte l’histoire de toute une langue, et qui accomplissent la communicationsans aucune garantie, au milieu d’incroyables hasards linguistiques(Merleau-Ponty 2009, 229,nous soulignons).
Plusieurs remarques s’imposent. D’une part, il est frappant que la critique que Merleau-Ponty formule rejoigne pour partie celle qui fut exprimée par Emile Benveniste quelques années auparavantCours de 1916, n’était pas conséquente avec la consubstantialité du signifiant et du signifié affirmée par ailleurs. L’unité du signe linguistique, telle que le Cours lui-même la définit, implique en effet qu’« [e]ntre le signifiant et le signifié, le lien n’est pas arbitraire ; au contraire, il est nécessaire » (Benveniste 1939, 51). À lire Benveniste, nous pourrions donc penser qu’en critiquant l’arbitraire du signe « version 1916 », Merleau-Ponty défende l’unité du signe linguistique contre l’interprétation idéalisante que certains passages du Cours peuvent induire, et même clairement encourager.
Cette lecture, cependant, est limitée à plusieurs titres, qui ne sont que différents aspects d’un même nœud. Car le problème est que, par contraste avec le conventionnalisme associé à l’arbitraire saussurien « version 1916 », Merleau-Ponty pense explicitement l’expression du sens en termes de « hasard », c’est-à-dire d’événements de parole toujours singuliers qui, par chance, « sans aucune garantie », en viennent à dire quelque chose, à être compris, à produire un effet. Or, il nous semble que, par là même, Merleau-Ponty néglige ou s’éloigne de ce qui demeure pertinent dans la thèse de l’arbitraire, et notamment une dimension de nécessité systémique recueillie par Saussure au niveau du concept de langue. Puisque Merleau-Ponty n’ignore évidemment pas ce phénomène qu’est la langue, dont il entend rendre compte depuis le niveau de la parole, ce qui suit a pour principal objectif de montrer qu’il y échoue au sens où la manière dont il se focalise sur la parole est impropre à rendre compte du point de vue de la langue cher à Saussure. Notre thèse est que cet échec (que l’on est en droit d’interpréter comme une prise de distance féconde) a, de même que la position derridienne, des conséquences fondamentales en termes de philosophie du langage, du sens et de la vérité. A ce titre, l’arbitraire du signe serait tout à la fois ce qui donnerait, dans une certaine mesure, raison à Merleau-Ponty et Derrida, et ce qui, tout autant, manifesterait leur déformation de la pensée de Saussure. Un même aveuglement à ce qui fait le cœur de la linguistique saussurienne serait à l’œuvre dans leurs deux philosophies du langage.
L’arbitraire du signe ne signifie pas, chez Saussure, que chaque signe est la combinaison aléatoire, hasardeuse ou conventionnelle, d’un signifiant et d’un signifié : la langue n’est pas un ensemble aléatoire de couples signifiant/ signifié, c’est un « système » (p. ex. CLG/E(1), 163), un système « social », et, pourrait-on même soutenir à la suite de Jonathan Culler, « un système de motivation » (Culler 2003, 58). En effet, en récusant l’existence de tout lien naturel entre signifié et signifiant, et donc a fortiori entre signifié et signifiant phonique, l’erreur serait de faire comme si chaque « signifiant » disposait lui-même d’une quelconque identité absolue, d’une unité intangible. Loin d’en être dupe, Saussure écrivait dans ses notes sur Whitney :
l’objet qui sert de signe n’est jamais « le même » deux fois : il faut dès le premier examen un examen < ou une convention initiale > pour savoir au nom de quoi, < dans quelles limites > nous avons le droit de l’appeler le même (CLG/E(II), 21).
Aucun signe n’est jamais identique à lui-même : on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ; qu’il s’agisse de bain linguistique n’y change rien. Puisque pourtant l’on considère, à bon droit selon le linguiste suisse, que « le même mot » est prononcé lorsque nous annonçons avoir acheté du pain, et lorsque notre enfant en réclame un morceau, prend ici tout son sens le fait qu’un signe est considéré comme identique à lui-même, non pas parce qu’il serait bel et bien, matériellement parlant, identique à lui-même, mais parce qu’il possède dans ces deux occurrences, relativement aux autres signes, une même « valeur » différentielle. Comme l’écrit Johannes Fehr, « les signes linguistiques ne sont jamais susceptibles d’une détermination absolue, mais seulement et en permanence d’une détermination par rapport à d’autres signes du même système » (Fehr 2010, 139). Saussure l’a écrit lui-même avec toute la netteté possible : « le présent d’une forme est dans les formes qui l’entourent de moment en moment (< choses qui sont hors d’elles >) et qui ne dépendent pas d’elle […] » (CLG/E(II), 28).
Il est tout à fait remarquable dans cette perspective que l’un des passages où le Cours de linguistique générale traite de l’écriture de manière favorable, en développant une comparaison avec la langue, soit précisément concentré sur cette question : Saussure y écrit que « la valeur des lettres est purement négative et différentielle » (CLG, 165), que « les valeurs de l’écriture n’agissent que par leur opposition réciproque au sein d’un système défini » (Ibid.) ou encore, de manière très frappante compte tenu de notre problème, que « le moyen de production du signe est totalement indifférent, car il n’intéresse pas le système » (CLG, 165-166).
Or, ces valeurs différentielles supposent, non seulement des signes isolés, des atomes linguistiques, mais bel et bien un système de différences entre eux. Un système qui n’est le fruit d’aucune convention, d’aucune décision à proprement parler, qui ne possède nulle fixité, mais un système néanmoins, en cela qu’il est doté d’une certaine autonomie relativement à tous les usages que l’on peut en faire, et qui commande, ou plus précisément contraint, ces usages. C’est cette autonomie, cette vie propre, que semble désigner, chez Saussure, le caractère social de la langue, affirmé avec netteté dans le Cours et dans les inédits. Il y est clair que la caractérisation de la langue comme système social est la condition sine qua none de l’identité – toute relative donc, et purement différentielle, mais pas moins réelle – des signes. « La langue est sociale, dit Saussure, ou bien n’existe pas » (CLG/E(I), 28). Ce qui compte, et ce qui ne compte pas, dans l’évaluation d’un signe, voilà qui ne dépend pas de nous. La vie propre des signes, de la langue « défend alors d’en faire ni un langage fixe ni un langage conventionnel, puisqu’il est le résultat incessant de l’action sociale, imposé hors de tout choix » (CLG/E(II), 35).
Certes, en ce sens, la langue est d’abord une « masse », un agrégat, et c’est « seulement secondairement que ces entités sont classées en fonction de leurs ressemblances et de leurs différences, c’est-à-dire organisées en série. Mais c’est aussi seulement à cette condition que la langue permet de parler » (Maniglier 2006, 206). La systématisation de la langue, bien que seconde, est la condition de la parole en tant qu’elle n’est livrée ni hasard, ni à la libre volonté de chacun, mais qu’elle est dotée d’une valeur sociale. Comme l’écrit Saussure :
Nous voyons immédiatement beaucoup mieux qu’avant que c’est uniquement le fait social qui créera ce qui existe dans un système sémiologique. Où existe-t-il, dans un ordre quelconque, un système de valeurs si ce n’est de par la collectivité ? (CLG/E(I), 255)
Si l’on prend à présent en considération cette définition sociale de la langue, et ce caractère systémique – systémique quoique mouvant, et même systémique parce que mouvant[…] la (les) langues sont nécessairement et toujours "jetées dans la circulation" » (Fehr 2010, 100-101).in fine livré à la seule spontanéité créatrice des personnes qui y sont engagées. La motivation du signe se veut incessante, renouvelée par chaque parole ; nul arbitraire ne peut être pensé, nulle nécessité proprement sociale de la langue ne peut être identifiée. Ainsi, le problème ne serait pas tant que Merleau-Ponty ignorerait le point de vue de la langue, mais qu’il essayerait de le reconquérir incessamment à partir de la parole, et qu’il négligerait par là même la productivité propre à la langue comme « fait social ».
En effet, tous ses textes consacrés au langage permettent de le constater : contre le « conventionnalisme » qu’il a lu dans le Cours, Merleau-Ponty a une préoccupation majeure : rendre compte de la manière dont le sens d’une parole, loin de lui être fourni par une pensée qui lui préexisterait, est irréductiblement solidaire de son énonciation, « pris dans la parole » (Merleau-Ponty 2009, 222). Le problème est que, pour cela, Merleau-Ponty doit décrire le « miracle de l’expression » (Ibid., 375), c’est à dire « ce geste ambigu qui fait de l’universel avec le singulier, et du sens avec notre vie » (Merleau-Ponty 1969, 203, nous soulignons). Et il y a bien « miracle » ici, car Merleau-Ponty en est plus que conscient : par essence, le sens linguistique n’est pas idiosyncrasique, singulier, ou simplement intersubjectif, il est « universel ».
Depuis La structure du comportement, le phénoménologue français caractérise l’homme par le fait qu’il est doté d’une raison
c’est une question de savoir comment s’instaurent par là-dessus les « idées de l’intelligence », comment del’idéalité d’horizonon passe àl’idéalité « pure »,et par quel miracle notamment à lagénéralité naturellede mon corps et du monde vient s’ajouter unegénéralité créée, une culture, une connaissance qui reprend et rectifie la première (Ibid., nous soulignons).
Or, pour penser cet ajout, une chose est claire pour Merleau-Ponty : l’on ne peut se reposer sur la convention linguistique, c’est-à-dire sur l’institution linguistique déjà réalisée, car, comme il l’explicite dans son cours sur la nature dans la lignée de sa thèse de 1945convention même présuppose une communication avec soi ou autrui, ne peut apparaître que comme variante ou écart par rapport à une communication préalable » [Note originale] (Merleau-Ponty 1995, 282).
Loin de vouloir penser la parole grâce à la langue, Merleau-Ponty prétend donc penser la langue grâce à la parole. À l’arbitraire saussurien, Merleau-Ponty oppose donc, non la nécessité d’un système social, mais la motivation d’un geste incarné. Le problème est qu’il se trouve ainsi contraint de penser l’émergence (« miracul[eus]e » !) d’un universel, saisissable par différents actes d’énonciation, à partir d’un geste singulier, celui du sujet parlant – ou écrivant. Notre thèse est que, réitérant sans cesse ce geste de fondation, Merleau-Ponty reste aveugle à ce que permet la définition de la langue comme système social – ou égaré par ce qu’elle semble induire à ses yeux – et s’éloigne en tout état de cause du cœur de la théorie saussurienne.
Nous l’avons montré ailleurs : jusqu’à la fin des années 50, Merleau-Ponty tente par divers moyens de fonder la langue dans la parole, mais échoue (cf. Roux 2016a et 2016b). Les commentateurs ont fait valoir qu’apparaissaient pourtant dans les écrits merleau-pontiens de la fin des années 50, non pas exactement une philosophie de la vérité et du langage aboutie, mais des ressources nouvelles pour penser l’émergence de cet autre symbolismePhénoménologie de la perception (Merleau-Ponty 2009, 163).
Au début de l’année 1960, Merleau-Ponty commente ainsi les implications de sa nouvelle pensée sur le langage : « les significations ne sont que des écarts définis » (Merleau-Ponty 1964, 286). Pour être précis, il faut noter que, dans le contexte original, cette formule sert surtout à indiquer que les significations sont des écarts, et donc que la vérité ne peut jamais être univoque, dans la mesure où elle implique toujours une pluralité de possibilités, une richesse de sens. Merleau-Ponty insiste ainsi sur le fait que la réversibilité (c’est-à-dire le retour sur l’invisible et son élucidation) n’est jamais totale, même lorsqu’elle s’appuie sur la sédimentation du sens, pour la raison que le sens ne se donne que dans les signes, dans la parole, et qu’il est donc par là même entaché (nourri !) de la richesse du sensible. C’est la condition même du sens, la condition même de la réversibilité de ne pas être totale, de ne pas être parfaite. Submerge dans cette note néanmoins cette idée de « définition », qui fait écho au concept de « structure formulée » que l’on trouve au même endroit.
Pointe ainsi dans ces textes, associée à cette idée de sédimentation, la thèse d’une hétérogénéité du corps du langage par rapport au corps du monde sensible
L’idéalité pure n’est pas elle-même sans chair ni délivrée des structures d’horizon : elle en vit, quoiqu’il s’agisse d’une autre chairet d’autres horizons (Merleau-Ponty 1964, 198).
Le parole se donne ainsi un corps « plus maniable » (Ibid., 194), « un corps moins lourd, plus transparent, comme si elle changeait de chair, abandonnant celle du corps pour celle du langage, et affranchie par-là, mais non délivrée de toute condition » (Ibid., 198). Le geste de sédimentation serait ainsi celui par lequel Merleau-Ponty parviendrait à fonder la langue comme institution, et donc à réfuter totalement son caractère arbitraire.
Selon nous, cette tentative échoue ou, plus précisément, elle ne peut s’accomplir qu’au prix d’un scepticisme qui écarte la philosophie du langage de Maurice Merleau-Ponty de celle de Ferdinand de Saussure. Car chez Merleau-Ponty, la sédimentation se trouve sans cesse relativisée, la thèse portant sur son pouvoir de conservation du sens étant inextricablement entremêlée avec l’idée de sa nécessaire déperdition. Si on le suit, la valeur d’un signe ne peut jamais se conserver par-delà les différents gestes linguistiques. Paradoxalement, la vitalité de la langue est pensée comme contraire à l’identité des signes, et non l’identité pensée dans la vie. Corrélativement, pour Merleau-Ponty, on ne peut jamais dire « la même chose » en différentes occasions. Le point de vue de la langue nous semble par là même perdu.
Comme le développe Renaud Barbaras, la quasi-corporéité du sens linguistique prend chez le dernier Merleau-Ponty deux formes : la voix, tout d’abord, et l’écrit. Or, pour fonder la langue dans le geste du sujet, est nécessaire non seulement la circonscription de l’invisible « dans des restes visibles », mais aussi qu’une identité (différentielle) de cette circonscription puisse être pensée. Or, pour cela, la sédimentation seule – la circonscription de l’invisible – ne peut suffire, il importe que celle-ci puisse être évaluée, hiérarchisée, ordonnée, et qu’elle soit elle-même différentielle. Comme l’écrit Saussure, il faut qu’on ait le droit d’« appeler [le signe] le même », et corrélativement, le différent.
Or, la sédimentation du sens dans les sons apparaît à première vue, dans les derniers écrits de Merleau-Ponty, comme le moyen, non seulement d’une circonscription de l’invisible, mais d’une réflexivité qui pourrait être le lieu d’une évaluation du sens, d’un retour du sujet sur lui-même. En réalité, comme le souligne Françoise Dastur, la relation est inverse. Chez Merleau-Ponty, la sédimentation est possible parce que la langue peut « se prendre pour objet », et non le contraire :
[S]i mes paroles ont un sens, ce n’est pasparce qu’ellesoffrent l’organisation systématique que dévoilera le linguiste, c’est parce que cette organisation, comme le regard, se rapporte à elle-même (Merleau-Ponty 1964, 199).
Mais alors, cela suppose que la réflexivité en question est première par rapport au point de vue de la langue : de fait, la réversibilité dont il est question ici n’est pas le propre du langage, mais caractérise la chair en général et c’est en étendant « la réversibilité qui définit la chair […] dans d’autres champs » (Ibid., 187) que Merleau-Ponty analyse la réversibilité propre au langage. C’est tout à fait clair par exemple lorsqu’il écrit : « Comme il y a une réversibilité du voyant et du visible […] il y a une réversibilité de la parole et de ce qu’elle signifie. » (Ibid., 199) Mais peut-on fonder un ordre linguistique à l’aide de caractères propres à la chair ? Dans la mesure où celle-ci se trouve caractérisée par une forme d’universalité et d’indistinction (Cf. en particulier Barbaras 2008), il nous manque ici des critères qui permettraient de distinguer le même du différent.
Une piste serait de suivre une suggestion proposée par Renaud Barbaras, selon laquelle, pour « [rendre] compte de l’univers de la culture dans la plénitude de son sens » (Barbaras 1991, 342), il faudrait se référer à « l’écrit ». On peut en effet considérer que celui-ci, « en donnant à l’être idéal une existence sensible spécifique, lui offre une existence virtuelle. » (Robert 1998, 8). Nous assisterions alors à une validation prophétique de Derrida par la dernière philosophie de Merleau-Ponty.
Cette solution se trouve évaluée par Merleau-Ponty dans son cours sur L’origine de la géométrie de Husserl. Il y apparaît que la géométrie, en tant qu’elle est sédimentée dans des écrits – les signes mathématiques étant probablement ce qui ressemble le plus à du marbre dans la masse des écrits humains –, dispose d’une transparence plus grande que l’être naturel :
[L]a géométrie s’offre à moi comme un qqc qui n’a pas la réalité massive de l’être naturel, comme un certain manque ou creux, […] une négativité circonscrite, bref une ouverture. (Merleau-Ponty 1998, 33)
L’écrit est clairement doté dans ce texte d’une relation particulière à l’idéalité, et semble être, au moins a priori, gratifiéd’une capacité à atteindre une authentique forme de généralité, que Merleau-Ponty qualifie de « monumentale », ce qui suggère une forme d’institution supérieure, ou particulière en tous les cas.
L’Ecrit, fondement de la permanence et de la préexistence de l’idéalité. Mais l’Ecrit, ce n’est que parole figée, moyen de communication, sans plus ? Nullement: il faut expliciter le sens de l’Ecrit: on verra qu’il y a entre lui et l’idéalité Verflechtunget simultanéité.L’écrit est signes sensibles « publics ». Mais il est aussi appareil à Nacherzeugung:signification publique ou monumentale (Ibid.,78).
Le sens de l’écrit dispose d’une forme de « virtualité » (Ibid., 29), de « disponibilité », qui le rend « réactivable » : cela indique la possibilité de réidentifier « le même » sens dans différents contextes. Merleau-Ponty abonde ainsi dans le sens du Husserl tardif lorsque ce dernier affirme la nécessité, pour qu’il y ait pensée, que celle-ci soit sédimentée, sur le fait donc qu’il n’y a de sens que sédimenté, que l’idée n’est qu’en étant sédimentée. La sédimentation, écrit le phénoménologue français, est « nécessaire » (Ibid., 30):
Il n’y a sens, et particulièrement sens fécond, sens capable de fonder toujours et toujours de nouvelles acquisitions, que par sédimentation, trace (Ibid.).
Pour autant, et de nouveau, Merleau-Ponty exprime un clair désaccord quant à l’interprétation qu’il faut faire de ce lien entre pensée et sédimentation : cette dernière est nécessaire, mais il y a « impossibilité de la réactivation totale » (Ibid.)! Dans la mesure où la tradition instaurée par la sédimentation est toujours aussi oubli de la tradition, la sédimentation ne peut éviter qu’« aucune démarche n’est réactivable à part » (Ibid., 30-31): parler, ou penser, ou réfléchir, ou écrire, cela ne consiste jamais seulement à réactiver un sens sédimenté, mais cela implique de réinvestir celui-ci dans une démarche toujours singulière et par là même (c’est le point crucial) de le modifier. La pensée reste captive pour Merleau-Ponty de son expression située. Or, qu’elle en soit indissociable est une chose ; que cette situation prédétermine, positivement et négativement, mais surtout toujours de la même manière, sa conservation dans d’autres expressions situées en est une toute autre. Malgré la sédimentation du sens, le sens de ce que l’on dit, de ce que l’on écrit et de ce que l’on pense est toujours relatif à la situation historique dans laquelle il est repris : l’identité est relative, et surtout elle est pensée comme telle.
Cela seul permet de comprendre que Merleau-Ponty considère que Husserl « ne devrait pas maintenir formules intemporelles comme unbedingte Allgemeingültichkeit » (« validité générale inconditionnée », Ibid., 35). Au contraire,
l’Allgemeingültigkeitn’est pas inconditionnée : vaut pour tousà présent. Ne subsistera dans science ultérieure que sublimée dans conceptualisation nouvelle. Donc la science ne trouve pas le temps historique (Ibid.,36).
Le geste accompli par Merleau-Ponty est remarquable : il refuse que l’on disjoigne le sens de son expression linguistique temporellement située, il insiste donc sur « l’attache temporelle » (Ibid., 36) de l’idéalité, mais pour cette raison précise ne semble pas sortir de l’alternative de l’intemporel et du présent. Cela le mène à s’appesantir sur le fait que l’idéalisation est « toujours extensible, mais toujours partielle » (Ibid.), formule qui porte en creux un idéal d’idéalisation totale, par rapport auquel seulement l’incarnation du sens peut apparaître comme minorant son idéalité.
Ce que la sédimentation du sens dans l’écrit semblait pouvoir permettre d’identification et donc de ré-identification est ainsi immédiatement nuancé. Corrélativement, l’élucidation de ce en quoi pourrait constituer une évaluation de cet écart fait défaut. Est-il significatif ou non ? Fait-il qu’en l’occurrence le signe est doté de la même « valeur différentielle » ? Pour Merleau-Ponty, la réponse semble devoir être toujours négative. À nos yeux, manque donc dans l’édifice merleau-pontien une ultime norme, et donc en fait un ultime écart, un écart entre des écarts : ceux qui seraient considérés comme suffisamment petits pour être négligés et ceux qui seraient considérés comme trop grands pour l’être. Omettant ce point, Merleau-Ponty accuse au contraire l’écart au premier degré, ce qui donne un tour inévitablement sceptique à l’épistémologie merleau-pontienne.
Le phénoménologue français, conscient de l’écueil, se défend de tout relativisme, mais c’est pour affirmer que « tout présent contient tout, est absolu, tout est vrai et non tout est faux » (Ibid., 37). Serions-nous alors passés du Charybde du relativisme au Scylla de l’ultra-rationalisme hegelien ? Merleau-Ponty se défend encore : « Ce n’est pas une φ du savoir absolu à cause de la notion d’horizon » (Ibid.). La notion d’horizon fait en effet que la science a un « horizon d’avenir », où « sera recueilli ce qu’elle appelle vrai à présent » (Ibid.), mais ce recueil sera lui-même, toujours à cause de cette notion d’horizon, provisoire. Comme l’écrit Merleau-Ponty : « [C]et avenir aura lui-même un avenir, de sorte qu’il ne sera pas lui-même la vérité et ne demeurera pas absolument » (Ibid., 36). Tout est vrai, donc, mais tout est vrai dans un horizon infinioffen endlos » (Ibid., 46) ? – ; aujourd’hui, rien ne l’est.
Tentant de fonder la langue dans le geste du sujet, qu’il soit phonique ou graphique, et ainsi de contester tout arbitraire du langage, Merleau-Ponty aboutit à la thèse qu’en réalité nous ne sommes jamais vraiment autorisés à considérer qu’un signe est « le même », ni donc qu’il est « différent ». On ne peut que mettre cette conclusion en rapport avec la constatation que pour Merleau-Ponty – dans une étrange symétrie avec Derrida – l’écriture n’est au fond qu’une parole par d’autres moyens, ou que l’une et l’autre ne sont que deux traces différentes, deux gestes d’institution fondamentalement similaires.
En effet, comme nous l’avons indiqué à la fin de la première partie de ce texte, il est caractéristique que Derrida réagisse au « phonocentrisme » du Cours de linguistique générale (et plus généralement de l’ensemble de la métaphysique occidentale) en accordant un privilège à l’écriture, ou plus précisément à sa forme neutre en termes matériels, c’est-à-dire à l’archi-écriture. En promouvant le concept de différance, il marque l'inévitable espacement de la signification par rapport à elle-même, l’introuvable présence du sens à lui-même. Mais alors, Derrida semble mettre toutes les différences entre tous les signes sur le même pied. La différance, in fine, engloutit les différences.
La proximité avec Merleau-Ponty s’impose au regard. Nous espérons que ce qui précède a permis de l’éclairer : notre thèse est précisément qu’une juste compréhension de l’arbitraire du signe saussurien doit permettre, non de mettre toutes les différences dans le même panier (y compris donc celles des signes écrits et des signes parlés), mais de les ordonner. Cet arbitraire n’est pas un chaos, c’est l’arbitraire d’un système, qui n’exclut ni la motivation ni la nécessité, du fait précisément de cette nature « sociale » de la langue que Derrida comme Merleau-Ponty semblent négliger, ou sous-évaluer. Cette dimension systémique et sociale de la langue ne signifie certainement pas que chaque signe aurait une valeur différentielle immuable – la langue évolue constamment ! –, mais elle suppose pourtant que des signes puissent être dotés, dans différentes situations d’énonciation, d’une même valeur différentielle, qui les distingue des autres signes. La conséquence de l’aveuglement, ou du refus, de Merleau-Ponty comme de Derrida à l’égard de ce qui fait le sel de la thèse saussurienne de l’arbitraire du signe n’est, selon nous, rien moins que sceptique. Car si toutes les différences entre tous les signifiants, et donc entre tous les signes ont les mêmes implications, possèdent la même valeur, aucune identité du sens, même situé, même vivant, n’est jamais pensable. En tout état de cause, il faut prendre la mesure des conséquences considérables que cela entraîne en termes de vérité, et se demander si elles correspondent bien à nos usages de la parole.
Une question reste en outre en suspens : si l’on tâche de faire fonctionner cette lecture de Saussure, comment penser le problème de l’écriture ? Il semble qu’il faille dès lors poser la question des rapports entre « la langue » saussurienne, qui est a priori la langue que l’on parle, et la langue que l’on écrit dans les termes suivants : forment-elles ensemble un même système ? Peut-on, doit-on, ou non, considérer que le mot « arbre », lorsqu’il est prononcé ou lorsqu’il est écrit, constitue « le même signe » ? La différence constatée dans ce que Saussure appelle « le moyen de production du signe » est-elle ici significative, ou négligeable ?
Il ne nous revient pas de développer ici la réponse à cette interrogation mais il nous importe d’insister sur le fait que ce qui précède constitue, selon nous, la seule bonne manière de la présenter, et qu’il paraît clair de ce fait que la réponse ne peut être unique et fixée a priori, mais doit dépendre du sens de la recherche linguistique menée, c’est-à-dire de l’enjeu de la question par le biais de laquelle le « système » de la langue est abordé.
Il semble en effet que, dans certaines circonstances, le fait qu’un mot soit écrit ou prononcé oralement est bien moins déterminant que le fait que ce soit tel mot, et non tel autre, qui soit énoncé. Imaginons par exemple un contexte de conférence où, pour ne pas gêner l’orateur, je répondrais par un petit mot écrit à la question qui m’aurait été chuchotée. Bien sûr, dans un tel cas, il n’est pas indifférent que j’aie choisi d’écrire au lieu de chuchoter à mon tour – il est possible par exemple que je signifie par-là à mon interlocuteur son manque de discrétion, ou que je réagisse ainsi à un regard réprobateur adressé par l’un des membres de l’assemblée – mais cela ne semble pas l’être évidemment plus que si je réponds à un hurlement par un chuchotement, ou inversement, et il est par ailleurs raisonnable de penser que le contenu de ma réponse est ici plus, ou tout autant, significatif que le moyen par lequel je l’adresse. La valeur socialement attachée à un signe écrit ne semble ni évidemment différente ni évidemment identique dans toutes les circonstances à celle qui se trouve attachée à un signe énoncé oralement. Si l’on adopte le point de vue saussurien sur la question, la prise en compte dans l’équation du fait que la langue est un système social semble en tout cas indispensable.
- Chiss Jean-Louis, Puech Christian (1980) "Derrida lecteur de Saussure: pourquoi une "mise en crise" philosophique du cours de linguistique générale ou comment ne pas faire l'histoire de la linguistique?", Linx 2, pp.339-359.
- Anis Jacques, Chiss Jean-Louis, Puech Christian (1988) L'écriture: théories et descriptions, Bruxelles, De Boeck.
- Barbaras Renaud (1989) "Phénoménalité et signification dans Le visible et l’invisible", Les Cahiers de Philosophie 7, pp.25-68.
- Barbaras Renaud (1991) De l'être du phénomène: sur l'ontologie de Merleau-Ponty, Grenoble, Millon.
- Barbaras Renaud (2008) "Les trois sens de la chair: Sur une impasse de l'ontologie de Merleau-Ponty", Chiasmi International 10, pp.19-32.
- Benveniste Émile (1939) "Nature du signe linguistique", Acta Linguistica 1, pp.23-29.
- Bimbenet Étienne (2003) "Une nouvelle idée de la raison: Merleau-Ponty et le problème de l'universel", in: Marie Cariou; Renaud Barbaras; Étienne Bimbenet; (ed), Merleau-Ponty aux frontières de l'invisible, Paris, Vrin, pp.51-66.
- Bimbenet Étienne (2004) Nature et humanité: Le problème anthropologique dans l'oeuvre de Merleau-Ponty, Paris, Vrin.
- Bota Cristian, Bronckart Jean-Paul (2010) "Dynamique et socialité des faits langagiers", in: Bronckart Jean-Paul; Bulea Bronckart Ecaterina (ed), Le projet de Ferdinand de Saussure, Genève, Droz, pp.193-213.
- Bouquet Simon (1997) Introduction à la lecture de Saussure, Paris, Payot.
- Bouquet Simon (2004) "Saussure unfinished’s semantics", in: Sanders Carol (ed), The Cambridge Companion to Saussure, Cambridge, Cambridge University Press, pp.205-218.
- Catach Nina (1988) Pour une théorie de la langue écrite, Paris, CNRS.
- Colonna Fabrice (2014) Merleau-Ponty et le renouvellement de la métaphysique, Paris, Hermann.
- Culler Jonathan (2003) "L'essentiel de l'arbitraire", Cahiers de l'Herne 76, pp.52-61.
- Derrida Jacques (1967) De la grammatologie, Paris, Editions de Minuit.
- Derrida Jacques (1968) "Sémiologie et grammatologie: Entretien avec Julia Kristeva", Informations sur les sciences sociales 7 (3), pp.n/a.
- Engler Rudolf (1964) "Théorie et critique d'un principe saussurien: l'arbitraire du signe", Cahiers Ferdinand de Saussure 19, pp.n/a.
- Engler Rudolf (1964) "Compléments à l'arbitraire", Cahiers Ferdinand de Saussure 21, pp.n/a.
- Fehr Johannes (2000) Saussure entre linguistique et sémiologie, Paris, Presses Universitaires de France.
- Foultier Anna Petronella (2013) "Merleau-Ponty's encounter with Saussure's linguistics: misreading, reinterpretation or prolongation?", Chiasmi International 15, pp.123-142.
- Gandon Francis (2012) "Saussure poéticien: la tâche aveugle de l'écriture", in: Bédouret-Larraburu Sandrine; Prignitz Gisèle (ed), En quoi Saussure peut-il nous aider à penser la littérature, Pau, Presses Universitaires de Pau et des Pays de l’Adour, pp.81-95.
- Godel Robert (1982) "Retractatio", Cahiers Ferdinand de Saussure 35, pp.29-52.
- Harris Roy (2003) "L'écriture: pierre d’achoppement pour la sémiologie saussurienne", Cahiers de l'Herne 76, pp.228-233.
- Joubert Claire (2006) "Saussure rereads Derrida: language and critique", European Journal of English Studies 10 (1), pp.49-62.
- Kristensen Stefan (2009) "Corps et symbolisation: La philosophie du dernier Merleau-Ponty et la question d’une épistémologie de la chair", Chiasmi International 11, pp.321-338.
- Maniglier Patrice (2006) La vie énigmatique des signes: Saussure et la naissance du structuralisme, Paris, Léo Scheer.
- Merleau-Ponty Maurice (1952) "Sur la phénoménologie du langage", in: Van Breda Herman Leo (ed), Problèmes actuels de la phénoménologie: actes du Colloque international de phénoménologie. Bruxelles, avril 1951, Paris, Desclée de Brouwer, pp.89-109.
- Merleau-Ponty Maurice (1960) Signes, Paris, Gallimard.
- Merleau-Ponty Maurice (1964) Le visible et l'invisible, Paris, Gallimard.
- Merleau-Ponty Maurice (1968) Résumés de cours, Collège de France 1952-1960, Paris, Gallimard.
- Merleau-Ponty Maurice (1969) La prose du monde, Paris, Gallimard.
- Merleau-Ponty Maurice (1995) La nature: Notes, cours du Collège de France (edited by Séglard Dominique), Paris, Seuil.
- Merleau-Ponty Maurice (1998) Notes de cours sur L'origine de la géométrie de Husserl: suivi de R. Barbaras (dir.), Recherches sur la phénoménologie de Merleau-Ponty (edited by Barbaras Renaud), Paris, Presses Universitaires de France.
- Pétroff André-Jean (2004) La langue, l'ordre et le désordre, Paris, L'Harmattan.
- Puech Christian, Chiss Jean-Louis (1983) "La linguistique et la question de l'écriture: enjeux et débats autour de Saussure et des problématiques structurales", Langue française 59 (1), pp.5-24.
- Ricardou Jean (1995) "Le retour de l'écrit dans l'impensé de la parole et de la langue", Linx 7, pp.395-421.
- Ricoeur Paul (1967) "New developments in phenomenology in France: the phenomenology of language", Social Research 34 (1), pp.1-30.
- Robert Franck (1998) "Présentation", in: Merleau-Ponty Maurice, Notes de cours sur L'origine de la géométrie de Husserl: suivi de R. Barbaras (dir.), Recherches sur la phénoménologie de Merleau-Ponty, Paris, Presses Universitaires de France, pp.8.
- Robert Franck (2005) Phénoménologie et ontologie: Merleau-Ponty lecteur de Husserl et Heidegger, Paris, L'Harmattan.
- Roux Jeanne-Marie (2016) "L'inassignable différence du vrai et du faux: Le problème du langage dans les cours de Merleau-Ponty sur la littérature", Lebenswelt. Aesthetics and Philosophical Experience 9, pp.84-99.
- Roux Jeanne-Marie (2016) "Forme du perçu, structure du langage: Merleau-Ponty avec et contre Saussure", Bulletin d'Analyse Phénoménologique 12 (2), pp.275-292.
- Saussure Ferdinand de (2002) Écrits de linguistique générale (edited by Engler Rudolf, Bouquet Simon), Paris, Gallimard.
- Stawarska Beata (2013) "Uncanny errors, productive contresens: Merleau-Ponty's phenomenological appropriation of Ferdinand de Saussure's general linguistics", Chiasmi International 15, pp.151-165.
- Stawarska Beata (2015) "Derrida and Saussure on entrainment and contamination: shifting the paradigm from the course to the Nachlass", Continental Philosophy Review 48 (3), pp.297-312.
- Stawarska Beata (2015) Saussure's philosophy of language as phenomenology: Undoing the doctrine of the course in general linguistics, Oxford-New York, Oxford University Press.
- Testenoire Pierre-Yves (2016) "Sur la conceptualisation de la langue écrite dans les théorisations linguistiques du début du XXe siècle", Dossiers d'HEL 9, pp.34-46.
- Testenoire Pierre-Yves (2017) ""Le langage est une institution SANS ANALOGUE (si l'on y joint l'écriture)": l'écriture comme problèmes dans la réflexion théorique de Saussure", Semiotica 217, pp.117-133.