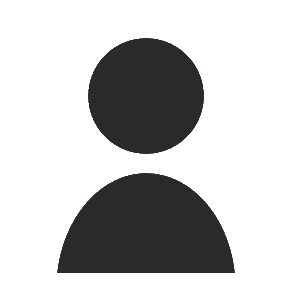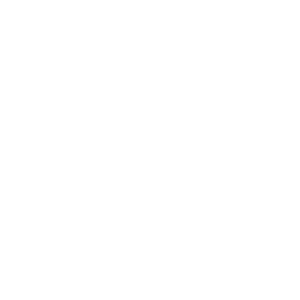This document is unfortunately not available for download at the moment.
Saussure, 1896
une publication saussurienne inconnue et ses manuscrits (BGE AdS 369/10, Ms.fr. 3970/c, AdS 383/13)
Alessandro Chidichimo
pp.
no publication statement available
Written by OpenOffice
Que valent en effet les spéculations les plus hardies,
si elles sont menées sur un matériau fautif,
ou lacunaire ou « apocryphe », comme on le dit parfois ?
Christian Puech, 2000, p. 15
Car il est difficile d’accorder créance aux documents dans leur ensemble.
Les hommes acceptent sans examen les récits des faits passés,
même ceux qui concernent leur pays.
Thucydide, La guerre du Péloponnèse, XX, 1
L’histoire de la connaissance et de la réception de Saussure est liée au destin de la philologie saussurienne et des sources manuscrites. Le Cours de linguistique générale et les autres textes de linguistique générale, mais aussi ceux de thématiques différentes, ont été publiés à partir de la recherche philologique et de l’édition des documents par les chercheurs qui se sont aventurés dans le travail d’établissement des textes de la main de Saussure et de ses élèves. Les manuscrits, dans le cas de la linguistique générale saussurienne, tout comme dans d’autres recherches qui n’ont pas été publiées par Saussure, sont caractérisés par l’absence d’un texte final On peut penser par exemple aux recherches sur les Anagrammes, les Légendes germaniques, les manuscrits des Notes Item. Texte final est une notion issue de la critique génétique textuelle (cf. entre autres De Biasi 2011, p. 101)., caractéristique. C’est le corpus, constitué par les manuscrits, souvent inédits, qui permet de regarder la totalité de l’œuvre de Saussure et l’histoire de sa diffusion dans les sciences humaines
Le manque d’un texte final pour des sources manuscrites rend possible une multiplication des hypothèses de recherche afin d’essayer de combler le vide créé par l’absence de documents et par l’absence de l’auteur
C’est le cas du texte de Ferdinand de Saussure imprimé en 1896 que je publie ici et qui était jusqu’à aujourd’hui inconnu, mais dont certains brouillons manuscrits ont été déjà publiés liés à divers contextes de l’écriture et de la biographie de Saussure. Ce texte est paru dans la brochure de présentation des activités de l’Université de Genève, L’Université de Genève et ses ressources, publiée par le Département de l’Instruction Publique de Genève [DIP] Une copie de cette brochure se trouve dans le catalogue de la Bibliothèque de Genève sous la cote BGE Ac 176, mais personne ne l’avait encore remarqué et j’ai eu la chance de la retrouver en 2011. Sur la couverture on trouve, noté à la main « août 1896» (voir images 1). Cette date correspond probablement à la date d’acquisition par la bibliothèque. Une autre copie se trouve aux Archives d’État de Genève sous la cote AEG 86/Cc/24.. Dans cette brochure figurent des textes sur plusieurs aspects de l’Université et des cours dispensés par les diverses facultés et, en ce qui concerne les enseignements de Saussure, par la Faculté des Lettres et Sciences sociales. À la page 58, on retrouve justement celui rédigé par Saussure lui-même pour présenter sa chaire et ses cours (voir images 1). Ce texte est donc une autre source à ajouter à la bibliographie saussurienne.
1. Texte de Ferdinand de Saussure, 1896, publié dans L’Université de Genève et ses ressources, p. 58
HISTOIRE ET COMPARAISON DES LANGUES INDO-EUROPEENNES. (M. Ferdinand de Saussure, professeur extraordinaire). – Dans le passé anté-historique d’une langue est contenu, jusqu’à plusieurs siècles de distance de son premier monument écrit, presque tout ce qui peut en donner la clef, soit au point de vue grammatical, soit au point de vue phonétique. On ne cesse que nominalement de faire de la linguistique indo-européenne en étudiant même dix ou quinze siècles après les Hymnes le trésor des formes sanscrites, et même après Alexandre le trésor des formes grecques conservé dans les inscriptions Dans les années précédant la rédaction et la publication de ce texte, dans les notes pour les premières leçons du cours de Phonétique du grec et du latin de l’année académique 1891-92, Saussure avait affirmé qu’il n’y a pas de langues mères ni de langues filles et que dans la langue il y a les principes de continuité et de discontinuité (cf. CLG/E 3283-3285, Sechehaye 2010, Sechehaye 1909-10, Chidichimo à paraître).
Les cours d’indo-européen, dans les facultés où il est institué, reste libre de vouer son attention plus particulière à ces périodes historiques – et divergentes, - ou au contraire à la période anté-historique où les idiomes se rejoignent en un seul.
Le cours fait à Genève depuis 1891, s’est en ce qui le concerne, préoccupé surtout des périodes historiques, et de celles qui pourraient avoir un intérêt pratique pour les étudiantsDans la perspective des discussions autour des enseignements de Saussure, il faut souligner deux perspectives à propos de l’emploi du terme ‘pratique’. En premier lieu, il s’agit de penser que l’affirmation par rapport à l’importance, dans la planification des cours, de l’aspect pratique pour les étudiants, concerne le fait de considérer que le cours doit prendre en compte les besoins des étudiants. Cet aspect est aussi une problématique envisagée dans l’évaluation philologique et théorique du premier cours de linguistique générale de 1907, lorsque Saussure reprend les enseignements et les étudiants de Joseph Wertheimer (cf. Chidichimo 2017). La présence du public dans les objectifs du cours est présente également à Paris, durant l’année 1885-1886, lorsqu’en vertu du développement des compétences de ses élèves, il décide de se lancer dans des leçons plus avancées (cf. Joseph 2010). La référence aux étudiants définit de plus le public auquel ce texte de 1896 s’adresse, par exemple les étudiants eux-mêmes et, en général, le grand public qui visitait l’Exposition nationale suisse de Genève (voir infra). A bien regarder, en plus, en deuxième lieu, le terme ‘pratique’ fait référence à la manière dont la leçon devait se dérouler. Selon le modèle de l’École Pratique des Hautes Études les étudiants n’étaient pas sensé écouter passivement la leçon du professeur, mais ils pratiquaient par eux-mêmes l’analyse des textes laquelle devait inspirer et guider leurs connaissances. Je remercie M. John Joseph pour m’avoir indiqué cette deuxième interprétation du terme ‘pratique’ (voir infra encore sur le terme pratique).
Les principaux sujets proposés au cours des divers semestres ont été 1893-1894 SE (à propos des cours saussuriens sur le grec ancien des années ’90, cf. Murano 2017). 1893-1894 SH. 1894-1895 SE.Dialectes grecs et inscriptions grecques archaïques. Dans les cours genevois de Saussure le sanscrit sera toujours présent comme cours annuel à partir de 1891 jusqu’à la fin des enseignements saussuriens en 1912. Cf. pour les notes des étudiants BGE Ms.fr. 3971, 3 cahiers de cours et notes d’exercices par Henri Duchosal, 1896-1897. Pour les notes d’un des membres de l’école genevoise de linguistique, Serge Karcevski (1884-1955) au cours de Saussure de 1908 cf. Chidichimo en préparation.
2. Datation et contexte : l’Exposition nationale suisse de Genève, 1896
La raison pour laquelle le DIP avait décidé de publier cette brochure de diffusion à propos des activités de l’Université est très probablement liée à l’Exposition Nationale Suisse qui a eu lieu à Genève entre le 1er mai et le 15 octobre 1896 En plus de Ferdinand, parmi les participants de l’exposition se trouvent d’autres membres de la famille de Saussure, dont le père, Henri de Saussure (1829-1905), qui exposait des documents et des instruments dans le cadre de l’espace de la Société de Physique (cf. AEG/Exposition, 39/151a, 151e, T2/36.4, où l’on trouve les lettres adressées au comité de la Section XVII Éducation et Instruction), et le frère cadet, Horace de Saussure (1859-1926), exposant des peintures dans la section consacrée à l’art.. Les universités suisses étaient en fait présentes dans l’exposition dans la Section XVII - Éducation et Instruction L’exposition de Genève fut un grand événement qui mobilisa la ville de Genève pendant plusieurs mois, avant même le début officiel le premier mai 1896. Il y avait un journal officiel pour la chronique et les détails de l’exposition, le Journal Officiel de l’Exposition, où l’on trouve un article sur le Château de Vufflens, appartenant à la famille de l’épouse de Ferdinand de Saussure, Marie Faesch, et où Saussure se trouvait au moment de son décès en 1913 (cf. Muret 1896 ; pour un point de vue générale sur l’exposition, Wakil et Vaisse 2001). La première des réunions du groupe XVII Éducation et Instruction eut lieu le 28 avril 1894. Dans les procès-verbaux de ce groupe, on lit que la décision fut prise de produire des publications et de créer une commission. Les publications envisagées seront de plusieurs genres pour les divers domaines de l’éducation. .
L’association de la publication de Saussure et de la brochure à cet événement conserve une marge d’hypothèse. Sur la brochure, il n’y a pas, à la différence d’autres textes publiés à cette occasion, l’indication du lien avec l’exposition de 1896. Nous n’avons pas trouvé pour l’instant de correspondance à propos de cette brochure en particulier entre les lettres de Saussure ou dans d’autres archives À part les archives de Saussure, j’ai parcouru les correspondances d’Eugène Ritter (1836-1928), Charles Soret (1854-1904) et les lettres de Bernard Bouvier (1861-1941) et d’Eugène Richard (1843-1925) ainsi que celles présentes dans les archives de l’Exposition (voir la bibliographie).. Le dépouillement des archives de l’exposition de 1896, en particulier pour la section Éducation et Instruction, n’a pas révélé de détails ultérieurs à propos de cette publication (cf. AEG/Exposition), même si l’on parle des publications à préparer pour l’événement et d’une série de monographies, on ne parle pas directement de cette brochure. On retrouve également, dans les séances du Sénat académique, entre 1894 et 1896, des publications à préparer, mais cette publication en particulier n’est pas mentionnée (cf. AAP/Sénat, 24 octobre 1894). Il y a finalement une seule référence à une demande du DIP pour la rédaction d’une publication à propos de l’Inventaire des ressources de l’Université Dans les registres des séances officielles du Sénat, on peut lire en effet : « Le Chef du Dep[artemen]t de l’Instruction publique voudrait en outre que l’Université fasse une publication spéciale donnant l’inventaire des ressources de l’Université. - Il y aurait lieu
de pré
de faire
une réédition du travail de 1883 comprenant la liste des publications des Professeurs de l’Université. » (AAP/Sénat, 27 novembre 1895).
, donnant pratiquement le même titre que celui adopté au final pour la brochure avec le texte de Saussure. Mais le Sénat décide au contraire qu’il faudra produire un texte qui parle des publications et des statistiques de l’Université en suivant la même ligne qu’une publication précédente de 1883 (cf. AAP/Sénat, 27 novembre-14 décembre 1895, Ritter 1883 ; Soret 1896)
Une autre référence à l’Exposition se trouve dans le discours du Recteur du
Dies
Academicus
de janvier 1896 : « Notre université a cru de son devoir de participer à l’Exposition ; une surface relativement étendue lui a été réservée, et nous ne doutons pas qu’elle n’y fasse très bonne figure ; il est nécessaire qu’à côté des produits de l’industrie et du commerce, le public puisse constater les fruits du travail intellectuel de notre public. » (Martin 1896, p. 5-6). Et ensuite en 1897, par rapport aux ouvrages produits toujours à l’occasion de l’Exposition : « Deux ouvrages importants – une
histoire de l’Académie de Genève
, et un
Catalogue
des diverses publications de l’Université, l’un dû à la générosité de la Société académique et confié à la direction de M. Ch. Borgeaud, l’autre formé par M. Soret, vice-recteur, à la demande du Département de l’instruction publique – achèveront de mettre au jour les richesses de notre passé et les forces dont nous disposons pour l’avenir. » (Gourd 1897, p. 5).
. Donc, même si le Sénat n’a pas pris en charge cette demande de publication – qui en fait sera publiée sous le nom du DIP – et s’il a décidé de s’orienter ailleurs en produisant d’autres textes, cette
information est une pièce à conviction ultérieure pour soutenir l’appartenance du texte de Saussure à cette vague d’initiatives éditoriales entourant l’exposition de 1896
Dans les séances de la Faculté de Lettres on trouve l’argument de l’exposition envisagé le 5 novembre 1895 pour discuter de la proposition de réunir les ouvrages des professeurs dans une vitrine et avec la même reliure et ensuite, à la fin de l’exposition, que ces volumes soient donnés à la Bibliothèque de la Faculté. Mais dans ce cas il n’y a pas de trace de cette brochure (AAP/RS, 5 novembre 1895, p. 19). En lisant les registres de la Faculté de Lettres et Sciences sociales, on trouve des traces de la sollicitation du Commissaire de la section scolaire de l’exposition de la participation des professeurs avec l’exposition de leurs publications dans des vitrines : « (…) l’Université de Genève, qui avait essayé, semble-t-il, de grouper les publications émanées de ses professeurs en une vitrine, où, cependant, il manquait bien de volumes, et pas des moins importants. » (
cf.
Pittard 1896, p. 592, qui fait une présentation de l’exposition des universités pour le journal de l’exposition. Cf.aussi Yung 1896, qui trace une description générale de l’Université de Genève).
.
En plus des nombreuses initiatives éditoriales mises en place pour l’exposition, la décision fut prise de publier l’Histoire de l’Université en deux parties : une plus historique qui parcourait la création et le développement de l’académie genevoise (cf. Borgeaud 1900-1934) ; et une deuxième partie en plusieurs fascicules à propos des diverses facultés qui s’ajouteront en annexe aux trois volumes de la première partie dans un volume séparé (pour la Faculté de lettres cf. Bouvier 1896) Même si l’œuvre de Borgeaud sera terminée et publiée en 1934, en quatre volumes, la genèse de ce travail fut réalisé en 1894 en perspective de l’exposition de 1896 : « Entreprise, à l’occasion de l’Exposition nationale suisse de 1896, avec l’appui du Département de l’instruction publique et du Sénat universitaire, cette publication a pris, au cours de son exécution, des proportions imprévues, subi des retards inattendus. » (Borgeaud 1900, p. V ; l’œuvre fut soutenue aussi par la Société Académique de Genève). Au tout début des fascicules à propos des facultés est noté chaque fois « Mémoire rédigé, en 1896, à l’occasion de l’Exposition nationale suisse de Genève ». Cette dernière référence est reprise aussi par Naville 1914 qui compare les différences et les continuités dans l’Université depuis la publication du texte de Bouvier.. Dans la partie concernant la Faculté de Lettres, l’auteur, Bernard Bouvier (1861-1941), semble reprendre le texte de Saussure de la brochure du 1896. Cela confirme donc encore un fois la concordance du texte de Saussure avec les initiatives éditoriales autour de l’exposition. Voici ce qui écrit Bouvier quand il parle de la chaire de Saussure :
Nous avons indiqué déjà le caractère éminemment pratique des cours d’Épigraphie et de Pédagogie. La chaire de Langues indo-européennes, fondée en 1891, ne prit pas le titre de « Grammaire comparée » qui eût laissé le professeur libre de ne jamais entrer dans les réalités historiques pour elles-mêmes, mais celui d’« Histoire et comparaison des langues indo-européennes. » En conformité de ce titre, il évite de se renfermer dans la sphère spéculative des rapprochements entre différentes langues. La série des programmes fait voir qu’il a toujours proposé à ses étudiants l’étude précise d’une période de langue déterminée, qui, tout en permettant les rapprochements, puisse laisser après elle un acquis certain : lectures du sanscrit védique et classique ; lecture d’inscriptions grecques archaïques et dialectales ; lectures d’inscriptions cunéiformes perses ; lecture des textes gothiques d’Ulfilas ; ou bien : phonétique du latin, phonétique du grec, étude du verbe grec, tous sujets choisis pour diriger l’attention sur une période saisissable de la langue. (Bouvier 1896, p. 97-98)
Il semble évident lorsque l’on analyse les concordances textuelles, comme par exemple la référence à l’étude précise d’une période, ou encore le passage sur la liberté du professeur de s’occuper de certaines périodes historiques, que Bouvier eut le texte de Saussure sous la main et que le texte de ce dernier était donc diffusé durant cette même période (voir supra). On retrouve de plus une référence au titre de la chaire de Saussure, jusqu’en 1896 Histoire et comparaison des langues indo-européennes, qui, comme on le verra par la suite, est important pour l’attribution de certains documents. Un autre aspect est également utile pour voir les affinités entre les deux textes. Dans la section Études et étudiants (p. 95 et suivv.), Bouvier, en soulignant combien le plan d’étude et les méthodes d’enseignement ont été renouvelés, fait référence à l’aspect pratique de l’enseignement pour les étudiants, lesquels doivent mettre en pratique les compétences acquises. Cette référence à la pratique, possiblement avec des nuances différentes, revient tant dans le texte de Saussure que dans celui de Bouvier :
Le cours seul, monologue du professeur, est insuffisant. Il fait l’histoire de la science et démontre sa méthode, enseignant quelle voie il faut suivre pour étudier les faits et les classer, quels sont les problèmes essentiels, les questions importantes, et comment les résoudre. Mais à la théorie et à l’exemple de la méthode scientifique le professeur, s’il veut réellement faire naître des vocations et les diriger, doit joindre son application. (Bouvier 1896, p. 95).
La plupart des chaires importantes de notre Faculté ont depuis quelques années admis, à côté du cours théorique, le cours pratique. (Bouvier 1896, p. 96).
Même si la date de publication (1896) est déjà une donnée suffisante, on possède un indice ultérieur à l’encadrement historique. Saussure signe ce texte en tant que professeur extraordinaire en plaçant donc la possibilité de datation jusqu’à 1896. En effet, il aura ce titre jusqu’au tout début de l’année académique 1896-1897, lorsqu’il sera nommé professeur ordinaire (cf. AAP/RS 9 novembre 1896, p. 80 ; Arrêté du Conseil d’État, 23 octobre 1896 ; et voir infra). De plus, si le texte a été publié à l’occasion de l’exposition, qui a commencé le 1er mai 1896, cela signifie qu’il a été rédigé avant cette date (on verra par la suite qu’on peut anticiper le moment de la rédaction du texte avant le 14 avril 1896) Pour essayer d’établir une concordance par rapport aux temps de publication pour l’exposition, on peut penser au cas de Théodore Flournoy (1854-1920), psychologue genevois qui est lié à Saussure pour les recherches sur la synesthésie et la glossolalie, qui à l’occasion de l’exposition publie une brochure descriptive du Laboratoire de Psychologie dont la préface date du 2 avril 1896 (cf. Flournoy 1896).. Cet indice nous sert de termine ante quem pour la datation de ce document et de sa production. La question du titre du document et le nom de la chaire de Saussure aide en outre à faire de la lumière dans les analyses des manuscrits qui composent le dossier génétique ou avant-texte Tout comme la notion de texte final, celle de dossier génétique, ou avant-texte, est issue de la critique génétique textuelle : « Ensemble de tous les témoins génétiques écrits conservés d’une œuvre ou d’un projet d’écriture, et organisés en fonction de la chronologie des étapes successives. » (Grésillon 2016, p. 285). tout comme lorsque nous rentrerons dans les détails de l’histoire de la nomination de Saussure en tant que professeur ordinaire.
3.1 Les sources manuscrites : BGE AdS 369/10, f. 1r-1v
Les manuscrits composant le dossier de ce texte de Saussure sont multiples. Une première source se trouve dans le dossier constitué par des brouillons de lettres « à caractère personnel », BGE AdS 369/10, au f. 1r-1v (voir images 2). Les textes sur le recto et sur le verso ont deux finalités différentes. Sur le recto il s’agit justement d’un brouillon de lettre adressée au Doyen de la Faculté de Lettres et sciences sociales, Eugène Ritter :
[BGE AdS 369/10, f. 1r]ill.’ ou s’il s’agit de mots biffés avec ‘ill.’ ; les parties ajoutées par Saussure en marge ou interlinéaire sont indiqués entre ‘< >’.
Je suis d’avance prêt à
[une ligne vide]
quoique je ne vois pas quelle modification essentielle [
[plusieurs lignes vides]
Je tiendrais à donner ,
Mais précisément obligé
Et ne sachant pas si une séance de la Faculté n’aura pas lieu dans
[plusieurs lignes vides]
J’allais aujourd’hui-même vous écrire pour vous informer que je’aurais à m’absenter depuis le 17 pendant huit ou dix
PS. – Obligé de m’absenter depuis le 17 pend pour huit ou neuf jours <ainsi que [ill.]> j’allais aujourd’hui-même vous en informer et je <dois dem> précisément comme pr comme je voulais justement> Monsieur le Doyen, au cas où la Faculté tiendrait cet> l’intervalle de bien vouloir prévenir <avertir> ill.> de mon absence, si une <cette> question relative <au> <titre> à la chaire de sanscrit et indoeuropéen était revenait en discussion [ill.] une question qui intéresse la chaire de sanscrit & i[ndo-européen] revînt revient revenait à l’ordre du jour de la Fac[ulté]
De ce brouillon nous avons la version finale envoyée (cf. Saussure 2014, p. 247) et qui se trouve parmi les manuscrits de Ritter :
[BGE Ms.fr. 2557, f. 368-369]
Versoix 16 avril [1896]
Monsieur le Doyen
Vous avez bien voulu me faire savoir que la Faculté des Lettres, en émettant un préavis favorable à la transformation de la chaire de langues indo-européennes en chaire ordinaire, avait ajouté le vœu que cette chaire fut intitulée « Sanscrit et histoire des langues indo-européennes. »
Je déclare n’avoir pas d’objection à l’adoption de ce nouveau titre, qui se rapproche de quelques dénominations usitées pour le même enseignement dans d’autres universités. – Le titre précédent d’« Histoire et comparaison des langues indo-européennes » n’avait pas été choisi au hasard, mais j’avoue que les arguments que j’aurais à faire valoir en sa faveur son plutôt d’un ordre théorique et ne touchent pas le fond de l’enseignement qu’on peut entendre sous l’un de ces noms ou sous l’autre.
Il me sera permis de ne pas terminer cette lettre sans remercier la Faculté de la place très honorable et libérale qu’elle vient d’accorder aux études indo-européennes parmi les objets de son enseignement.
Veuillez agréer, Monsieur le Doyen, l’assurance de mes sentiments de considération respectueuse.
Ferd de Saussure
Obligé de m’absenter d’ici au 25 ou 26 de ce mois, ainsi que j’allais vous informer, je vous prierai, Monsieur le Doyen, de vouloir bien avertir mes collègues de la cause de mon absence s’il y avait séance dans l’intervalle et que la question de titre ci-dessus – ce que je ne suppose ni demande – fût remise en discussion dans cette séance.
Si dans le brouillon Saussure communique au Doyen le fait qu’il sera absent « pendant huit ou neuf jours », dans la version finale il précise les dates : il sera absent du 17 avril au 25 ou 26 avril 1896. Le brouillon date donc du 16 avril ou à la limite du 15 avril. Dans ces textes, il est question de la transformation de la chaire de Saussure d’extraordinaire à ordinaire et du nouveau nom de la chaire de Saussure et des discussions à ce propos lors des séances de la Faculté. On vient de voir que Saussure devient professeur ordinaire de la chaire de sanscrit et d’histoire des langues indo-européennes en 1896. Les deux documents (BGE AdS 369/10, f. 1r-1v, p. 1r et BGE Ms.fr. 2557, f. 368-369) datent de la période de la discussion de ce changement, l’année académique 1895-96, en particulier du printemps 1896, et dont nous trouvons trace aussi dans le premier semestre de l’année 1896-97, mais seulement pour la communication de la nomination (cf. AAP/RS, 9 novembre 1896, p. 80, voir infra). En effet, dans les registres des séances de la Faculté de Lettres et Sciences sociales la discussion sur la transformation de la chaire de Saussure a ouvert la séance du 5 mars 1896, alors même que Saussure était absent les séances de 1891 pendant lesquelles la Faculté discutait de sa première nomination : Saussure était à Paris et il n’était pas encore membre de l’Université de Genève. Il sera systématiquement absent, donc, durant les discussions à propos de la transformation et du nom de sa chaire. Au contraire en 1906, alors qu’il s’agissait de reprendre les enseignements et la chaire de linguistique générale de Wertheimer, il fut présent dans les séances de la Faculté quand ce sujet était à l’ordre du jour (cf. AAP/RS ; Chidichimo 2009). Comme on le verra par la suite, l’absence de Saussure aux réunions de la Faculté tant en 1891 qu’en 1896 est importante de par ses besoins d’écrire à des correspondants au sujet de sa chaire., inspirée par Francis De Crue (1854-1928)professeur ordinaire d’archéologie, d’épigraphie et de paléographie (1888-1898), d’histoire du Moyen-Âge et d’histoire moderne (1898-1927) et recteur (1916-1918) (cf. Fryba-Réber 2013, p. 278-279). Le 1889, De Crue avait sollicité Saussure pour la chaire de langues et littératures germaniques (cf. Reboul 2010, p. 219, et p. 230-231 pour la lettre de De Crue). J’ai déjà eu l’occasion de raconter cette histoire et d’utiliser ces citations dans Chidichimo 2017 (cf. Chidichimo 2017, p. 202). Je propose à nouveau ici certains passages pour des nécessités de clarté argumentative. qui prend l’initiative en introduisant cet argument, sans qu’il soit dans l’ordre du jour, et demande à la Faculté de proposer au DIP le changement en ordinaire de la chaire de Saussure, avec le nom de Sanscrit et grammaire comparée :
M. de Crue désirerait que la Faculté, tant en donnant un préavis favorable au sujet de la chaire de pédagogie, saisît l’occasion pour demander que le cours de sanscrit et grammaire comparée devînt aussi l’une des chaires ordinaires de la Faculté. Le haut mérite et la réputation du professeur chargé de cet enseignement sont les motifs que M. De Crue, et après lui M. Muret, fait valoir en faveur de cette proposition. (AAP/RS, 5 mars 1896, p. 41) Cette proposition arriva après le 28 mai 1894, lors du préavis favorable à la confirmation de Saussure en tant que professeur extraordinaire, alors que la Faculté avait communiqué au Président du DIP l’intention de faire devenir Saussure professeur ordinaire : « Toutefois, elle se remet à M. le Président du Département [de l’Instruction publique] pour le choix du moment le plus favorable à cette mesure. » (AAP/RS, 28 mai 1894). Mais bien que le DIP affirmait être favorable à la nomination de Saussure comme professeur ordinaire « (…) il estime seulement que les circonstances actuelles, aussitôt après la création d’une quatrième chaire de chimie, ne l’encouragent pas à la proposer et qu’il y a lieu, dans l’intérêt même de M. de Saussure, à attendre. » (AAP/RS, 14 juin 1894).
Mais d’autres collègues de Saussure ne sont pas de cet avis : « M. M. Nicole, Naville, Wuarin, Jaquemot tout en se déclarant très sympathiques à l’idée émise par M. De Crue estiment que le moment est inopportun pour faire la demande qu’il propose (…) » (AAP/RS, 5 mars 1896, p. 41). La Faculté retiendra donc de ne pas s’occuper tout de suite de la transformation de la chaire de Saussure en ordinaire. La discussion continuera dans la séance du 14 avril 1896 à la suite d’une lettre de réponse du DIP, sollicité toujours par De Crue, qui avait mobilisé d’autres collègues, par rapport au préavis sur la transformation de la chaire extraordinaire de Saussure en chaire ordinaire. La Faculté donne un préavis favorable avec dix voix en faveur et une abstention (AAP/RS, 14 avril 1896, p. 57). Joseph Wertheimer (1833-1908) Joseph Wertheimer, grand rabbin de la ville de Genève et professeur de linguistique et philologie à l’Université de Genève jusqu’en 1906. prend la parole en faveur de Saussure, mais en soulignant une distinction par rapport à sa propre chaire de Linguistique et philologie : « M. Wertheimer se déclare très favorable à la proposition, à laquelle il a déjà donné sa signature. Il propose que le sanscrit soit mis en vedette dans le titre qui serait donné à la chaire nouvelle » (AAP/RS, 1984/20/90 14 avril 1896, p. 57). La proposition de mettre le sanscrit « en vedette » dans le titre, semble répondre à l’exigence de maintenir la séparation entre l’enseignement de Wertheimer et celui de Saussure et évoque également ce qui était arrivé en 1891, lors du retour de Saussure à Genève (cf. Reboul 2010, Chidichimo 2010). Au titre du cours de ce dernier sera en fait ajouté à ce moment le sanscrit : « (…) la Faculté décide de proposer au Département, sous réserve de l’assentiment de M. F. de Saussure, le titre suivant pour la chaire ordinaire : Sanscrit et histoire des langues indo-européennes. » (AAP/RS, 1984/20/90 14 avril 1896, p. 57). L’assentiment de Saussure est la raison pour laquelle, comme on vient de le voir, dans la lettre que Saussure écrit au Doyen, le 16 avril 1896, à propos du nom de son enseignement il affirme que, même si d’un point de vue théorique il y aurait des choses à dire, le nom lui est indifférent et ne change pas la nature de l’enseignement :
Je déclare n’avoir pas d’objection à l’adoption de ce nouveau titre, qui se rapproche de quelques dénominations usitées pour le même enseignement dans d’autres universités. – Le titre précédent d’« Histoire et comparaison des langues indo-européennes » n’avait pas été choisi au hasard, mais j’avoue que les arguments que j’aurais à faire valoir en sa faveur son plutôt d’un ordre théorique et ne touchent pas le fond de l’enseignement qu’on peut entendre sous l’un de ces noms ou sous l’autre. (Saussure 2014, p. 249)
Et dont on trouve trace aussi dans le brouillon de la lettre qu’on a déjà vu :
[BGE AdS 369/10, f. 1r]
Je suis d’avance prêt à
[une ligne vide]
quoique je ne vois pas quelle modification essentielle [
Dans les registres des séances on voit de plus que la grammaire comparée, pour désigner la chaire de Saussure, fera son apparition à la place de l’histoire et comparaison du titre précédent, qui est encore présent dans la publication de 1896, dans la version de : Grammaire comparée des langues indoeuropéennes et sanscrit ou de Sanscrit et grammaire comparée. On voit donc que les variations du nom de la chaire de Saussure, entre discours officiels et privés, continueront encore (voir infra)donc s’il voulait intervenir dans la discussion devait justement le faire par correspondance.. Une autre variation se retrouve le 13 octobre 1896, quand le DIP demande à la Faculté de designer un délégué. De Crue aura cette fonction pour la commission qui sera convoquée pour préaviser sur la vocation de Ferdinand de Saussure à la chaire ordinaire d’Histoire et comparaison de langues indo-européennes et de sanscrit (AAP/RS, 13 octobre 1896, p. 76-77). Le nouveau doyen, Adrien Naville (1845-1930) Adrien Naville, professeur de logique, méthode et classification des sciences (1892-1909) et de philosophie et de classification des sciences (1909-1914) et Doyen de la Faculté des lettres et des sciences sociales de l’Université de Genève (1896-1902) (cf. Senarclens 2008). C’est l’auteur de la Nouvelle classification des sciences où apparait, pour la première fois, le terme sémiologie lié au nom de Saussure (Naville 1901, p. 103-106 ; CLG/D, p. 318-319, 331)., qui venait d’être nommé après Ritter, le 9 novembre 1896, annonce avoir reçu la communication du Sénat académique de la nomination par vocation de Saussure « à la chaire ordinaire de Sanscrit et histoire des langues indo-européennes. » (AAP/RS, 9 novembre 1896, p. 80 ; Arrêté du Conseil d’État, 23 octobre 1896). Et ce sera finalement ce dernier nom à être effectivement retenu Le 16 janvier 1897, à l’occasion du dies academicus de l’Université de Genève, la nouvelle de la nomination de Saussure au titre de professeur ordinaire de « Sanscrit et Histoire des langues indo-européennes » sera donnée par le Recteur de l’époque Jean-Jacques Gourd (1850-1909) (cf. Gourd, 1897, p. 4)..
Comme dans d’autres cas, avec d’autres auteurs (Charles Bally, 1865-1947, est un autre exemple genevois), Saussure ne conserve pas tous les brouillons préparatoires des textes publiés et il lui arrive d’en réutiliser le verso pour d’autres écrits. C’est le cas de cette feuille, utilisée pour la lettre au doyen que l’on vient de voir et qui présente en réalité un autre brouillon sur le verso (voir images 2) :
[BGE AdS 369/10, f. 1v]
[page déchirée] [pr]emière partie de l’histoire [page déchirée]
En comptant l’histoire depuis le monumen[ts] [page déchirée]
[biffé jusqu’à la fin du paragraphe ‘le premier’] La période initiale du latin, du grec, du germanique, du celtique, du slave, du baltique, de l’iranien et de l’hindou, appartiennentplusieurs siècles de distance après le premier
Chaque langue, jusqu’à plusieurs siècles de distance de son elle ne possède pas <formellement> d’autre passé que <point d’autre> [ill.] les états anté-historique de passé hors de <à invoquer> <que celui qui <le précède est> L’ante-historiquement les
Des indices et correspondances textuelles indiquent qu’il s’agit d’un brouillon du texte de Saussure publié dans la brochure de 1896. Dans ce manuscrit au dernier paragraphe, Saussure arrive à la version qu’on va lire sans les biffures :
Chaque langue, jusqu’à plusieurs siècles de distance du premier monument écrit, est dans l’incapacité naturelle d’être autre chose que la suite d’un passé anté-historique, puisqu’on ne lui voit pas d’autre passé que ce passé anté-historique.
Et dans le texte publié, de 1896, on voit la version finale du texte :
Dans le passé anté-historique d’une langue est contenu, jusqu’à plusieurs siècles de distance de son premier monument écrit, presque tout ce qui peut en donner la clef, soit au point de vue grammatical, soit au point de vu phonétique.
Dans ce même dernier passage la partie :
« jusqu’à plusieurs siècles de distance de son premier monument écrit » ;
se retrouve déjà dans le premier paragraphe tout biffé du brouillon de Saussure :
« La période initiale du latin, du grec, du germanique, du celtique, du slave, du baltique, de l’iranien et de l’hindou, appartiennentplusieurs siècles de distance après le premier » [BGE AdS 369/10, f. 1v] Cf. Appendice 3, A1-A2 et B1-B2.
Si l’on date entre le 14 et le 16 avril 1896 la page 1r, écrite après la séance de la Faculté du 14 avril, la page 1v serait donc la première à avoir été écrite (Saussure utilise donc le verso de ce texte pour la lettre au Doyen) ou la suivante (et le texte adressé au Doyen est donc le verso). Mais si l’on considère que l’Exposition nationale a eu lieu entre le 1er mai et le 15 octobre 1896, et que le texte a été rédigé avant pour laisser le temps de composer et imprimer la brochure, et qu’il circulait déjà lors de la rédaction du texte de Bouvier publié à cette occasion et que la lettre a été rédigée entre le 14 et le 16 avril 1896, alors on peut affirmer que la page 1v a bien été écrite en premier. De plus, si la lettre au Doyen était une communication officielle relative au changement important de la chaire saussurienne, il est bien possible qu’il en ait conservé le brouillon pour en avoir une trace. Enfin, d’un point de vue matériel, ce texte de brouillon de la lettre est entier, alors que celui sur le verso s’est partiellement perdu du fait que la page a été déchirée (voir images 2). Saussure aurait pu déchirer ce morceau de papier pour écrire le brouillon de la lettre sans se soucier du contenu sur le verso qui venait d’être publié ou était en train de l’être et qu’il avait probablement sous la main, si l’on considère qu’il venait de l’écrireouve sur le verso d’un brouillon de lettre a pu faire passer inaperçu son contenu. La nature épistolaire du recto a joué un rôle dans la classification par les archives de cette feuille entre la correspondance en détournant l’attention du verso. Cette situation est récurrente dans la gestion des documents par Saussure lui-même, qui réutilise le verso pour d’autres écritures. De plus, il nous montre la possibilité qu’une fois un texte publié, il pouvait ne pas garder les brouillons préparatoires ou employer à nouveau le verso blanc des manuscrits.. Cette donnée matérielle nous dit aussi que la feuille de brouillon était plus grande que celle utilisée pour la lettre. On verra par la suite qu’un format plus grand, de la dimension 21,5x26,9 centimètres, presque d’un format connu comme un A4 aujourd’hui, de celui de la lettre se retrouve aussi dans d’autres manuscrits en lien avec la production du texte de 1896.
Finalement, tant la présence du brouillon de la lettre sur le recto, avec la lettre envoyée, que les concordances textuelles, ne confirment pas seulement que le verso date également de l’année 1896, mais qu’il fait partie du dossier génétique du texte saussurien publié la même année dans la brochure de l’Université.
3.2 BGE Ms.fr. 3970/c, f. 61r-62v
Une autre source pour le texte de 1896 sont les deux pages appartenant au bifeuillet (composé de 4 pages de la dimension 26,9x21,5 centimètres), BGE Ms.fr. 3970/c, f. 61-62 Ce document a été déjà publié. Dans la transcription d’Angeli et Vallini 1990, p. 424-425, il y a des petites imprécisions que je signale en note de bas de page. Gambarara 2010 ne donne pas tous les passages biffés présents dans le manuscrit que j’insère ici. Par ailleurs, il publie d’abord la page 62v et ensuite la 61r en suivant une hypothèse de reconstruction de l’ordre d’écriture. Je présente ici la transcription complète du manuscrit (voir images 3).
[61r] On ne donnerait pas une mauvaise définition de la ling. indo-européenne, en disant que c’est aussi longtemps que les faits [
Ce mot d’anté-hist
Que chaque langue est obligatoirement dans la tutèle de [
[biffé jusqu’à ‘et en tel sens’]
----------------------
Le passé anté-historique qu’a par - divers une> chaque langue reste encore, longtemps après le
facteur
décisif de tout ce qui
se passe his
s’observe
historiquement chez
Angeli et Vallini 1990
onttranscrit ‘chex’.
elle
par la suite
subsi
[
stants
]
Angeli et Vallini 1990 ont transcrit ‘subséquents’ et ils ont ajouté ‘-équents’ (cette transcription a été reprise aussi par Gambarara 2010, p. 293). Par contre sur le manuscrit on peut lire clairement ‘subsi’. Je fais l’hypothèque qu’il s’agit de ‘
subsistants’.
>. C’est pourquoi la grammaire comparée indo-européenne, même réduite à s
on
plus stricte expression,
entame encore la période historique par les huit côtés
est très loin de
se borner au fait ante-hi
pouvoir passer pour se confiner dans l’anté-historique : elle entameo
des historiques considérables – cela> par les huit côtés
différents
du latin, du celtique, du germanique, du grec, du baltique, du slave, de l’iranien et de l’hindou
Voir
infrale document suivant au §2.2.
– et en tel sens [
Le passé anté-historique d’une langue est encore longtemps après le commencement
des
monuments écrits ce qui peut
historiquent
s’y traduire et produire historiquement [
[61v] [blanche]
[62r] [blanche]
[62v] (Histoire et comparaison des langues indo-européennes. - M. Ferdinand de Saussure, professeur extraordinaire).
-----------------
Le nom (souvent préféré) de „grammaire comparée et sanscrit“ ne diffère que par le nom.
Plusieurs concordances textuelles avec le texte publié en 1896 indiquent que ces deux pages ont été rédigées dans les années 1895-1896, ou mieux la période de la préparation et publication de la brochure de l’Université de Genève et, enfin, qu’elles font partie du dossier du texte publié. Si l’on commence avec l’intitulé du texte publié dans la brochure de l’Université, on voit qu’on le retrouve de manière identique dans le manuscrit et avec la même mise en page. Voici les deux versions :
[BGE Ms.fr. 3970/c, f. 62v] (Histoire et comparaison des langues indo-européennes. - M. Ferdinand de Saussure, professeur extraordinaire).
[Texte 1896] HISTOIRE ET COMPARAISON DES LANGUES INDO-EUROPEENNES. (M. Ferdinand de Saussure, professeur extraordinaire).
Toujours à la même page 62v, Saussure parle du nom de la chaire : « Le nom (souvent préféré) de „grammaire comparée et sanscrit“ ne diffère que par le nom. ». Et si la discussion autour de la présence ou non de la grammaire comparée dans le titre était déjà présente en 1891, le sanscrit dans les discussions et dans les textes de Saussure n’avait pas été envisagé à ce moment. Par contre, le sanscrit, présent dans ce document, fait son apparition à partir de 1896, quand il sera mis en avant dans le nom choisi pour la transformation de la chaire saussurienne en chaire ordinaire. Et si la date de rédaction du texte publié est proche de la discussion pour la transformation de la chaire et le conséquent changement du nom entre le 5 mars et le 14 avril 1896, alors on voit un reflet dans cette référence au sanscrit et dans l’interférence entre la transformation de la chaire et l’écriture de ce texte, qui se sont passés au même momentsupra la référence à la rédaction du texte de Flournoy pour l’exposition, rédigé le 2 avril 1896. Cf. Appendice 3, A3-A4, C3-C4..
D’autres ressemblances avec la publication de 1896 se retrouvent au tout début du manuscrit, à la page 61r :
[61r] On ne donnerait pas une mauvaise définition de la ling. indo-européenne, en disant que c’est aussi longtemps que les faits [
Ce mot anté-hist
Que chaque langue est obligatoirement dans la tutèle de [
On trouve dans la publication :
On ne cesse que nominalement de faire de la linguistique indo-européenne en étudiant même dix ou quinze siècles après les Hymnes le trésor des formes sanscrites, et même après Alexandre le trésor des formes grecques conservé dans les inscriptions. Cf. Appendice 3, A5, C5.
Des évidences philologiques ultérieures rajoutent de la certitude quant à l’évaluation du manuscrit BGE Ms.fr. 3970/c en passant aussi par BGE AdS 369/10, f. 1v que nous avons examiné précédemment. Dans le brouillon, dans la partie biffée par Saussure, toujours à la page 61r, les concordances avec la publication augmentent :
Le passé anté-historique qu’a par divers une> chaque langue reste encore, longtemps après les premiers monuments écrits, le
facteur
décisif de tout ce qui
se passe his
s’observe historiquement chez elle
par la suite
subsi
[
stants
]>.
Cette même partie est reprise dans la suite du manuscrit, cette fois sans être biffée :
Le passé anté-historique d’une langue est encore longtemps après le commencement
des
monuments écrits ce qui peut
historiquent
s’y traduire et produire historiquement
Dans le texte publié on trouve :
Dans le passé anté-historique d’une langue est contenu, jusqu’à plusieurs siècles de distance de son premier monument écrit, presque tout ce qui peut en donner la clef, soit au point de vue grammatical, soit au point de vue phonétique. Cf. Appendice 3, A6-A7, C6-C7.
On avait vu les concordances de ce même passage avec BGE AdS 369/10, f. 1v (voir supra), dont la datation et l’appartenance au dossier génétique ont été déjà établies, qui donc concorde aussi avec BGE Ms.fr. 3970, f. 61r. Si l’on continue toujours avec le document BGE AdS 369/10, on voit, dans les parties biffées de la page 1v
, un passage identique à celui que l’on vient de voir pour le manuscrit BGE Ms.fr. 3970/c. Dans les deux manuscrits, Saussure biffe ces mêmes passages :
La période initiale du latin, du grec, du germanique, du celtique, du slave, du baltique, de l’iranien et de l’hindou, appartiennentplusieurs siècles de distance après le premier [BGE AdS 369/10, f. 1v]
[…] elle entame o
des historiques considérables – cela> par les huit côtés
différents
du latin, du celtique, du germanique, du grec, du baltique, du slave, de l’iranien et de l’hindou [BGE Ms.fr. 3970/c, f. 61r]
Cf. Appendice 3, C8, B8.
Au-delà de ces indices textuels, une autre donnée matérielle nous permet de dater et déterminer l’appartenance de ces documents. D’un point de vue du matériel, ces deux pages BGE Ms.fr. 3970/c, f. 61-62 sont écrites sur un papier différent du reste du dossier 3970/c. Ce papier à carrés rouges du format de 26,9-21,5 centimètres, ne se retrouve qu’à partir des années 1890 dans divers dossiers de la même période genevoise, mais il ne semble pas être présent avant cette période et indique encore une fois une datation des années genevoises (cf. Chidichimo 2011, 2018), membre de la commission de la Section XVII Éducation et Instruction de l’Exposition de 1896, pour de la correspondance dans les mêmes années et toujours à Genève. Ce qui signifie que ce type de papier était couramment utilisé à Genève. Même si avec un apport explicatif inférieur, il s’agit d’encore une autre donnée qui va dans une direction similaire.
3.2.1 Analyse de la bibliographie à propos de 3970/c, f. 61r-62v
Si ces pages ne posent pas de difficultés du point de vue de la transcription et de la compréhension du texte, l’absence de texte final a par contre créé des problèmes philologiques et nourri la recherche pour ce qui est de la datation et de l’appartenance au dossier BGE Ms.fr. 3970 et, donc, de la compréhension du contexte historique et théorique de production. Cependant, la philologie est progressive. Chaque nouvelle pièce documentaire découverte, chaque nouvelle donnée, fait bouger le corpus saussurien et réorganise les liens entre les textes et les manuscrits. Chaque nouvelle pièce valide ou force à reformuler les hypothèses de recherche déjà publiées. En raison de cette même progressivité, les études précédentes, même si elles pourraient être partiellement contredites, ne perdent pas leur valeur qui se transforme, puisqu’elles s’avèrent nécessaires à l’avancement de la recherche.
La première nouvelle que nous avons des pages manuscrites liées à ce texte se trouve dans Angeli et Vallini 1990 qui ont publié tout le document BGE Ms.fr. 3970/c en l’attribuant aux années genevoises. Pour les auteurs, les pages 61-62 sont parmi les plus significatives du dossier :
Il foglio XXXVI, ossia quello che chiude il manoscritto, è apparso particolarmente significativo, al punto da essere riprodotto due volte : come excerptum in epigrafe nella sua intrinseca materialità in appendice. (Angeli et Vallini 1990, p. 370)
Si ce manuscrit est significatif Tous les chercheurs qui ont publié et utilisé ces pages parlent de l’importance de ces lignes, mais sans expliquer cette importance., grâce au texte et à la reconstruction qu’on publie ici, on peut affirmer qu’il ne fait pas partie des notes du cours publiées par les auteurs. L’hypothèse de datation d’Angeli et Vallini concerne le moment où Saussure commence à enseigner à Genève, soit l’année académique 1891-92 :
Seppure con le riserve sopra accennate, non è improbabile che il manoscritto sia l’abbozzo di tutto o parte di quel corso che l’autore tenne nel 1891-1892 davanti ad un uditorio ginevrino proprio sulla storia delle lingue indoeuropee. (Angeli et Vallini 1990, p. 372).
Contrairement à ce qu’affirment Angeli et Vallini, Saussure semble n’avoir jamais donné un cours sur l’histoire des langues indo-européennes (« sulla storia delle lingue indo-europee »), mais les auteurs ont probablement confondu entre le nom de la chaire et les noms des cours. En fait, les cours de Saussure pour l’année académique 1891-1892 furent : Semestre d’hiver et Semestre d’été, une heure par semaine d’Éléments de langue sanscrite ; deux heures par semaine de Phonétique grecque et latine (cf. AAP, Programme des cours de l’Université de Genève, années 1891-1913) et tous les témoins à disposition confirment cette donnée (cf. Linda 2001, p. 187-197 ; Sechehaye 2010 ; Chidichimo 2010).
Ensuite, si pour les deux pages, f. 61-62, il est vrai qu’il faut considérer la période genevoise – même s’il faut bouger de quelques années la datation, jusqu’à 1896 –, en ce qui concerne le reste du manuscrit il est possible qu’il faille penser à une date différente, comme l’a suggéré Mejia dans une note au catalogue des manuscrits de Saussure du Département des manuscrits de la Bibliothèque de Genève (cf. Mejia 2009). Selon Mejia ce cours date de la période parisienne, plus précisément d’un cours de 1887-88 à l’École des Hautes Études. Mais Mejia fait appartenir aussi le f. 61-62 à ce cours parisien :
Note(s) : Ms.fr. 3970/c, f. 61-62: conférence donnée à l'École Pratique des Hautes Études (Paris). Année académique 1887-1888. “Grammaire comparée du grec et du latin”. [Publié par C[ristina] Vallini et F. Angeli, “Le sens du mot”, 1990. Aiôn]. Selon Claudia Mejía, 15 septembre 2009. (BGE, Catalogue des manuscrits).
Malheureusement, la note n’apporte pas d’autres détails et le document publié ici semble contredire l’affirmation de Mejia concernant le f. 61-62. Dans ce cas la séquence et classification des archives ont pu jouer un rôle dans l’évaluation faite par Mejia.
Ces mêmes documents insérés dans un contexte de reconstruction plus ample ont inspiré l’hypothèse de Gambarara qui a affirmé que ces deux pages faisaient partie des documents autour de l’arrivée de Saussure à Genève en 1891 et de ses nouveaux cours (cf. Gambarara 2010). Pour Gambarara, qui se lance dans une comparaison pas vraiment réussie, Saussure serait à comparer à une jeune fille avant le mariage en train de s’habituer à son nouveau nom :
Il peut arriver à une jeune fille, quand son mariage est arrangé, d’essayer par écrit son nouveau nom de mariée, pour voir comme il lui se présente dans cette forme objectivée. Probablement autour de la décision définitive sur le nom de son enseignement (le 7 octobre) : à juger par l’écriture, le résultat ne lui déplaît pas trop. Le texte suivant, qui poursuit l’argumentation à § 1.3., peut être une note préparatoire pour les leçons d’ouverture (…). (Gambarara 2010, p. 292-293) Si je ne partage pas une comparaison pareille, une malchanceuse recherche d’un effet rhétorique, elle m’a permis néanmoins de réfléchir à d’autres questions inhérentes la violence du discours et de l’histoire des études saussuriennes. J’espère dans une prochaine publication de développer ce sujet.
Dans cet article, il est probable que les redondances entre divers manuscrits et textes tenues ensemble par les hypothèses de recherche et, il semblerait, le désir de reconstruction ont essayé de combler l’absence du texte. En particulier, pour Gambarara il est possible que ces pages manuscrites soient la suite de BGE Ms.fr. 3951/2 (cf. CLG/E 3287). Ces deux manuscrits sont en réalité destinés à deux buts différents Une donnée ultérieure contrant cette hypothèse de lien entre ces deux documents est que du point de vue matériel et de la mise en page, il n’y a pas de correspondance entre les deux documents. : BGE Ms.fr. 3970/c, f. 61-62 pour le texte de la brochure de 1896 comme on vient de voir, quand BGE Ms.fr. 3951/2 pourrait être hypothétiquement en lien à la nomination de Saussure à Genève en 1891 et pour le choix du titre du cours de ce dernier, qu’il essaie de motiver dans ces pages, comme délinéé par le même Gambarara en suivant l’argumentation de Reboul 2010 S’il s’agirait d’un brouillon pour une lettre, plutôt que le Recteur Eugène Richard, comme signalé par Gambarara, une possibilité serait l’helléniste Jules Nicole (1842-1921), auquel Saussure écrit le 16 juin 1891, cf. Reboul p. 240-242. Mais dans ce cas aussi on reste encore dans le domaine de l’hypothèse..
Dans la suite du passage précédent Gambarara suggère que les deux pages, 61r-61v, différentes par rapport au reste du dossier, ont été rattachées à ce dernier par Saussure lui-même : « Dans Ms.fr. 3970/c on a donc deux textes de dates différentes, accostés par Saussure lui-même. » (Gambarara 2010, p. 292, n.9). Si ces deux textes correspondent à des dates différentes, nous ne connaissons par contre pas avec précision l’état des documents à leur arrivée à la Bibliothèque de Genève et l’état dans lequel Saussure les avait laissés, et en particulier la situation de ces deux pages. Qui plus est, les informations que l’on peut tirer de Godel ne disent rien à ce propos (cf. Godel 1960). Les raisons pour lesquelles ces deux pages se trouvent dans ce dossier peuvent enfin être de nature diverse : des raisons internes aux déplacements des documents opérés par l’auteur ; d’autres liées à l’histoire des documents dans les archives ; et enfin des raisons liées à l’histoire de la classification et critique saussurienne. Dans tous les cas, il ne semble pas que l’on puisse affirmer avec certitude le fait que ce fut Saussure lui-même qui les accosta. Cette même incertitude sur la situation de départ et la classification d’archives a peut-être aussi pu produire l’hypothèse de Mejia par rapport au f. 61-62.
Enfin, le document BGE Ms.fr. 3970/c f. 61-62, ne peut pas appartenir au groupe textuel concernant l’arrivée de Saussure à Genève en 1891 et à la préparation de ses premières leçons et, en général, il ne s’agit pas de notes pour un cours et il doit être considéré de manière séparée du reste du dossier, contrairement à ce que suggèrent les hypothèses discutées dans l’analyse de la bibliographie à propos de ce manuscrit. Enfin, on le date de 1896 et tout comme le brouillon de BGE AdS 369/10 comme on vient de le montrer, il appartient au dossier du texte publié dans la brochure de l’Université de Genève en 1896.
3.3 BGE AdS 383/13, f. 18-19, 20-21
Une autre source apparaît à l’horizon de la période de la publication de 1896, même si l’assimilation de ce document à l’un ou à l’autre dossier nous demande une attention philologique majeure dans l’analyse. Le dossier BGE AdS 383/13 a été « mis en évidence » par Rudolf Engler (1930-2003) durant le travail de classification critique des Archives Ferdinand de Saussure constituées par la donation de 1996 par la famille de Saussure au Département des manuscrits de la Bibliothèque de Genève. Dans cet ensemble de feuilles éparses regroupées par Engler, on retrouve plusieurs documents d’origines diverses : entre autres, les feuilles 18-19 et 20-21 de ce dossier, portées à l’attention toujours par Gambarara 2010 dans le contexte de la reconstruction que l’on vient d’analyser. Voici la transcription complète de ces feuilles (voir images 4) :
[f. 18-19] [18] Dans la continue transformation d’un certain idiome en ce qui est actuellement le russe, le français, l’allemand, le [
[19] [biffé avec un ligne vertical jusqu’à ‘il faudra’]outant des corrections et des biffures, finalement il décide de le biffer entièrement (voir l‘image du manuscrit en annexe).de langues i d’indo-européen est une chose tellement et rétabli.assez> facile à définir que dans son objet que, en pratique et en théorie, que pour qu’on ne soit pas obligé de s’arrêter au titre, et que nous ne savons pourquoi il faudra [
Le cours d’indo-européen – qu’il est absolument (1) –, s’occupe de deux choses :
1° De la période qui pour chaque langue est immédiatement voisine de la période anté-historique, de telle manière. que c’est exactement au moment dans la mesure [
[en bas de page]
----------
Ordinaires et indifférentes dénominations :
[f. 20-21] [20] [toute la page biffée] On dénomme de différentes manières le cours d’indo-européen (ordinairement „grammaire comparée”) ; le nom n’a point du tout importance.
En attendant qu’existe le nom tout simple de cours d’indo-européen, c’est sous de noms divers, même aussi absurdes que celui de gr
Une étude bien simple,
Un fait exactement aussi simple que l’existence des langues romanes à la suite du latin donne lieu, on ne sait pourquoi,
[plusieurs ligne vides]
S’il n’y avait pas
S’il y avait
[21] D’abord [?]
Étant donné que
Aucune importance n’est attachée au titre du cours
Dans le texte publié en 1896 par Saussure, on trouve des concordances avec ces pages de BGE AdS 383. Si dans la publication on trouve :
Les cours d’indo-européen, dans les facultés où il est institué, reste libre de vouer son attention plus particulière à ces périodes historiques – et divergentes, - ou au contraire à la période anté-historique où les idiomes de rejoignent en un seul.
dans BGE AdS 383 « les cours d’indo-européen » reviennent :
[19] [paragraphe biffé jusqu’à ‘il faudr’] Le cours de langues i d’indo-européen est une chose tellement <assez> facile à définir que dans son objet que, en pratique et en théorie, que pour qu’on ne soit pas obligé de s’arrêter au titre, et que nous ne savons pourquoi il faudr [
Le cours d’indo-européen – qu’il est absolument indifférent de dénommer d’une façon ou d l’autre
(1)
– s’occupe de deux choses :
1° De la période qui pour chaque langue est immédiatement voisine de la période anté-historique, de telle manière. que c’est exactement au moment dans la mesure [ Cf. Appendice 3, A8, D1.
On a déjà analysé l’appartenance du feuille BGE Ms.fr. 3970/c, f. 61-62 au dossier du texte publié en 1896. Dans ce dernier document Saussure écrit juste après le titre à page 62v :
Le nom (souvent préféré) de „grammaire comparée et sanscrit“ ne diffère que par le nom.
La question du titre revient avec des mots similaires également dans BGE AdS 383, f. 20 :
(…) On dénomme de différentes manières le cours d’indo-européen (ordinairement “grammaire comparée”) ; le nom n’a point du tout d’importance.
Et avec le passage sur le nom qui revient aussi à f. 21 :
[21] D’abord [?]
Étant donné que
Aucune importance n’est attachée au titre du cours Cf. Appendice 3, D2, C 9.
De même si BGE Ms.fr. 3970/c, f. 61-62 est un brouillon préparatoire pour Saussure 1896 et si BGE AdS 383/13 présente un double témoignage en relation tant avec ce premier qu’avec Saussure 1896 et par conséquent aussi avec BGE AdS 369/10, f. 1r-1v, on peut suggérer l’hypothèse que ce document fait aussi partie des tours d’écriture et du dossier génétique entourant le texte publié en 1896 par Saussure. De plus, si l’on rentre dans les détails de la pratique d’écriture de Saussure, alors on peut voir d’autres liens entre les divers documents. Toutes les feuilles utilisées pour les manuscrits dont on a discuté ici sont d’un format similaire (presque comme une feuille A4) et Saussure utilisait souvent le même format de feuilles pour le même projet d’écriture (cf. Chidichimo 2008, 2011). Cette même logique de la pratique d’écriture revient dans le dossier génétique discuté ici. Donc, encore une fois, pour ces manuscrits également, BGE AdS 383/13, f. 18-19 et 20-21, même si avec une prudence majeure par rapport aux documents précédemment analysés, on peut faire l’hypothèse qu’ils appartiennent eux aussi aux tours d’écriture de 1896.
Dans le cas de ce manuscrit, les chercheurs ont aussi avancé des hypothèses de contextualisation historique et documentaire. Selon Gambarara, en fait, en suivant la ligne interprétative qu’on a déjà interpellée, ces manuscrits pourraient faire partie, eux aussi, des documents concernant l’arrivée de Saussure à Genève durant l’année 1891. Il pourrait s’agir en particulier d’un échange épistolaire à propos du choix du nom de la nouvelle chaire de Saussure :
‘Cours d’indo-européen’ (AdS 383/13, f. 19-21) Après les discussions inattendues rencontrées sous le titre de Grammaire comparée, dont, d'ailleurs, il n’était pas satisfait, Saussure prend des notes d’une lettre à un correspondant - un de ses partisans? - pour expliquer que la dénomination du cours lui est indifférente. (Gambarara 2010, p. 290)
Par contre, le texte présent dans BGE AdS 383/13 f. 18 pourrait être une note préparatoire pour les premières leçons de Saussure à Genève de 1891 :
Une phrase incomplète, qui pourrait être un morceau de note préparatoire pour les leçons d’ouverture, se trouve sur la même feuille 18-19 que le texte cité au § 1.2. [BGE AdS 383, f. 19-21], et, à juger par la mise en page, a été écrite avant celui-là. De cette façon, elle témoigne le rapport étroit entre un thème théoriquement fondamental pour Saussure, et la réflexion sur le titre de son enseignement. (Gambarara 2010, p. 297)
Cependant, certains arguments déjà discutés montrent des clés de lecture différentes pour ces documents et indiquent qu’il ne s’agirait pas de lier ces derniers à la période et à la discussion à propos de l’arrivé de Saussure à Genève en 1891. Sur la question du nom du cours, il faut dire, en outre, que le titre du cours de Saussure a été traité bien trois fois durant les séances de la Faculté de Lettres et il a changé, précisément en 1891 lors de l’arrivée de Saussure à Genève quand il sera nommé sur la chaire d’Histoire et comparaison des langues indo-européennes ; ensuite en 1896, comme on vient de le voir, à l’occasion de la mutation de sa chaire d’extraordinaire à ordinaire Sanscrit et Histoire des langues indo-européennes ; et enfin en 1906, quand Saussure prend finalement en charge le cours de linguistique générale de Wertheimer et le nom de la chaire sera Linguistique générale et Sanscrit. L’absence de ‘l’indo-européen’ du dernier titre excluant la possibilité qu’il s’agit du changement de 1906, notre discussion ne concerne que les deux premiers changements. On a déjà vu le choix du titre durant l’année 1896, à l’occasion de la transformation de la chaire de Saussure en ordinaire, quand pour arriver à ce nom il fallait passer à travers plusieurs passages et fluctuations lors des discussions sur ce choix (voir supra). Le sanscrit, en fait, apparait à la suite d’une demande de Wertheimer et la grammaire comparée revient lors des séances de la Faculté où Saussure est toujours absent. En outre, comme on l’a déjà vu (voir supra), Saussure ne sera jamais présent au moment des discussions sur ce dernier sujet et lors des fluctuations du titre du cours. On a donc dit qu’il est possible qu’il ait dû écrire un message pour donner son assentiment à propos de l’établissement du nom de sa chaire. En fait, en lisant les notes de BGE AdS 383 et la lettre à Ritter, BGE AdS 369/10, f. 1r, on voit qu’à cette occasion Saussure lui-même nous aide à établir la reconstruction. Il indique, en effet, que si en 1891 le nom de la chaire n’avait pas été choisi au hasard, à ce moment en 1896, même si les raisons pourraient bien être d’ordre théorique, le nom est indifférent pour la nature de l’enseignement, comme nous avons déjà vu :
Je déclare n’avoir pas d’objection à l’adoption de ce nouveau titre, qui se rapproche de quelques dénominations usitées pour le même enseignement dans d’autres universités. – Le titre précédent d’« Histoire et comparaison des langues indo-européennes » n’avait pas été choisi au hasard, mais j’avoue que les arguments que j’aurais à faire valoir en sa faveur son plutôt d’un ordre théorique et ne touchent pas le fond de l’enseignement qu’on peut entendre sous l’un de ces noms ou sous l’autre. (Saussure 2014, p. 247 et supra).
La dernière partie avec laquelle Saussure termine le paragraphe, nous indique l’indifférence du choix du nom de son cours, justement comme nous l’avons vu dans les pages de AdS 383. Saussure a donc pu essayer de rédiger un texte pour expliquer ses raisons, avant d’abandonner ensuite ses intentions explicatives. En effet, si on regarde les manuscrits, l’indifférence sur le choix du nom revient à plusieurs reprises. Contrairement à ce qu’a affirmé Gambarara, en 1891 nous ne trouvons pas une affirmation pareille par Saussure.
Bien que les multiples occurrences croisées entre le texte de 1896 et les deux manuscrits BGE AdS 383/13, f.18-19 et f.20-21 et la lettre à propos de la question du nom de la chaire, ne permettent pas d’avoir la certitude de l’appartenance et nous laissent encore avec un pied sur le terrain de l’hypothèse, la lettre à laquelle on fait référence, correspond alors à l’année académique 1896 et non 1891, contrairement à ce qui est affirmé par Gambarara. Donc, s’il est vrai que ces feuilles pourraient être liées entre elles, et que les deux questions du changement du nom et de la rédaction du texte de 1896 peuvent avoir eu des reflets et des interférences, il faut par contre changer de date et de contexte. Il s’agit donc de penser que BGE AdS 383/13, f.18-19 et f.20-21 se trouvent dans le contexte du changement de la chaire de Saussure d’extraordinaire à ordinaire lors de l’année académique 1896 et ne se réfèrent pas à 1891. Voici un tableau qui résume les changements de nom de la chaire de Saussure :
1891 : Histoire et comparaison des langues indo-européennes.
1896 (5 mars, séance Faculté) : Sanscrit et grammaire comparée.
1896 (14 avril, séance Faculté) : Grammaire comparée des langues indo-européennes et sanscrit ;
Sanscrit et histoire des langues indo-européennes.
1896 (16 avril lettre Saussure à Ritter) : Sanscrit et histoires des langues indo-européennes.
1896 (9 novembre, séance Faculté) : Sanscrit et histoire des langues indo-européennes.
1906 : Linguistique générale et sanscrit.
Enfin, toute l’argumentation présente dans la bibliographie à propos de ces documents devrait être réévaluée et reprise à la lumière de ces nouvelles données et analyses, en attendant le prochain document et la prochaine découverte.
4. Une autre indication textuelle : le terme anté-historique
-historicité’ dans le manuscrit, BGE Ms.fr. 3951/10 connu sous le nom de
Cahier Whitney, mais une recherche dans les autres dossiers montre comme, en effet, l’anti-historique du
Cahier
Whitneyest un cas isolé (cf.
Lexique13). Les autres dossiers où l’on rencontre anté-historique, selon une première analyse des manuscrits, sont :
- BGE AdS 369/10, p. 1v, correspondance, 1896 (voir
supra). - BGE AdS 372, p. 12-14,
De l’essence double du langage, 1891-92. - BGE AdS 375/9, p. 9v,
carnet BGE AdS 378/10, p. 1, cahierà propos de l’intonationlithuanienne.- BGE AdS 383 f. 18-19, feuilles éparses regroupés par Engler (voir
supra). - BGE Ms.fr. 3951/1.1, f. 24, notes pour la première leçon genevoise.
Par contre dans les notes des cours prises par les élèves nous retrouvons plusieurs témoins de la présence du terme anté-historique (et ses variantes) qui était donc couramment employé par Saussure. Une liste partielle des occurrences de ce terme, pour ce qui est de l’état actuel de la recherche, est la suivante :
- BGE Ms.fr. 3972/b, p. 3 Patois Charles,
Grammaire comparée du grec et du latin. - Constantin, Émile
Grammaire comparée du grec et du latin1909-1910, p. 1. BGE Ms.fr. 3972, Linguistique générale, cf. Constantin 2005, p. 131, p. 163, p. 173.- BGE Cours 434, Notes prises par George Dégallier aux cours de Saussure,
Urgemanisch I : Introduction à la grammaire historique de l’allemand et de l’anglais 1910-1912. Dans l’index Chap. IV Accentuation des langues germaniques :
Effritements des syllabes finales
- De la période historique p. 19
- De la période anté-historique p. 20.
- BGE Cours 824, Notes prises par Riedlinger aux cours de Saussure,
Grammaire historique du grec et du latin 1907-08: « Chap I Phonétique de la période anté-historique ».
Toutes ces données indiquent qu’une recherche terminologique sur ce terme pourrait être utile pour traverser le corpus saussurien avec cette clé terminologique, mais en regardant le contexte plus ample de la linguistique de l’époque.
6. Saussure, un texte entre autres textes
Cette publication saussurienne aide à rétablir l’appartenance de certains manuscrits qui ont été édités et publiés dans divers contextes et à plusieurs reprises et qui étaient accompagnés par diverses hypothèses formulées par les chercheurs qui se sont succédés dans l’interprétation et l’emploi de ces pages. Ce document, donc, est intéressant tout d’abord pour nourrir la bibliographie de Saussure publiée de son vivant et donc son corpus ; mais aussi pour fournir du matériel textuel et historique pour la reconstruction de la parabole d’écriture saussurienne ; ensuite, dans le cadre de la critique des commentaires et hypothèses philologiques, ce texte sert à montrer la stratification et le caractère progressif de la recherche philologique dans les études saussuriennes et pour donner un exemple du mouvement continuel de la philologie saussurienne entre absence, hypothèse, préjugé interprétatif et surdétermination des sources dans l’effort de se projeter dans le passé et arracher au temps des morceaux textuels. Enfin, ce texte essaie d’être un exemple pour travailler sur le critère d’économie interprétative qui, au-delà de la perspective mythologisante qui ne cesse d’entourer Saussure, reste une clé pour la reconstruction historique et pour remettre dans la juste perspective « les spéculations les plus hardies » et dirait-on, les désirs irréalisables des chercheurs. Car il faut se résigner : même s’il l’était de manière extraordinaire, Saussure n’était qu’un homme et un chercheur comme d’autres qui l’ont précédé et qui l’ont suivi, et d’autres encore qui suivront. Essayer de rétablir le passé et l’accepter sert à déterminer les prochains pas et être prêts à s’attendre à l’avenir des recherches saussuriennes. Car ce qu’il nous reste n’est rien d’autre que des textes.
- (1896) Éducation, Instruction Groupe XVII: Catalogue spécial, Genève, Imprimerie Haussmann.
- Angeli F, Vallini Cristina (1990) ""Le sens du mot": Un corso di morfologia indoeuropea", Annali dell'Università degli Studi di Napoli L’Orientale. Rivista del Dipartimento Del mondo classico. Sezione Linguistica 12, pp.365-425.
- Borgeaud Charles (1900-1934) Histoire de l'Université de Genève, Genève, Georg.
- Bouvier Bernard (1934) "La Faculté des Lettres de 1872 à 1896: Mémoire rédigé, en 1896, à l'occasion de l'Exposition nationale suisse de Genève", in: Borgeaud Charles (ed), Histoire de l'Université de Genève 3: L'Académie et l'Université au XIXe siècle, Genève, Georg, pp.69-168.
- Sechehaye Albert (2009) "Albert Sechehaye Cours de phonétique du grec et du latin 1891-1892 professé par Monsieur Ferdinand de Saussure", Cahiers Ferdinand de Saussure 62, pp.277-285.
- Chidichimo Alessandro (2009) "Les premières leçons de Saussure à Genève, 1891: testes, témoins, manuscrits", Cahiers Ferdinand de Saussure 62, pp.257-276.
- Chidichimo Alessandro (2011) Il manoscritto saussuriano de l'Essence double du langage, Cosenza, Università della Calabria.
- Chidichimo Alessandro (2013) "Michel Bréal lecteur de Johann Wolfgang von Goethe: un jeu de textes entre réalité et fiction (1898-1911)", Cahiers de l'ILSL 37, pp.187-211.
- Chidichimo Alessandro (2014) "Variations saussuriennes: écriture, recherche, style dans les manuscrits de Ferdinand de Saussure", Recherches sémiotiques/Semiotic Inquiry 34 (1-3), pp.113-136.
- Chidichimo Alessandro (2015) "Conscience d'archives et futur: le cas de F. de Saussure et l'École genevoise de linguistique", in: Bert Jean-François, Ratcliff Marc (ed), Frontières d'archives: recherches, mémoires, savoirs, Paris, Éditions des Archives Contemporaines, pp.117-129.
- Chidichimo Alessandro (2017) "Une source du premier cours de linguistique générale de Saussure, octobre 1906", Semiotica 217, pp.195-213.
- Chidichimo Alessandro (2018) "De l'essence double du langage e le Notes en vue d'un livre de linguistique générale di Saussure: un'ipotesi di ricostruzione", Acta Structuralica 3, pp.1-29.
- Constantin Émile, Saussure Ferdinand de (2005) "Linguistique générale (Cours de M. le Professeur de Saussure): Semestre d'Hiver 1910-1911", Cahiers Ferdinand de Saussure 58, pp.83-290.
- de Senarclens Jean (2010) "Naville, Adrien", in: Jorio Marco (ed), Dictionnaire historique de la Suisse: 9. Mur - Polytechnicum, Hauterive, Attinger, pp.n/a.
- Flournoy Théodore (1896) Notice sur le Laboratoire de Psychologie de l’Université de Genève publiée à l’occasion de l’Exposition Nationale Suisse à Genève en 1896, Genève, Eggimann.
- Fryba-Réber Anne-Marguerite (2013) Philologie et linguistique romanes: Institutionnalisation des disciplines dans les universités suisses (1872-1945), Leuven, Peeters.
- Gambarara Daniele (2009) "Du printemps à l’automne 1891 : Reclasser des fragments de F. de Saussure (Ms.fr. 3951/ 1-3, ADS 383/13)", Cahiers Ferdinand de Saussure 62, pp.289-303.
- Godel Robert (1960) "Inventaire des manuscrits de F. de Saussure remis à la Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève", Cahiers Ferdinand de Saussure 17, pp.5-11.
- Gourd Jean-Jacques (1897) "Rapport du Recteur", Rapports présentés à la séance tenue dans la salle de l'Aula 23, pp.3-6.
- Grésillon Almuth (2016) Éléments de critique génétique: Lire les manuscrits modernes, Paris, CNRS.
- Guex François (1897) Rapport sur le groupe XVII Éducation et Instruction, Lausanne, Payot.
- Jorio Marco (2011) Dictionnaire historique de la Suisse 10: Poma-Saitzew, Hauterive, Attinger.
- Joseph John (2010) "Saussure's notes of 1881-1885 on inner speech, linguistic signs and language science", Historiographia Linguistica 37 (1-2), pp.105-132.
- Linda Markus (2001) Element einer Semiologie des Hörens und Sprachens, Tübingen, Narr.
- Murano Francesca (2017) Saussure, Bally e la linguistica greca: I corsi ginevrini del 1893-1903, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Muret Maurice (1896) "Les Monuments historiques de la Suisse, Vufflens", Journal officiel illustré de l'exposition nationale suisse 10, pp.114-117.
- Naville Adrien (1901) Nouvelle classification des sciences, Paris, Alcan.
- Pittard Eugène (1896) "Les Université à l'exposition I", Journal officiel illustré de l'exposition nationale suisse 47, pp.560-561.
- Puech Christian (2000) "Saussure: réception et héritage: L'héritage linguistique saussurien: Paris contre Genève", Modèles linguistiques 41, pp.79-93.
- Reboul Fabienne (2009) "La nomination de Saussure à Genève: une simple formalité?", Cahiers Ferdinand de Saussure 62, pp.217-256.
- Ritter Eugène (1883) Documents pour servir à l'Histoire de l'Université de Genève III: Catalogue des ouvrages, articles et mémoires publiés par les Professeurs de l’Université de Genève, Genève, Georg.
- Rizek Martin (2003) "Bouvier, Bernard", in: Jorio Marco (ed), Dictionnaire historique de la Suisse: 2. Bandelier-Camuzzi, Hauterive, Attinger, pp.n/a.
- Saussure Ferdinand de (1896) "Histoire et Comparaison des Langues Indo-Européennes", in: L'Université de Genève et ses ressources, Genève, Imprimerie Suisse, pp.58.
- Saussure Ferdinand de (1920) "Le nom de la ville d'Oron à l'époque romaine", Indicateur de l'histoire suisse 18, pp.286-298.
- Saussure Ferdinand de (1922) Recueil des publications scientifiques, Genève, Slatkine.
- Saussure Ferdinand de (1968-74) Cours de linguistique générale, Wiesbaden, Harrassowitz.
- Saussure Ferdinand de (2011) Corso di linguistica generale, Roma, Laterza.
- Saussure Ferdinand de (2014) Une vie en lettres (edited by Mejía Quijano Claudia), Lormont, Defaut.
- Sechehaye Albert (1909) Éléments de grammaire historique du français, Genève, Eggimann.
- Soret Charles (1896) Catalogue des ouvrages, articles et mémoires publiés par les Professeurs de l'Université de Genève ainsi que des thèses présentées de 1873 à 1895 aux diverses facultés pour l'obtention des grades universitaires, Genève, Rey & Malavallon.
- Vaisse Pierre, El-Wakil Leïla (2001) Genève 1896: regards sur une exposition nationale, Genève, Georg.
- Yung Émile (1896) "L'Université de Genève", Journal officiel illustré de l'exposition nationale suisse 14, pp.164-165.